ESPACE MEMBRE
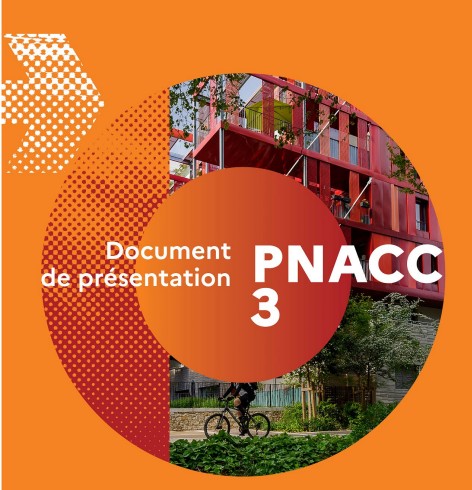
Présentation du Pnacc 3 et l’adaptation des petites villes au changement climatique
Le troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (Pnacc 3) met en avant une approche locale et différenciée face aux effets du réchauffement climatique. Alors que les petites villes sont souvent en première ligne face aux inondations, sécheresses et autres aléas climatiques, ce plan souligne leur rôle essentiel dans l’adaptation du territoire. L’Association des Petites …
Le troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (Pnacc 3) met en avant une approche locale et différenciée face aux effets du réchauffement climatique. Alors que les petites villes sont souvent en première ligne face aux inondations, sécheresses et autres aléas climatiques, ce plan souligne leur rôle essentiel dans l’adaptation du territoire. L’Association des Petites Villes de France (APVF) suit de près ces enjeux, notamment en matière d’accompagnement et de financements.
Le Pnacc 3 marque un changement de perspective : au-delà des efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il reconnaît désormais l’accélération du réchauffement et la nécessité d’adapter le pays à ses impacts. L’un des axes majeurs du plan repose sur une approche territorialisée, prenant en compte les spécificités locales. Chaque région, ville ou commune sera confrontée à des défis climatiques différents, nécessitant des solutions adaptées.
Les collectivités, et en particulier les petites villes, sont concernées par plusieurs mesures du plan. Parmi elles, on retrouve le renforcement des Plans communaux de sauvegarde, l’extension du dispositif Vigicrues, des actions pour mieux gérer les risques d’inondations, la préservation des ressources en eau ou encore l’accompagnement des élus pour anticiper l’évolution du trait de côte. La prévention des incendies est également abordée, avec des obligations renforcées de débroussaillement et des moyens supplémentaires pour la lutte contre les feux de forêt.
Le plan prévoit aussi des outils pour aider les collectivités à intégrer l’adaptation climatique dans leur aménagement et leur gestion des infrastructures. Il insiste sur la renaturation des espaces urbains et l’adoption de stratégies locales face aux aléas climatiques. Cependant, la majorité des mesures annoncées ne bénéficient pas de financements nouveaux, et leur mise en œuvre repose souvent sur des ressources déjà existantes ou à définir.
Les petites villes, qui jouent un rôle clé dans l’aménagement du territoire et la résilience face au climat, devront donc s’approprier ces orientations en fonction de leurs contraintes locales.
Pour en savoir plus, retrouvez le document de présentation de la PNACC 3.

Igor Semo auditionné par la Cour des comptes sur l’organisation territoriale des soins
La Cour des comptes poursuit ses travaux sur l’organisation territoriale de l’offre hospitalière en France. Ce mercredi 12 mars, Igor Semo, Maire de Saint-Maurice (Val-de-Marne) et Vice-Président de l’Association des Petites Villes de France (APVF), a été auditionné dans le cadre de cette enquête visant à évaluer l’impact des réformes récentes sur l’accès aux soins. …
La Cour des comptes poursuit ses travaux sur l’organisation territoriale de l’offre hospitalière en France. Ce mercredi 12 mars, Igor Semo, Maire de Saint-Maurice (Val-de-Marne) et Vice-Président de l’Association des Petites Villes de France (APVF), a été auditionné dans le cadre de cette enquête visant à évaluer l’impact des réformes récentes sur l’accès aux soins.
Lors de son intervention, Igor Semo a insisté sur les inégalités croissantes entre les territoires, notamment en raison des fermetures de services hospitaliers non compensées. Il a rappelé que, dans certaines zones, l’accès aux soins devient un véritable parcours du combattant, obligeant les habitants à parcourir des distances importantes pour consulter un spécialiste ou se rendre aux urgences.
Le maire de Saint-Maurice a également souligné le manque de concertation avec les élus locaux dans les décisions de restructuration hospitalière. Il a pris l’exemple d’un projet de restructuration immobilière de 300 millions d’euros, initialement mené sans consultation de sa municipalité, illustrant ainsi les tensions persistantes entre collectivités et autorités sanitaires.
Enfin, Igor Semo a rappelé que l’hôpital, au-delà de sa mission de santé, est souvent le premier employeur des petites villes, et que sa fermeture peut avoir des conséquences dramatiques sur l’attractivité et le dynamisme local.

Les quartiers prioritaires et l’égalité territoriale : un impondérable pour les associations d’élus
Ce jeudi 13 mars 2025, Épinay-sous-Sénart a accueilli une matinée de mobilisation en faveur des quartiers prioritaires, à l’initiative de plusieurs associations d’élus, dont l’Association des Petites Villes de France (APVF), représentée par Romain Colas, vice-Président de l’association. L’événement s’est déroulé en présence de Juliette Méadel, ministre déléguée en charge de la Ville, de Valérie …
Ce jeudi 13 mars 2025, Épinay-sous-Sénart a accueilli une matinée de mobilisation en faveur des quartiers prioritaires, à l’initiative de plusieurs associations d’élus, dont l’Association des Petites Villes de France (APVF), représentée par Romain Colas, vice-Président de l'association. L’événement s’est déroulé en présence de Juliette Méadel, ministre déléguée en charge de la Ville, de Valérie Létard, ministre en charge du Logement, et de Patrice Vergriete, président de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, afin de relayer ce message auprès du Premier ministre.
Un moment crucial pour les enjeux de la politique de la ville
Organisée en amont du prochain Comité interministériel des villes, cette rencontre a réuni des élus locaux, des représentants de l’État, des experts et des habitants afin d’évaluer les politiques publiques menées et d’identifier des leviers d’action pour renforcer l’égalité des chances et la transition écologique dans les quartiers prioritaires.
Dès l’ouverture de la matinée, Damien Allouch, maire d’Épinay-sous-Sénart, a souligné l’importance de cette mobilisation pour interpeller le gouvernement et renouveler les attentes des villes sur la méthode et les contenus des futures politiques de la ville et de cohésion sociale et urbaine.
Le moment fort de la rencontre a été la présentation de l'Appel d'Épinay, une déclaration commune des associations d’élus alertant sur la situation critique des politiques publiques de la ville et appelant le gouvernement à agir concrètement.
Des échanges autour des enjeux de santé et du vieillissement
Deux tables rondes ont ponctué la matinée. La première, consacrée à la santé et à la santé mentale, a mis en lumière les difficultés d’accès aux soins dans les quartiers populaires et l’urgence d’une meilleure coordination entre l’État et les collectivités. La seconde table ronde s’est penchée sur le vieillissement de la population dans ces quartiers, un enjeu démographique qui n’a pas encore trouvé toutes les réponses dans le bâti urbain.
Un appel politique pour une action forte et durable
L’Appel d’Épinay, porté par les associations d’élus, a souligné l’insuffisance des financements actuels et le risque d’une "extinction silencieuse" des politiques de renouvellement urbain. Avec un budget de la politique de la ville en recul et un nombre croissant d'habitants concernés, les maires alertent sur la nécessité d’un engagement budgétaire et structurel renforcé.
Les revendications formulées, que vous retrouverez ici en totalité, portent notamment sur :
- Un financement pluriannuel stable pour la rénovation urbaine et la politique de la ville.
- Une adaptation des services publics aux besoins des quartiers.
- Une cohérence renforcée entre la politique éducative prioritaire et la carte des quartiers prioritaires.
- Un meilleur soutien à l’accès aux soins et à la santé mentale.
L’APVF engagée pour l’équité territoriale
Pour Romain Colas, Maire de Boussy-Saint-Antoine, Vice-Président de l’APVF, « les petites villes ne doivent pas être les oubliées des politiques de la ville. La précarité, le manque de services publics et la dégradation de certains logements concernent aussi nos territoires. Nous demandons à l’État une stratégie ambitieuse et globale des petites villes aux métropoles ». Il a également souligné que « les défaillances du droit commun dans les quartiers politiques de la ville révèlent des inégalités d'accès aux services publics, tandis que garantir le bon fonctionnement de ces politiques revient à s'assurer qu'elles répondent de manière équitable aux besoins spécifiques de ces territoires. »
La journée s’est conclue par une conférence de presse, durant laquelle les associations d’élus ont réaffirmé leur détermination à interpeller le gouvernement sur l’urgence d’une politique de la ville à la hauteur des enjeux. Cette mobilisation en faveur des quartiers prioritaires ne s’arrête pas à l’appel Épinay : elle exige une vigilance et un engagement durable au-delà de cette journée.
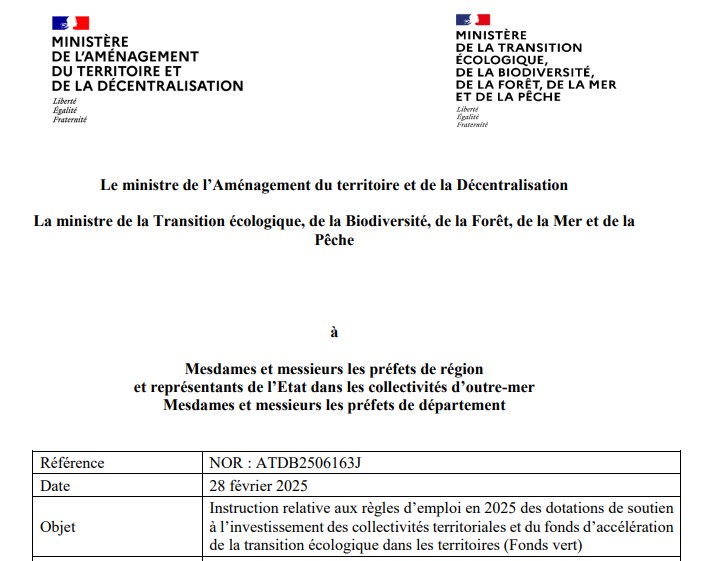
Investissement local : une circulaire fixe les grandes priorités nationales pour 2025
Les préfets ont reçu la circulaire fixant les règles pour l’attribution des dotations de soutien à l’investissement des collectivités et du fonds vert. L’accent est mis sur l’adaptation au changement climatique et à la sobriété foncière. Cette circulaire du 28 février 2025 détaille les règles d’attribution des dotations d’investissement – la dotation de soutien à …
Les préfets ont reçu la circulaire fixant les règles pour l’attribution des dotations de soutien à l’investissement des collectivités et du fonds vert. L’accent est mis sur l’adaptation au changement climatique et à la sobriété foncière.
Cette circulaire du 28 février 2025 détaille les règles d’attribution des dotations d'investissement – la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID), la dotation politique de la ville (DPV), le fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT) et, pour la première fois, le fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires ("fonds vert").
L’ensemble de ces dotations représente un montant de 3,13 milliards d’euros, dont 2 milliards pour les dotations de droit commun (avec un taux d’avance pouvant aller jusqu’à 30 %) et 1,15 milliard d’euros pour le fonds vert (avec un taux d’avance limité à 15 %). Elles seront notifiées d’ici le 30 juin.
Comme les années précédentes, la transition écologique constitue l’axe prioritaire du soutien de l’État, et précisément l’adaptation des territoires au changement climatique et la préservation des ressources foncières.
S’agissant de l’adaptation, l’accent est mis sur la prévention des inondations : priorité affirmée du fonds vert 2025 et, outre-mer, sur la protection contre les vents cycloniques. S’agissant de la sobriété foncière, les préfets sont encouragés à recycler les friches, autre priorité affichée du fonds vert 2025, en favorisant « les projets économiques et industriels (à l’exclusion de toute activité logistique ou commerciale) et la production de logements ».
De nouvelles priorités financées par le fonds vert :
- une nouvelle aide éligible : l’aide aux maires bâtisseurs « sans étalement urbain » et ciblant « en premier lieu les logements sociaux ». Cette aide sera plafonnée, mais on ne sait pas à quelle hauteur. ;
- autres priorités financées : le soutien à la transition et à la planification écologiques des activités et des espaces maritimes et littoraux d’une part, et les aménagements cyclables avec une attention particulière en l’espèce « aux territoires ruraux » d’autre part ;
A l’inverse :
- la modernisation de l’éclairage public n'est définitivement plus éligible au fonds vert;
- le soutien au tri à la source des biodéchets devra être réservé aux seules collectivités « dans l’incapacité de trouver d’autres modes de financement adaptés » ou aux dossiers non traités déposés en 2023 et 2024.
- il en va de même pour la rénovation énergétique des établissements scolaires, qui devra être assurée « prioritairement par la DSIL et la DETR », mais aussi par la DSID et la DPV, les préfets devant pour autant continuer de veiller « à l’ambition écologique des projets » (concrètement, respect de l’objectif d’économie d’énergie induite de 40 % et prise en compte du confort d’été).
Comme l’an passé, les préfets sont invités à donner aux collectivités une visibilité pluriannuelle sur le soutien de l’État, notamment via « la contractualisation ». Ils devront ainsi faire en sorte que les crédits attribués contribuent « au financement des projets de territoire définis dans les contrats pour la réussite de la transition écologique (CRTE), des actions inscrites dans les contrats de plan État-région (CPER) et interrégionaux (CPIER) ainsi que dans les pactes de développement territoriaux ». A noter que ces dotations et fonds « ne doivent pas pour autant être réservés aux seules opérations inscrites dans ces contrats ». Aussi, les projets financés doivent s’inscrire en soutien des politiques et programmes d’appui portés par le gouvernement : Action cœur de ville, Petites Villes de France, France ruralité, France Services, Territoires d’industrie, Nouveaux lieux / Nouveaux liens, avenir Montagnes ».
Enfin, rappel des trois règles intangibles :
- une participation minimale du maître d’ouvrage au financement du projet (20 % des financements apportées par des personnes publiques), étant souligné que le droit de dérogation reconnu au préfet n’est ici « pas mobilisable » ;
- un plafond de cumul des aides égal à 80 %,
- auquel s’ajoutent « des interdictions spécifiques de cumul » ;
Dernière précision importante : « le recours aux crédits européens sera systématiquement recherché ». Cela pour améliorer le taux de retour de la France sur ces fonds jugé trop faible.

Le Beauvau des polices municipales ferme ses portes en évoquant continuum et mutualisation
*** CET ARTICLE EST EN PARTENARIAT AVEC NOTRE PARTENAIRE LOCALTIS / BANQUE DES TERRITOIRES *** Publié le 12 mars 2025 par Frédéric Fortin, Épique communication pour Localtis Le Beauvau des polices municipale s’est clos ce 10 mars, au Havre, sur une session consacrée au continuum de sécurité, “à affermir”, et à la mutualisation des forces entre communes, …
Publié le
Le Beauvau des polices municipale s’est clos ce 10 mars, au Havre, sur une session consacrée au continuum de sécurité, "à affermir", et à la mutualisation des forces entre communes, encore balbutiante. Pour François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, les travaux se poursuivent néanmoins, avec toujours pour objectif le dépôt d’un projet de loi avant juillet.
Le rideau sur le Beauvau des polices municipales est tombé ce 10 mars, au Havre, après une dernière séquence consacrée à la coordination entre polices municipales et forces de sécurité intérieure – le fameux continuum de sécurité –, d’une part, et à la mutualisation des moyens entre communes, d’autre part. Les travaux ne s’arrêtent pas là pour autant. Pour nourrir le "projet de loi de modernisation des polices municipales" qu’il entend déposer d’ici la fin du premier semestre, François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, a indiqué qu’il continuerait à "se déplacer, dans nos territoires, à la rencontre de nos élus, de nos policiers municipaux et de nos gardes champêtres". S’y ajoutera "très prochainement, au ministère de l’Intérieur, une série de consultations et d’ateliers autour des associations d’élus et des organisations syndicales représentatives". Un dernier mot qui a son importance, le fait que des organisations non représentatives aient pu être invitées à participer au Beauvau ayant fait partie des raisons qui avaient conduit Force ouvrière à pratiquer la politique de la chaise vide lors de la séance lyonnaise (voir notre article du 21 février dernier).
Un continuum à "affermir"…
Au Havre, François-Noël Buffet a fait part de sa conviction que "la complémentarité entre les polices municipales et les forces de sécurité intérieure représent[ait] un enjeu absolument fondamental, qu’il faut traiter sans tabou et sans crainte". Mettant en lumière les quelque 3.500 conventions de coordination conclues entre l’État et les communes, "couvrant plus de 90% des collectivités qui emploient des agents de police municipale", il en retient "la nécessité, pour un meilleur continuum de sécurité, de donner plus de pouvoir aux polices municipales". Dans un communiqué, le ministère précise que des propositions ont été formulées au cours des travaux pour "rénover ces conventions, afin de mieux répondre aux exigences locales et aux besoins opérationnels". L’avenir dira sans doute quel sort sera notamment réservé aux "contrats de sécurité intégrée", dispositif alors non identifié lancé sans crier gare par le Premier ministre Jean Castex avec la ville de Toulouse entre deux périodes de confinement en 2020 (voir notre article du 9 octobre 2020), et qui a depuis connu un succès certain – Le Havre a signé le sien en 2022 (voir notre article du 10 février 2022). Il est d’ailleurs toujours "vivement encouragé" par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau (voir notre article du 25 novembre).
… une mutualisation à promouvoir
Un tel succès reste encore à bâtir dans le domaine de la coopération entre communes. "Sur les plus de 3.800 communes disposant d’une police municipale, seules 450 participent à une mise en commun des moyens", déplore le ministère de l’intérieur dans le communiqué publié après la séance havraise – sans préciser quels dispositifs de mutualisation étaient ici visés (pour mémoire, il en existe trois : via une police intercommunale, un syndicat de communes ou une convention pluricommunale). Le ministère ajoute que "plusieurs exemples évoqués lors des échanges [havrais] mettent en évidence que la mutualisation des moyens est encore trop souvent sous-exploitée, alors qu’elle représente un levier stratégique pour optimiser les ressources et renforcer l'efficacité des forces de sécurité". Le constat n’est pas nouveau. Si "la mutualisation intercommunale des polices municipales semble constituer une voie évidente pour lutter contre la progression des inégalités territoriales devant la sécurité", jugeaient les sénateurs François Pillet et René Vandierendonck dans un rapport(Lien sortant, nouvelle fenêtre) de… 2012 (voir notre article du 1er mars 2013), on sait que les polices intercommunales peinent toujours à s’imposer, en dépit de l’appétence des intercommunalités pour le sujet (voir notre article du 10 janvier).
Au Havre, le ministre et ancien sénateur François-Noël Buffet s’est voulu positif, en évoquant 450 communes qui participent "déjà" à un tel mouvement de mutualisation. Pour amplifier ce dernier, il y a fait part de son souhait tant de "simplifier et [d’]améliorer la lisibilité et l’efficacité des dispositifs existants" que d’en "imaginer de nouveaux". Une direction déjà prise par les lois Engagement et Proximité (voir notre article du 23 janvier 2020) et Sécurité globale (voir notre article du 26 mai 2021). À chaque fois particulièrement sous l’impulsion de la Chambre haute, chère au ministre.

Succès des Rencontres des Maires des Antilles et de Guyane à la Guadeloupe
Réunis à Lamentin, en Guadeloupe, près d’une centaine d’élus ultramarins ont échangé sur les grands défis de leurs territoires. Autonomie énergétique, vie chère, mal-logement et investissement local étaient au cœur des discussions. À l’initiative de l’APVF, en partenariat avec les trois associations des maires de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, près d’une centaine d’élus …
Réunis à Lamentin, en Guadeloupe, près d’une centaine d’élus ultramarins ont échangé sur les grands défis de leurs territoires. Autonomie énergétique, vie chère, mal-logement et investissement local étaient au cœur des discussions.
À l’initiative de l’APVF, en partenariat avec les trois associations des maires de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, près d’une centaine d’élus étaient présents à Lamentin, en Guadeloupe, ce vendredi 7 mars. Au programme : les questions d’autonomie énergétique, de vie chère et de mal-logement, ainsi que la problématique de l’investissement local en période de contrainte budgétaire.
En présence des trois députés de Guadeloupe, des représentants de la Région et du Département de Guadeloupe, d’EDF, mais aussi de la Banque des Territoires et de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics, les élus ont dressé un constat concret de la situation : les contraintes inhérentes à l’insularité, mais aussi les atouts et les potentialités des collectivités ultramarines.
Parmi les propositions qui ont émergé au cours de la réunion : flécher les territoires ultramarins comme prioritaires dans l'attribution du Fonds Vert et mettre en place un plan "Marshall" pour l'eau et l'assainissement.
Christophe Bouillon, président de l’APVF mais aussi de l’ANCT, a assuré aux élus présents qu’il relaierait auprès du gouvernement et des parlementaires leurs préoccupations et leurs propositions.

Politique de la ville : les associations d'élus se mobilisent avant le Comité interministériel des villes
Le 13 mars 2025, sept associations d’élus – Intercommunalités de France, Ville & Banlieue, l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités, l’Association des maires d’Île-de-France, France urbaine, l’Association des petites villes de France et Villes de France – organiseront une journée de mobilisation intitulée “Les villes, les quartiers, cœurs de la République”. Cet …
Le 13 mars 2025, sept associations d’élus – Intercommunalités de France, Ville & Banlieue, l’Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités, l’Association des maires d’Île-de-France, France urbaine, l’Association des petites villes de France et Villes de France – organiseront une journée de mobilisation intitulée "Les villes, les quartiers, cœurs de la République".
Cet événement s’inscrit dans une dynamique collective visant à anticiper le prochain Comité interministériel des villes (CIV), prévu en mars 2025. Les associations souhaitent rappeler l'engagement des communes et intercommunalités en faveur des quartiers populaires et renforcer le dialogue avec l’ensemble des acteurs concernés. À cette occasion, elles lanceront "un appel à la coopération", en invitant les têtes de réseaux associatifs et les acteurs locaux à partager leurs perspectives sur les enjeux de la politique de la ville.
Un premier test pour la nouvelle ministre Juliette Méadel
Le CIV de mars 2025 sera le premier sous l’égide de Juliette Méadel, nouvelle ministre déléguée chargée de la Politique de la ville. Dans une interview à La Gazette des Communes, elle a affirmé que la priorité sera donnée aux plus jeunes : "On doit s'occuper d'un enfant dès la petite enfance, et cela touche le sanitaire, l'éducatif, le social, le culturel, le sportif." Ce CIV permettra de dresser un bilan des mesures engagées en octobre 2023 et de fixer de nouveaux objectifs quantitatifs plus clairs.
Outre la jeunesse, la ministre entend faire de l’économie un axe fort de son action. Elle compte ainsi encourager le commerce, l’artisanat et les nouvelles technologies dans ces territoires.
Vers un "ANRU 3" ?
Lors du CIV, la question de la poursuite de la rénovation urbaine sera centrale. Le rapport Ensemble, refaire ville, remis le 18 février à François Rebsamen, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, préconise un "ANRU 3" pour garantir la continuité des efforts en matière de logement et de cadre de vie. "J'ai absolument besoin de l'Anru, il est décisif pour la rénovation des quartiers", a déclaré Juliette Méadel.
Les maires insistent également sur la mobilisation des crédits de droit commun pour garantir un accès équitable aux services publics dans les quartiers. La ministre a rappelé que le programme 147, consacré à la politique de la ville, dispose de 610 millions d’euros en 2025, tout en insistant sur la nécessité de mobiliser l'ensemble des ministères pour renforcer les services publics en matière de santé, éducation, logement et sécurité.
Des attentes fortes sur l'entretien des logements sociaux
Enfin, la question de l’entretien des parties communes dans les logements sociaux suscite des tensions. Une circulaire ministérielle impose aux bailleurs sociaux de prendre leurs responsabilités sous peine de sanctions, une mesure contestée par l'Union Sociale pour l'Habitat (USH). La ministre assure que l’état des lieux attendu pour le 7 mars permettra d’objectiver les responsabilités et d’agir rapidement pour améliorer les conditions de vie des habitants.
Le CIV de mars 2025 sera donc un moment crucial pour la politique de la ville, attendue avec impatience par les élus et les acteurs associatifs. L’APVF suivra de près ces débats et continuera à porter la voix des petites villes engagées au service des quartiers populaires.

Fin du transfert obligatoire de l’eau et de l’assainissement : une avancée pour les communes
L’Assemblée nationale a franchi une étape décisive en adoptant en commission des lois une proposition de loi permettant aux communes de conserver la gestion de l’eau et de l’assainissement. Ce texte met fin à l’obligation de transfert aux EPCI, une mesure imposée par la loi NOTRe et contestée depuis dix ans. Si cette réforme est …
L’Assemblée nationale a franchi une étape décisive en adoptant en commission des lois une proposition de loi permettant aux communes de conserver la gestion de l’eau et de l’assainissement. Ce texte met fin à l’obligation de transfert aux EPCI, une mesure imposée par la loi NOTRe et contestée depuis dix ans. Si cette réforme est définitivement adoptée, elle permettra aux communes qui n’ont pas encore transféré ces compétences de les conserver, tout en maintenant les transferts déjà effectués.
Les parlementaires ont massivement soutenu cette évolution, reconnaissant la nécessité d’adapter la gestion de ces services aux spécificités locales. Parmi les amendements adoptés, la création de syndicats infracommunautaires permettra aux communes de mutualiser la gestion de l’eau et de l’assainissement tout en conservant leur autonomie, évitant ainsi un transfert systématique aux intercommunalités. La possibilité de dissocier l’assainissement collectif du non collectif leur offrira une flexibilité supplémentaire, notamment pour celles ayant déjà organisé la gestion du service public de l’assainissement non collectif (Spanc).
Un mécanisme de solidarité territoriale a également été introduit, permettant à une commune en situation de pénurie d’eau potable de bénéficier d’un approvisionnement par une commune voisine excédentaire, sans paiement pour l’eau elle-même, seules les dépenses d’acheminement étant à la charge de la commune bénéficiaire. Cette mesure vise à renforcer la résilience des territoires face aux épisodes de sécheresse et aux tensions sur la ressource en eau.
Enfin, le contrôle des installations d’assainissement non collectif sera renforcé avec l’introduction d’un diagnostic obligatoire avant toute transaction immobilière. L’acheteur d’un bien doté d’une installation non conforme aura un an pour réaliser sa mise aux normes sous peine de sanctions. Cette réforme vise à garantir une meilleure qualité des équipements et à limiter les risques sanitaires et environnementaux.
Le texte sera examiné en séance publique le 11 mars avant un passage en commission mixte paritaire. Toutefois, les amendements introduits pourraient retarder son adoption définitive en nécessitant des ajustements entre l’Assemblée et le Sénat.

Répartition de la DGF au Comité des finances locales
Lors de la séance du 4 mars, le comité des finances locales (CFL) a procédé, avec un mois de retard sur le calendrier habituel, aux arbitrages sur la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF). En augmentation de près de 150 millions d’euros par rapport à 2024 – financé par une baisse à due concurrence de …
Lors de la séance du 4 mars, le comité des finances locales (CFL) a procédé, avec un mois de retard sur le calendrier habituel, aux arbitrages sur la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF).
En augmentation de près de 150 millions d'euros par rapport à 2024 – financé par une baisse à due concurrence de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), le principal concours financier aux collectivités locales s'élève à 27,394 milliards d'euros en 2025. 19,1 milliards d'euros (soit près de 70% de l'enveloppe) seront affectés aux communes et intercommunalités et 8,27 milliards d'euros le seront aux départements.
Parmi les arbitrages, le CFL a porté la progression de la dotation de solidarité urbaine (DSU) d'un montant de 2,9 milliards d'euros) en 2025 à la hauteur de celle de la dotation de solidarité rurale (DSR qui atteint 2,3 milliards), soit +150 millions d'euros pour chacune (contre des hausses respectives de 140 et 150 millions d'euros prévues en loi de finances). Ce coup de pouce vers les élus urbains sera financé par les redéploiements de la DGF.
Pour rappel, les 150 millions d'euros qui abondent la DGF en 2025 alimenteront la moitié de la hausse de la DSU et de la DSR (+300 millions d'euros finalement). L'autre moitié sera financée par l'écrêtement de la dotation forfaitaire de plusieurs milliers de communes dont la richesse dépasse un certain seuil (en sachant que celles ne percevant pas de dotation forfaitaire sont exonérées) et la minoration de la dotation de compensation des intercommunalités à fiscalité propre. En outre, c'est aussi par ce canal que sera financée la hausse de la dotation forfaitaire liée à la croissance démographique en 2025 (43,4 millions d'euros). Le CFL a reconduit la clé de répartition utilisée en 202 : 60 % de ces besoins de financement mis à la charge de la dotation forfaitaire des communes et 40 % à celle de la dotation de compensation des intercommunalités.
Pour les communes écrêtées, c’est une perte de 114 millions d'euros, tandis que pour les intercommunalités, la baisse de leur dotation de compensation s’élève au total à 166 millions d'euros.
S'agissant de la DSR, la loi de finances pour 2025 a prévu que la part de la progression de la dotation allouée à la fraction "péréquation", perçue par plus de 33.000 communes, ne peut être inférieure à 60 %, à charge pour le CFL de ventiler les 40 % restant. Et, comme l'an dernier, il a choisi de répartir l'accroissement disponible à 75 % sur la fraction "bourg-centre", qui augmente de 41,8 millions d'euros, et à 25 % sur la fraction "cible" bénéficiant aux 10.000 communes rurales les plus défavorisées, qui augmente de 13,9 millions d'euros.
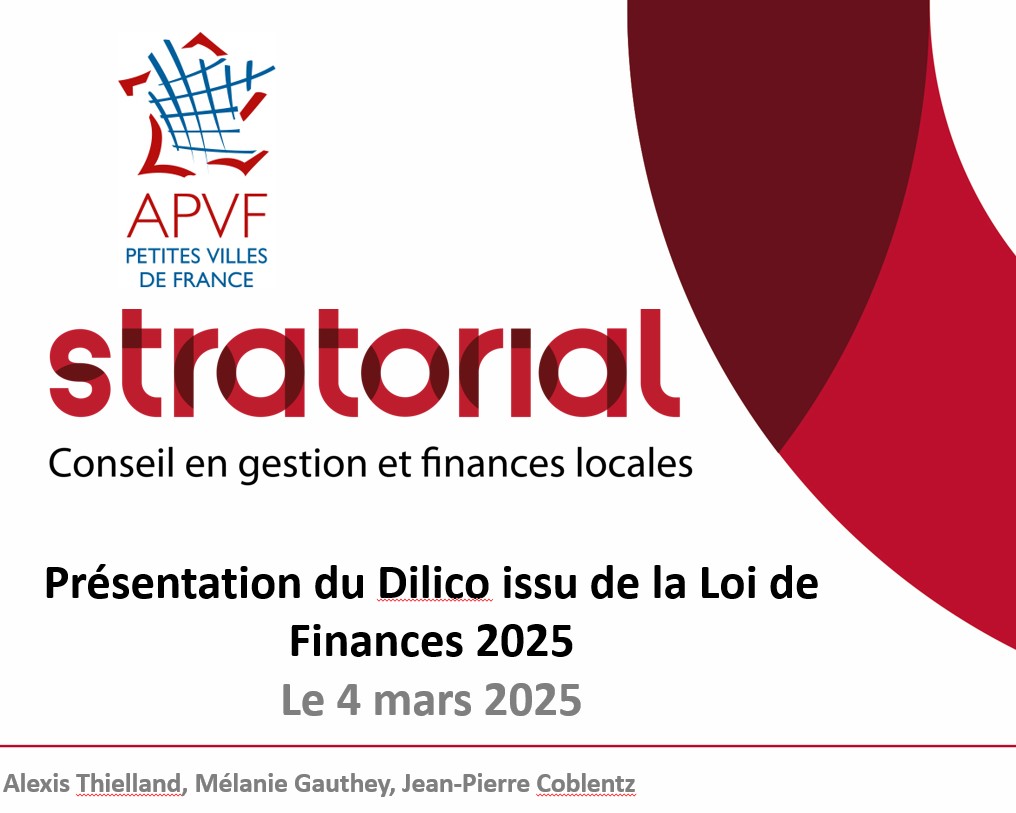
Franc succès de la première réunion technique "Tout savoir sur le Dilico"
Le 4 mars 2025 s’est tenue la première réunion technique du Réseau des DGS de petites villes intitulée « Tout savoir sur le Dilico ». A cette occasion Jean-Pierre COBLENTZ, consultant expert en finances et fiscalité locales chez STRATORIAL, a présenté les mécanismes en jeu et a répondu aux nombreuses questions posées par les 130 …
Le 4 mars 2025 s'est tenue la première réunion technique du Réseau des DGS de petites villes intitulée « Tout savoir sur le Dilico ». A cette occasion Jean-Pierre COBLENTZ, consultant expert en finances et fiscalité locales chez STRATORIAL, a présenté les mécanismes en jeu et a répondu aux nombreuses questions posées par les 130 participants.
Un nouveau dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités locales (Dilico), qui intègre près de 2 000 communes dont un tiers de petites villes, a été instauré par la loi de finances 2025. Face à une absence de transparence notable de la part de l'Etat sur les modalités du dispositif, et en l'absence de toute simulation, l'APVF a tenté de répondre aux inquiétudes légitimes, et assez exceptionnelles, des élus. C'est dans ce contexte que l'APVF et Stratorial ont organisé cette réunion technique à l'attention de l'ensemble des petites villes concernées par le Dilico.
Jean-Pierre Coblentz après avoir contextualisé la mise en place du dispositif, a repris ligne à ligne l'article de la loi de finances et a explicité les modalités de calculs. Ont été évoquées également les suites possibles du Dilico, après 2025.
