ESPACE MEMBRE

3 questions à Romain Prudent, Directeur de la Communication de Veolia en France
Rapports du Giec, plans d’investissement, stratégies climatiques, Green New Deal, COP : le débat écologique est désormais entré dans le vif, l’opinion publique est consciente de la crise climatique en cours. Veolia lance “Eco d’eau”, une initiative pour rassembler tous les acteurs prêts à s’engager pour préserver la ressource en eau et à laquelle l’APVF …
Rapports du Giec, plans d’investissement, stratégies climatiques, Green New Deal, COP : le débat écologique est désormais entré dans le vif, l'opinion publique est consciente de la crise climatique en cours. Veolia lance “Eco d’eau”, une initiative pour rassembler tous les acteurs prêts à s’engager pour préserver la ressource en eau et à laquelle l’APVF se joint.
1) Pour commencer, quels sont vos constats ?
L’année 2022 a été marquée par la plus forte sécheresse enregistrée depuis les années 50, inédite par sa durée, son intensité et sa précocité, avec un fort accroissement des feux de forêt et une tension encore jamais rencontrée sur la ressource en eau, à cette échelle. Cet hiver, les pluies ont été si faibles que les nappes n’ont pu pleinement se reconstituer. Le climat de la France, que nous avons toujours connu tempéré, devient de plus en plus aride : il y fait de plus en plus chaud, et l’eau y est de plus en plus rare. L’exceptionnel devient la norme, et nous devons nous y adapter.
2) Sommes-nous prêts à accepter les changements nécessaires pour faire face à l’urgence environnementale ?
Le baromètre de la transformation écologique que nous avons établi avec Elabe le dit clairement : oui, 6 Français sur 10 sont prêts à accepter la plupart des changements (économiques, culturels, sociaux) qu'impliquerait le déploiement massif des solutions écologiques. Mais à des conditions claires : aucun risque pour la santé, une répartition de l'effort équitable et l’utilité éprouvée de la solution. Ce qui les réunit, c’est une conviction partagée : le coût de l’inaction serait plus élevé que le coût de l’action.
C’est bien dans cet esprit de rassemblement et d’action que l’initiative “Eco d’Eau” s’inscrit. Elle propose à tous les acteurs qui le souhaitent - les collectivités au premier titre, mais aussi les entreprises, les associations, les citoyens bien sûr - d’engager des actions en faveur de la préservation de l’eau, chacun pouvant agir à sa mesure, de manière volontaire. Pour relever les défis majeurs que cela représente pour les territoires, le vivre-ensemble, l’écologie et l’économie.
3) Comment nos adhérents peuvent-ils diffuser ce mouvement dans leurs collectivités ?
“Eco d’eau” est une démarche ouverte à tous - et pas seulement réservée aux seuls clients de Veolia, car le sujet nous concerne véritablement tous ! Elle permet en particulier à chaque collectivité qui y adhère de mener des campagnes de sensibilisation efficaces, avec des supports de communication complets et variés, personnalisables à leur nom et avec leur logo propre. Elle permet à chacune de mobiliser sur leur territoire - en invitant les habitants à signer le manifeste en ligne, ou en proposant aux entreprises, aux agriculteurs du territoire de rejoindre le mouvement. Elle permet aussi de formaliser ses propres engagements dans une charte d’engagements volontaires, pour les faire connaître à tous. C’est en somme une façon de créer une dynamique au sein des équipes de la collectivité et sur le territoire, de contribuer à un impact collectif, et de promouvoir ses engagements de manière plus visible.
Pour la rejoindre, rien de plus simple : en parler à ses interlocuteurs Veolia les plus proches, ou se rendre directement sur la page du site

Déserts médicaux : une motion à adopter dans vos communes
Le groupe de députés transpartisan à l’origine d’une proposition de loi qui vise à réguler l’offre de soins, cosignée par plus de 200 parlementaires issus de 9 groupes, propose aux collectivités d’adopter une motion en faveur de l’examen du texte au Parlement. L’APVF soutient cette initiative. Pour rappel, Christophe Bouillon, Maire de Barentin et Président …
Le groupe de députés transpartisan à l’origine d’une proposition de loi qui vise à réguler l'offre de soins, cosignée par plus de 200 parlementaires issus de 9 groupes, propose aux collectivités d'adopter une motion en faveur de l'examen du texte au Parlement. L'APVF soutient cette initiative.
Pour rappel, Christophe Bouillon, Maire de Barentin et Président de l'APVF avait été auditionné par ce groupe de députés en novembre 2022
La proposition de loi propose ainsi de réguler l’installation des médecins dans les territoires et avance des réponses pour démocratiser l’accès aux études de médecine et l’offre de soins
Afin d’obtenir une inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée ce groupe de députés a lancé une mobilisation dans les territoires notamment avec un « Tour de France des déserts médicaux commencé en Mayenne le 1er février dernier et qui se poursuivra jusqu’en juin.
Le texte soumis pour l'adoption de motions, présenté aux différentes associations de collectivités lors d’une réunion à l’Assemblée nationale le 14 mars à laquelle a assisté Christophe Bouillon, peut ainsi être adopté par les communes sous la forme d'un vœu ou d'une motion.
Vous trouverez ci-dessous le texte proposé et pouvez le télécharger en cliquant ici :
Motion de soutien à des mesures volontaristes contre les déserts médicaux
Au moins 8 millions de Françaises et de Français vivent dans un désert médical.
En France, le département le mieux doté compte 3 fois plus de médecins généralistes par habitant que le département le moins bien doté. Cet écart monte à 4 pour les chirurgiens-dentistes, à 18 pour les ophtalmologues, à 23 pour les dermatologues et à 33 pour les pédiatres.
Chaque fois que les déserts médicaux avancent, c’est la République qui recule.
À ce jour, malgré la mobilisation continue des collectivités depuis des années, aucune politique publique n’a véritablement réussi à apporter de réponse durable à la désertification médicale. Les mesures incitatives sont coûteuses, peu efficaces, et favorisent concurrence et surenchère souvent délétères entre les territoires.
Face à l’urgence, il est plus que jamais nécessaire de mettre l’ensemble des solutions possibles sur la table.
En janvier dernier, plus de 200 députés, issus de 9 groupes parlementaires, ont déposé une proposition de loi transpartisane, qui propose de réguler l’installation des médecins dans les territoires pour mieux les répartir - comme cela existe déjà pour les pharmaciens, les sages-femmes, les kinés, les infirmiers libéraux. Ce texte avance en outre des réponses concrètes pour démocratiser l’accès aux études de médecine et améliorer l’exercice des soins, afin que chaque Français ait accès à un généraliste, un spécialiste, un chirurgien-dentiste près de chez lui.
Il est nécessaire, pour nos concitoyens et nos territoires, qu’un débat de fond ait lieu au Parlement sur cette question cruciale.
Le conseil municipal/communautaire/départemental/régional de […] forme le vœu que ce texte de loi soit inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, et que le débat parlementaire permette son vote dans les meilleurs délais.

PPL ZAN : que faut-il retenir du texte adopté par le Sénat ?
Le 16 mars 2023, le Sénat a adopté en séance plénière la proposition de loi “visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs du ZAN au cœur des territoires” portée par Jean-Baptiste Blanc (Vaucluse – LR) et Valérie Létard (Union centriste – Nord) et issue d’une mission transpartisane. Retour sur les principales avancées de …
Le 16 mars 2023, le Sénat a adopté en séance plénière la proposition de loi "visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs du ZAN au cœur des territoires" portée par Jean-Baptiste Blanc (Vaucluse - LR) et Valérie Létard (Union centriste - Nord) et issue d'une mission transpartisane. Retour sur les principales avancées de ce texte qui s’aligne avec plusieurs propositions que l'APVF avait formulées en janvier dernier…
Première victoire dans le texte adopté par la chambre haute : l’assouplissement du calendrier que l’APVF avait appelé de ses vœux. Ainsi, le délai d’entrée en vigueur des Sraddet modifiés intégrant les objectifs de la loi Climat et Résilience est prolongé d’un an.
Concernant le décompte d’artificialisation, plusieurs ajouts sont également accueillis favorablement par l’APVF qui avait proposé de ne pas comptabiliser dans les enveloppes d’artificialisation les grands projets d’envergure régionale, nationale et européenne. Ainsi, le texte sort du décompte d’artificialisation les projets de « construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur ». A cela, s’ajoute notamment :
- les projets relevant d’une concession de service public de l’État ;
- les projets « d’implantation d’unités industrielles valorisant l’utilisation d’une ressource naturelle renouvelable, concourant à la transition énergétique, ou relevant de l’indépendance nationale, ou représentant un intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne» ;
- ou encore «toutes actions ou opérations d’aménagement réalisées au sein des circonscriptions des grands ports maritimes ou fluvio-maritimes de l’État ».
A noter que ces projets feront l’objet d’une inscription dans le Sraddet, après avis des communes et des EPCI « sur le territoire desquels ces projets sont implantés » et de la conférence régionale du ZAN : instance nouvellement instaurée par le texte.
Ayant également réclamé l’adaptation des objectifs du ZAN aux communes soumises au recul du trait de côte, l’APVF se réjouit que le texte adopté précise que « les surfaces artificialisées rendues impropres à l’usage en raison de l’érosion côtière ayant fait l’objet d’une renaturation » seront décomptées de l’artificialisation.
Concernant la nomenclature des sols, dont une deuxième mouture devrait voir le jour d’ici juin, le texte reconnaît comme non artificialisée « une surface à usage résidentiel, de loisirs, ou d’infrastructures de transport, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée ». A la suite des débats en séance publique « une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole » ne sera pas non plus comptabilisée. Des modifications plutôt bienvenues pour l’APVF qui avait appelé à une meilleure prise en compte de la qualité des projets dans les calculs d’artificialisation.
Autre bonne nouvelle : le texte conserve ses dispositifs initiaux de sursis à statuer sur certains permis, et de droit de préemption « sur les espaces propices à la renaturation ou au recyclage foncier » : nouveaux outils dont l’APVF avait encouragé la création afin que les Maires puissent agir plus rapidement dans la période transitoire.
L’État est également tenu de mettre gratuitement à disposition des collectivités, et en format numérique, les « données complètes et continues de consommation d’Enaf, d’artificialisation et de renaturation des sols (…), ainsi que les données et les cartographies relatives aux friches établies par l’État. » Sur le sujet des friches, leur statut a aussi été clarifié afin qu’elles soient clairement désignées comme des surfaces artificialisées, et faciliter leur réhabilitation. Ainsi, leur réutilisation n’entraînera pas de consommation d’espaces et, à l’inverse, leur renaturation améliorera le solde net d’artificialisation de la collectivité. Bien que favorable à cette mesure, l’APVF souhaite aussi un renforcement du « fonds friches » et une meilleure réponse de l’Etat face au besoin d’ingénierie des collectivités afin d’accompagner davantage les efforts de réindustrialisation, de récupération foncière et de renouvellement urbain.
Enfin, afin de garantir à chaque commune que la mise en œuvre du ZAN n’entraîne pas un gel de son développement, le texte offre une « surface minimale de développement communal » d'un hectare. Les sénateurs ont en outre prévu une majoration pour les communes nouvelles de 0,5 hectare par commune déléguée, plafonnée à deux hectares. Les sénateurs ont rejeté l'amendement du gouvernement qui était en faveur d’une enveloppe minimale d'artificialisation équivalent à 1% de la surface urbanisée des communes rurales peu denses.
Le texte devrait être inscrit prochainement à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale où des députés Renaissances ont déjà déposé mi-février leur propre proposition de loi pour accompagner les élus locaux dans la mise en œuvre du ZAN. Même si le gouvernement a déclenché la procédure accélérée sur le texte du Sénat, un accord entre députés et sénateurs s’annonce difficile. Alors qu’au Sénat, le gouvernement a contesté par amendements 6 des 13 articles (rejetés par le Sénat), la dynamique risque d’être différente au Palais Bourbon où le gouvernement dispose d'une majorité, même relative.
Accéder au dossier législatif de la proposition de loi sur le ZAN adoptée par le Sénat

L’APVF auditionnée au Sénat sur l’avenir de la commune
Daniel Cornalba, Maire de L’Étang-la-Ville (Yvelines), membre du bureau de l’APVF, a été auditionné le 14 mars dernier dans le cadre de la mission d’information sénatoriale sur l’avenir de la commune et du maire, présidée par Maryse Carrère, Sénatrice des Hautes-Pyrénées et dont le rapporteur est Matthieu Arnaud, Sénateur de l’Ardèche. Cette audition a été …
Daniel Cornalba, Maire de L’Étang-la-Ville (Yvelines), membre du bureau de l’APVF, a été auditionné le 14 mars dernier dans le cadre de la mission d’information sénatoriale sur l’avenir de la commune et du maire, présidée par Maryse Carrère, Sénatrice des Hautes-Pyrénées et dont le rapporteur est Matthieu Arnaud, Sénateur de l’Ardèche.
Cette audition a été l’occasion de rappeler que, malgré un taux d’abstention exceptionnellement élevé lors des dernières élections municipales, les citoyens manifestaient toujours leur confiance à l’égard des Maires, confiance qui a même été renforcée avec la crise sanitaire. Avant juin 2019, 71,13 % des Français déclaraient faire confiance au maire de leur commune. En juin 2021, ils sont 74,3 % à leur accorder leur confiance selon l’enquête de l’Observatoire de la démocratie de proximité AMF-CEVIPOF/Sciences Po. Pourtant, si l’on ne peut parler de « crise des vocations », les Maires expriment une difficulté de plus en plus forte à répondre à leurs attentes, avec des marges de manœuvre financières en diminution constante, un manque de considération latent de l’Etat et une certaine lassitude. Finalement, un sentiment d’abandon ressenti aussi bien par les Maires que par leur population. Cette idée avait très bien été résumée par le Président de l’APVF, Christophe Bouillon, lors des Assises de Dinan, évoquant un vrai risque de « blackout territorial ».
Face à ces constats, l’avenir de la commune et du Maire se pose avec une particulière acuité. Nous avons indiqué que la commune restait la réponse la plus efficace au besoin de proximité et de démocratie locale exprimé par les citoyens, les usagers et même les contribuables dont le lien avec la commune se délite à mesure que le Gouvernement supprime les principaux impôts locaux. A cela s’ajoute la fermeture des services publics de proximité et la recentralisation des services déconcentrés au niveau des plus grandes agglomérations. Il est fondamental de redonner des marges de manœuvre aux élus locaux dans la gestion du quotidien et de renforcer l’Etat dans son rôle de garant de la solidarité nationale.
Retrouvez la réponse de l’APVF au questionnaire du Sénat en cliquant ici.
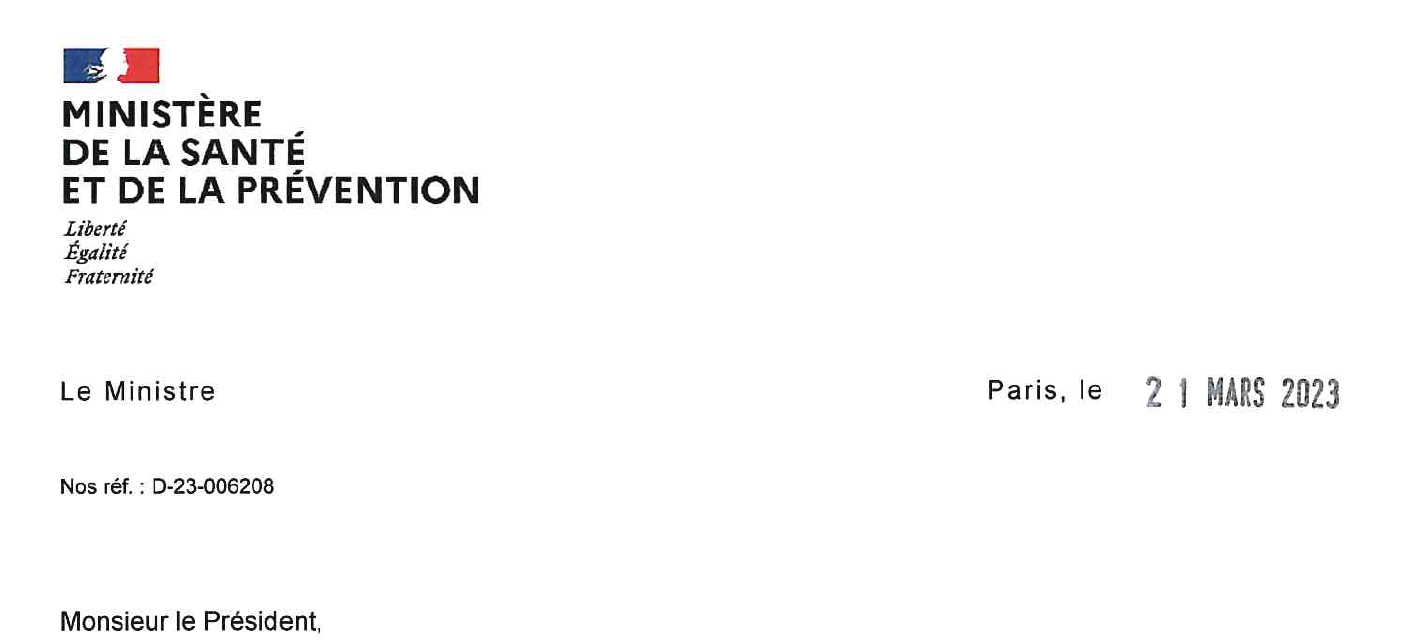
Intérim hospitalier : la réponse du ministre de la Santé à l'APVF
L’Association des Petites Villes de France (APVF) avait adressé une lettre à François Braun, Ministre de la Santé et de la Prévention pour lui faire part de ses préoccupations quant aux modalités d’entrée en vigueur des dispositions régulant les tarifs de l’intérim en milieu hospitalier. Le ministre a répondu à ce courrier. L’APVF avait rappelé dans …
L’Association des Petites Villes de France (APVF) avait adressé une lettre à François Braun, Ministre de la Santé et de la Prévention pour lui faire part de ses préoccupations quant aux modalités d’entrée en vigueur des dispositions régulant les tarifs de l’intérim en milieu hospitalier. Le ministre a répondu à ce courrier.
L'APVF avait rappelé dans sa lettre au ministre que les mesures prévues par loi Rist de 2021, avec notamment un plafonnement du montant brut pouvant être payé à un médecin intérimaire pour 24h, doivent permettre de limiter à long terme les effets de la surenchère. Cependant, certains établissements de petites villes sont parfois très dépendants des intérimaires et se trouvent contraints d’accepter des tarifs excessifs pouvant aller jusqu’à plusieurs milliers d’euros pour 24h, ces pratiques s’apparentant alors à une forme de mercenariat.
L'APVF avait également eu l'occasion de pointer le caractère encore trop disparate des concertations que doivent mener les ARS avec les acteurs locaux pour anticiper les risques pour la continuité des soins dans les territoires. Appelant au renforcement de ces concertations, l'APVF plaidait pour que "des dérogations circonstanciées dans le temps et dans les territoires" puissent être mises en place tout en souhaitant une coopération accrue entre établissements publics et privés.
Le ministre a indiqué dans sa réponse avoir choisi un "mode de mise en application progressif" indiquant que "la réforme ne s'appliquera qu'à compter du 3 avril". De même, le ministre déclare que "des solutions alternatives, mises en place au cas par cas, sont travaillées dans chaque territoire en fonction du contexte local et des ressources mobilisables, notamment dans les CHU et les établissements pivots des territoires".
En outre le courrier de réponse précise qu'il a été "demandé aux directeurs généraux et aux directeurs des délégations départementales des ARS de se tenir prêts à répondre à toute sollicitation des élus et à toute précision nécessaire sur la mise en œuvre de la réforme dans chaque territoire".
Est jointe en annexe du courrier la liste et les adresses des directeurs de cabinet des ARS pouvant être contacté par élus. De plus, "une organisation dédiée" est "mise en place au sein du ministère pour étudier les situations particulièrement signalées par les élus". Il est indiqué que seront étudiées "en lien avec les ARS toutes les situations qui nécessitent une attention ou une intervention particulières" avec la possibilité de faire remonter "en tant que de besoin" ces difficultés à sara@djabali@sante.gouv.fr
Téléchargez le courrier de réponse adressé au Président de l'APVF par le ministre de la Santé en cliquant ici

Lancement du 25e Label national Territoires, Villes et Villages Internet
L’association Villes Internet, dont l’APVF est partenaire, lance la 25ème édition du Label national Territoires, Villes et Villages Internet. Mathieu Vidal, président de l’association Villes Internet, invite les communes françaises à participer au 25ème millésime du Label national Territoires, Villes et Villages Internet. Cette édition mettra à l’honneur les projets numériques locaux permettant de faire …
L'association Villes Internet, dont l'APVF est partenaire, lance la 25ème édition du Label national Territoires, Villes et Villages Internet.
Mathieu Vidal, président de l’association Villes Internet, invite les communes françaises à participer au 25ème millésime du Label national Territoires, Villes et Villages Internet. Cette édition mettra à l'honneur les projets numériques locaux permettant de faire face aux crises actuelles.
Veuillez retrouver ici le communiqué de presse de Villes Internet
S'inscrire au webinaire de présentation de cette 25ème édition

Education Nationale : 4ème séance d'une instance de dialogue avec les élus
Le Ministre de l’Education Nationale, Pap Ndiaye, a rassemblé les associations d’élus le 17 mars dernier. L’occasion de faire le point sur les différents axes de travail entre l’Etat et les collectivités. Lors de cette quatrième séance de l’instance de dialogue entre les élus locaux et le ministère de l’Education nationale, le ministre Pap Ndiaye …
Le Ministre de l'Education Nationale, Pap Ndiaye, a rassemblé les associations d'élus le 17 mars dernier. L'occasion de faire le point sur les différents axes de travail entre l'Etat et les collectivités.
Lors de cette quatrième séance de l'instance de dialogue entre les élus locaux et le ministère de l'Education nationale, le ministre Pap Ndiaye a fait le point sur plusieurs chantiers.
Le Ministre a tout d'abord fait un point sur l'avancement de la mixité sociale à l'école, en insistant sur la nécessaire collaboration avec les collectivités locales.
Par la suite, ont été évoqués le CNR éducation (une brochure présentant les projets financés a été éditée, voir en fin d'article), la concertation relative à la revalorisation des enseignants, qui devrait se conclure dans les prochaines semaines, ainsi que la stratégie du numérique pour l'éducation, à laquelle l'APVF a contribué.
L'APVF était représentée par Jean-Michel Morer, maire de Trilport, en qualité de référent aux questions d'éducation.
Télécharger le guide de dépôt de projet du CNR éducation

Politique de l'Eau : la Cour des Comptes formule des recommandations
Dans le cadre de son rapport annuel, consacré cette année à la décentralisation, la Cour des Comptes a notamment traité la question de la politique de l’eau. Retour sur les principales recommandations formulées par les magistrats de la rue Cambon. Un premier constat est formulé, alors que les situations de stress hydriques vont se multiplier …
Dans le cadre de son rapport annuel, consacré cette année à la décentralisation, la Cour des Comptes a notamment traité la question de la politique de l'eau. Retour sur les principales recommandations formulées par les magistrats de la rue Cambon.
Un premier constat est formulé, alors que les situations de stress hydriques vont se multiplier sous l'effet du changement climatique et que le rechargement des nappes phréatiques est à un niveau historiquement bas : "l'insuffisance de la ressource et l'intensification des usages de l'eau, dont la consommation augmente dans de nombreux territoires depuis 2017, exacerbent les conflits d'usage".
Pour la Cour des comptes, "l'efficacité de la politique de l'eau souffre de la complexité et du manque de lisibilité de son organisation, laquelle doit être structurée et clarifiée autour du périmètre des sous-bassins versants"
Le rapport met en exergue que "l'inadéquation entre les circonscriptions administratives et la géographie des bassins et sous-bassins oblige l'Etat et les collectivités locales à mettre en place de nombreuses instances de coordination" ce qui "accentue la complexité de la gouvernance de la politique de l'eau et facilite pas sa déclinaison sur le terrain dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et de la gestion de l'eau (SDAGE)
Ainsi, est mise en cause "une organisation peu lisible" du système de gestion de l'eau en France avec une articulation Etat-collectivités territoriales pouvant être améliorée.
En outre, la Cour souligne l'existence de priorités différentes entre les trois ministères compétents sur la question (écologie, santé, et agriculture) et indique que "leurs divergences n'ont jamais été véritablement surmontées".
Sur les instances de concertation avec les citoyens, comme les commissions locales de l'eau, il est mis en avant qu'"elles manquent en outre souvent de moyens pour exercer leurs missions"
Dès lors, la Cour conclut en indiquant que "l'intrication des responsabilités de l'Etat et des collectivités territoriales nuit à l'efficacité de la politique de gestion de l'eau". Elle considère que "sa mise en œuvre depuis 1964 a certes permis d'assurer l'alimentation en eau potable de la population et de réduire une partie de la pollution des milieux aquatiques mais elle ne permettra pas d'atteindre l'objectif d'une restauration du bon état des masses d'eau en 2027, échéance fixée à l'échelle européenne".
Les auteurs du rapport plaident ainsi pour "une décentralisation plus effective des compétences" qui "permettrait de renforcer la responsabilité des différents intervenants dans la gestion de cette politique publique essentielle et d'en améliorer l'intelligibilité pour le grand public".

3 questions à Pierre Guelman, Directeur des Affaires publiques d'Enedis
Pierre Guelman, Directeur des affaires publiques d’Enedis, revient pour la lettre hebdomadaire des petites villes sur les derniers dispositifs mis à disposition des collectivités par le gestionnaire de réseau public afin de les accompagner dans la transition énergétique. 1) Enedis vient de lancer à la fin du mois de novembre 2022 son nouveau portail …
Pierre Guelman, Directeur des affaires publiques d'Enedis, revient pour la lettre hebdomadaire des petites villes sur les derniers dispositifs mis à disposition des collectivités par le gestionnaire de réseau public afin de les accompagner dans la transition énergétique.
1) Enedis vient de lancer à la fin du mois de novembre 2022 son nouveau portail à destination des collectivités, pouvez-vous revenir sur cet outil et ses fonctionnalités ?
Le nouveau portail est un point d’entrée unique, destiné aux collectivités. Cet outil numérique, en « selfcare », permet à une collectivité, le plus souvent en 1 clic, de connaitre et de comparer les consommations électriques de ses différents sites, par type d’usage (EP, écoles, gymnases, etc.)
Grâce au nouveau portail, une collectivité peut également connaitre les capacités disponibles sur le réseau public de distribution ou encore simuler le raccordement d’un projet de faible puissance.
Enfin, le portail permet de disposer d’informations quant aux indisponibilités du réseau public sur incidents ou du fait de travaux.
2) Comment s’articule-t-il avec les autres outils déjà mis à disposition des collectivités par Enedis comme « Mon éclairage public » ou bien encore Prioréno (en partenariat avec La Banque des Territoires et GRDF) ?
En 2050, l’électricité représentera environ 55% de la consommation nationale. Afin de relever cet immense défi, Enedis investira 96 Md€ d’ici à 2040 pour que le réseau public de distribution français soit moderne, robuste et toujours de mieux en mieux connecté. Ainsi, la Nouvelle France Electrique, plus sobre, va-t-elle intégrer davantage d’EnR, tout en soutenant l’essor de la mobilité électrique.
Cette mobilisation financière s’accompagne dans le même temps du déploiement de solutions très concrètes et opérationnelles au service des collectivités.
Aussi, en complément du nouveau portail, d’autres outils sont développés. Ils visent à accompagner les collectivités sur l’optimisation de l’éclairage public, souvent le second poste de dépenses des petites communes. Ils permettent aussi de fournir des cartes interactives avec des données foncières et de consommation électricité et gaz, aidant les décisions de rénovation énergétique (solution « Prioréno » en partenariat avec la Banque des territoires et GRDF). Ils facilitent les diagnostics sur la précarité à partir des suivis de nos déplacements pour coupure ou réduction de puissance. Ils visent encore à aider la planification de l’emplacement de bornes de recharge dans le cadre d’un Schéma Directeur des mobilités. Enfin, et sans être exhaustif, ils sont au service du déploiement de plus en plus significatif de projets d’autoconsommation collective sur tous les territoires.
3) La loi relative à l’accélération des énergies renouvelables vient d’être définitivement adoptée par le Parlement et donne un rôle déterminant aux maires, comment Enedis entend-il continuer à accompagner les élus des petites villes dans la transition écologique ?
La loi promulguée le 11 mars dernier est un signal fort en faveur d’un mix énergétique , qui fera de plus en plus de place aux énergies décarbonnées. Cette loi illustre particulièrement le rôle central du gestionnaire de réseau public Enedis dans la mise en œuvre et le déploiement des EnR
Une série de mesures sont ainsi prévues pour accélérer le développement des énergies renouvelables : renforcement des obligations de solarisation des parkings, des bâtiments, des copropriétés, définition de l’agrivoltaïsme. Couplées à une réduction des délais légaux de raccordement, elles seront de nature à poursuivre la dynamique d’amplification du rythme et des volumes de raccordements assurés par Enedis.
Par ailleurs, pour permettre l’élaboration des futures zones d’accélération des EnR, Enedis mettra à disposition des communes, EPCI, Comités régionaux de l’énergie, etc. des données sur le potentiel disponible pour les énergies renouvelables, la part prise par chaque EPCI sur le déploiement des EnR ainsi que les capacités existantes sur le réseau public de distribution, et planifiées à cet usage (en vertu des S3REnR).
Ces différents accompagnements viennent en complément de l’ensemble des solutions évoquées ci-avant.
Retrouvez l'enquête commune APVF-Enedis consacrée à l'autoconsommation collective dans les petites villes en cliquant ici
Pour vous inscrire au webinaire du 6 avril dédié à ce sujet cliquez ici

Réforme des institutions : le Président de l’APVF reçu par le Président de la République
Le Président de la République a reçu les Présidents d’associations d’élus pour évoquer la réforme des institutions que projette le Chef de l’Etat. L’APVF était représentée par son Président Christophe Bouillon. Il s’agissait d’une première réunion de méthode portant tout particulièrement sur la décentralisation. Le constat est clair : la décentralisation est restée en milieu du …
Le Président de la République a reçu les Présidents d’associations d’élus pour évoquer la réforme des institutions que projette le Chef de l’Etat. L’APVF était représentée par son Président Christophe Bouillon.
Il s’agissait d’une première réunion de méthode portant tout particulièrement sur la décentralisation.
Le constat est clair : la décentralisation est restée en milieu du gué. Le Président de la République a exposé ses attentes : plus de clarté dans les compétences et plus d’efficacité dans l’action publique locale. Il s’agit donc d’évaluer si de nouvelles compétences doivent être transférées et avec quels moyens juridiques et financiers.
Durant son intervention, le Président de l’APVF a insisté sur le besoin de proximité dans la prise de décision. Il a mis l’accent sur l’inflation normative qui ralentit, voire paralyse, l’action publique locale. Il a souhaité davantage d’autonomie financière et fiscale ainsi que plus de visibilité dans les relations financières entre l’Etat et les collectivités locales.
Il a également souhaité que les réformes à venir abordent la question de la déconcentration : les petites villes ont besoin d’un Etat fort dans les territoires. C’est la condition première d’un meilleur fonctionnement des services publics. Il a formulé de son souhait que la réforme des institutions soit utile pour nos concitoyens et permette une nouvelle efficacité de l’action publique locale.
