ESPACE MEMBRE

"Refaire de l'industrie un projet de territoire"
La Fabrique de l’Industrie publie un rapport intitulé “Refaire de l’industrie un projet de territoire”. A l’heure où le mot de “réindustrialisation” est sur toutes les lèvres, l’économiste Caroline Granier montre toute l’importance du “facteur local” dans les succès industriels. L’étude menée par la Fabrique de l’Industrie part d’un constat : il est très difficile …
La Fabrique de l'Industrie publie un rapport intitulé "Refaire de l'industrie un projet de territoire". A l'heure où le mot de "réindustrialisation" est sur toutes les lèvres, l'économiste Caroline Granier montre toute l'importance du "facteur local" dans les succès industriels.
L'étude menée par la Fabrique de l'Industrie part d'un constat : il est très difficile d'expliquer les trajectoires industrielles de tel ou tel territoire. Mais le facteur local est toujours déterminant dans ces trajectoires.
L'économiste Caroline Granier a mené une étude approfondie dans quatre territoires : Angoulême-Cognac, Alsace
centrale, Nord Poitou et Seine Aval-Mantes. L'auteure y démontre "l'absence de déterminisme industriel". Elle y étudie l'agencement spécifique des "conditions de base, une structure industrielle et des comportements d’acteurs, qui contribuent" à la performance des territoires.
Une partie de l'étude est consacrée à la description des dispositifs pour "construite ou régénérer un territoire industriel". On y constate que les initiatives ne peuvent demeurer purement locales.
Plus qu'un vade mecum pour disposer de l'ensemble des "ficelles" pour assurer la réindustrialisation de son territoire, cette étude donne à voir une multitude d'exemples très concrets d'initiatives, de modèles de gouvernance, qui, s'ils ne peuvent pas être reproduits à l'identique, pourront du moins inviter à l'émulation.
Télécharger l'étude "Refaire de l'industrie un projet de territoire" de la Fabrique de l'Industrie
Pour plus d'informations, vous pouvez également retrouver le très bon article réalisé par Localtis

Lancement du Conseil national du commerce
Le Conseil national du commerce a été lancé le 25 avril dernier. Son objectif : répondre aux défis du commerce de demain. “L’industrie est essentielle à notre souveraineté, le commerce est essentiel à notre société”. C’est en se fondant sur ce principe que le gouvernement a lancé le Conseil national du commerce. Pendant du Conseil …
Le Conseil national du commerce a été lancé le 25 avril dernier. Son objectif : répondre aux défis du commerce de demain.
"L'industrie est essentielle à notre souveraineté, le commerce est essentiel à notre société". C'est en se fondant sur ce principe que le gouvernement a lancé le Conseil national du commerce. Pendant du Conseil national de l'industrie, le Conseil National du Commerce se donne pour objectif d’accompagner le commerce dans les défis de demain.
Quatre grands défis
Quatre grands défis sont identifiés.
Le premier est celui de la transition écologique. En effet, le décret tertiaire impose une amélioration considérable de l'efficacité énergétique. Les magasins devront ainsi diminuer de 40% leur consommation énergétique d'ici 2030.
Le deuxième défi identifié par le gouvernement est celui de la compétitivité. De nombreux magasins sont, depuis les années 2010, frappées par des problèmes de surcapacité. Les mutations liées au numérique ont également profondément modifié la nature du métier de commerçant.
Le troisième défi est le défi de synergies avec l'industrie. Le commerce est en effet un des débouchés de l'industrie. A l'heure où la réindustrialisation est érigée en priorité par le gouvernement, de nouveaux champs d'interaction apparaissent, comme dans les domaines de la production, de la construction, de l'énergie ou encore de la fabrique de la cité.
Enfin, le dernier défi est celui des compétences. Ces compétences doivent notamment s'adapter à la nouvelle donne numérique et environnementale.
Deux objectifs
Pour réponde à ces enjeux, le Conseil National du Commerce se donne deux objectifs :
→ Traiter les enjeux concrets auxquels les commerçants sont confrontés quotidiennement ;
→ Anticiper pour préparer dès aujourd’hui le commerce de demain .

Infos Cyber du mois : attention aux hameçonnages !
Dans le cadre de sa nouvelle rubrique « Infos Cyber du mois , réalisée en partenariat avec le dispositif cybermalveillance.gouv.fr, l’APVF vous propose ce mois-ci d’en apprendre davantage sur l’hameçonnage, principal mode opératoire utilisé par les cybercriminels pour dérober des informations personnelles. Qu’est-ce que l’hameçonnage/ le phishing ? Comment l’identifier et s’en prémunir ? Que faire si votre …
Dans le cadre de sa nouvelle rubrique « Infos Cyber du mois , réalisée en partenariat avec le dispositif cybermalveillance.gouv.fr, l’APVF vous propose ce mois-ci d’en apprendre davantage sur l’hameçonnage, principal mode opératoire utilisé par les cybercriminels pour dérober des informations personnelles.
Qu’est-ce que l’hameçonnage/ le phishing ? Comment l’identifier et s’en prémunir ? Que faire si votre collectivité en est victime ? Quelles infractions peuvent-être retenues contre leurs auteurs ?
Les réponses à toutes ces questions sont accessibles dans ce dossier complet
Vous avez moins de 2 minutes ? Grâce à cette fiche mémo et cette fiche réflexe, accédez en coup d’œil aux infos à retenir
Vous pouvez également tester également vos connaissances sur ce sujet en jouant à ce quizz

Présentation des priorités du gouvernement par la Première Ministre : Elisabeth Borne annonce la réunion chaque trimestre d’une conférence des exécutifs locaux
Le mercredi 26 avril, la Première Ministre, Elisabeth Borne, a présenté le plan d’action du gouvernement pour les cents jours à venir. En plus d’avoir annoncé, faute d’actuel consensus politique au Parlement, le report pour l’automne de la présentation du projet de loi immigration, la Première Ministre a également présenté ses différents chantiers pour les …
Le mercredi 26 avril, la Première Ministre, Elisabeth Borne, a présenté le plan d’action du gouvernement pour les cents jours à venir. En plus d’avoir annoncé, faute d’actuel consensus politique au Parlement, le report pour l’automne de la présentation du projet de loi immigration, la Première Ministre a également présenté ses différents chantiers pour les prochaines semaines. Transports, santé, industrie ou encore logement : retour sur la feuille de route qui prévoit notamment la création de conférences des exécutifs locaux que l’APVF appelait de ses vœux.
Durant ses quinze minutes d’allocution, la Première ministre a fixé quatre priorités pour le gouvernement : l’atteinte du plein emploi et la réindustrialisation, l’accélération de la transition écologique, la refonte des services publics ainsi que le renforcement de l’ordre républicain. La cheffe du gouvernement a également insisté sur sa volonté d’associer les collectivités territoriales à ces différents chantiers, en revenant notamment sur l’Agenda territorial qui avait été présenté aux associations d’élus le 12 avril dernier.
Transition écologique
En matière de transition écologique tout d’abord, le gouvernement présentera durant le mois de juin sa « vision d’ensemble » qui sera articulée autour d’un projet de programmation pluriannuelle de l’énergie, d’un projet de stratégie nationale bas-carbone et d’un projet de stratégie nationale biodiversité.
C'est seulement dans un deuxième temps, à l'automne, que sera présenté le projet de loi de programmation énergie-climat qui impliquera des échanges avec les territoires et les filières économiques. Elisabeth Borne a souligné que « c'est avec les collectivités que nous voulons travailler pour adapter les leviers à la réalité de chaque bassin de vie (…), pour simplifier les procédures et débloquer les financements ».
La Première ministre a aussi souligné que le « travail spécifique avec les collectivités » portera sur les « budgets verts et la pérennisation du Fonds vert » dont les modalités « restent à définir ».
De plus, après le plan eau, place aux forêts : « une proposition de loi d’ores et déjà adoptée au Sénat, sur la prévention des feux de forêt sera discutée à l’Assemblée nationale à partir du 15 mai ». Le parcours du projet de loi Nucléaire devrait aussi bientôt s'achever, avec une commission mixte paritaire prévue le 04 mai. A noter également que la labellisation des professionnels pour le dispositif « Mon accompagnateur Rénov » devrait, quant à elle, commencer à partir de mai via l'Anah.
Parmi les annonces concernant l’aménagement, le sujet délicat du ZAN a aussi été rappelé par la Première Ministre qui a réaffirmé sa volonté de trouver « d'ici l'été » un « meilleur dispositif de territorialisation ».
Santé
En matière de santé et de lutte contre les déserts médicaux, la feuille de route reprend une grande partie des objectifs déjà énoncés par le Président de la République et évoqués lors des CNR territoriaux, qu’il s’agisse de la coopération entre professionnels, de la délégation de tâches, de l’attractivité de l'hôpital, de la prévention ou encore da la création de nouvelles places d'infirmières.
Elisabeth Borne a exprimé son souhait de donner « plus de libertés » aux acteurs locaux : « j’ai annoncé récemment que les Agences régionales de santé pourraient déroger aux règles nationales, quand les situations locales l’imposaient ».
Sur le plan législatif, l’exécutif se réfère à la proposition de loi du député Frédéric Valletoux (Horizons) « relative à la santé et aux territoires » qui devrait être examinée au mois de juin.
Sur le plan social, la feuille de route évoque le Pacte des solidarités et le déploiement de la « garantie d’accueil du jeune enfant » pour 2024, sans détailler davantage.
Industrie
Pour réindustrialiser l’hexagone, Matignon mise sur le projet de loi industrie verte qui sera présenté en Conseil des ministres à la mi-mai et débattu au Parlement durant l’été. Le gouvernement souhaite également « relancer » le programme Territoires d’industrie pour y « intégrer de nouvelles priorités » (sobriété foncière notamment) et l’ « adapter à de nouvelles politiques, comme France 2030 ». L’exécutif aussi a précisé la finalisation en juin de la feuille de route de « décarbonation des grandes filières industrielles et des 50 sites les plus émetteurs ».
La suppression complète, étalée sur deux ans, de la CVAE votée en loi de finances pour 2023 est également au programme des trois prochains mois. Le gouvernement insiste sur le fait qu'il sera tenu compte de la « dynamique » de la TVA prévue en compensation, ceci « à travers un fonds national d’attractivité économique des territoires » et que les critères possibles de répartition seront « concertés avec les associations d’élus et arrêtés en amont du prochain PLF ».
En outre, la feuille de route prévoit la réunion, en juin, d’un Conseil national de l'industrie afin de valider la stratégie hydrogène. Au second semestre, se poursuivra également la négociation du règlement européen sur la réforme du marché de l’électricité.
Logement
Autre point à l’agenda : le logement. En plus des négociations en cours sur la décentralisation de cette compétence, l’exécutif souhaite travailler avec les collectivités pour augmenter le nombre de logements en zone tendue et baisser les coûts du foncier et les coûts de la construction. La Caisse des Dépôts devrait également être mobilisée pour racheter les logements neufs qui ne trouvent pas d’acquéreurs. Matignon en appelle aussi au secteur bancaire « pour améliorer l’accès au crédit des ménages » et « donner de la visibilité sur l’évolution du prêt à taux zéro ».
Afin de relancer la construction de logements sociaux, le gouvernement souhaite aussi finaliser les négociations avec les bailleurs sociaux sur le « pacte de confiance HLM » avant le prochain congrès HLM d’octobre 2023.
Sur la rénovation thermique des logements, la Première ministre a annoncé un accompagnement personnalisé ainsi que l’ouverture de guichets « France Renov » avec l’objectif d’un guichet par intercommunalité.
S'agissant de l’adaptation des logements aux seniors, une plateforme unique d'information sur les aides existantes devrait ouvrir en septembre et le dispositif « Ma Prime’adapt » devrait être lancé en 2024.
Mobilités
La feuille de route aborde également la question des transports. Fin février, le gouvernement avait suscité de fortes attentes en annonçant 100 milliards d’euros pour le ferroviaire, d’ici à 2040, dans le cadre de son plan d’avenir pour les transports. Elisabeth Borne a ainsi rappelé que cette « nouvelle donne ferroviaire » serait menée avec les régions et les collectivités concernées. Les mandats du volet transport des Contrats de Plan Etat-régions (CPER) seront ainsi adressés aux préfets d'ici fin avril pour être négociés sous trois mois. Très attendue par les collectivités, la « trajectoire d'investissement » devrait, quant à elle, être annoncée cet été suite aux discussions menées avec les collectivités dans le cadre de l'Agenda territorial.
La proposition de loi élargissant les missions de la Société du Grand Paris pour accélérer le déploiement des « services express métropolitains » a également été mentionnée sans davantage de précisions concernant le calendrier. Enfin, un Comité interministériel du vélo est prévu pour mai.
Sécurité
En matière de sécurité, la feuille de route confirme le déploiement de 200 nouvelles brigades de gendarmerie dans les territoires. « Nous allons continuer la montée en puissance des moyens de nos forces de l’ordre, ouvrir 200 nouvelles brigades de gendarmerie, et déployer une « force d’action républicaine » » a ainsi résumé la Première Ministre. A noter cependant que le rythme de déploiement de ces brigades, et surtout leur répartition territoriale, ne sont pas encore totalement définis. La sécurité civile a aussi été évoquée, notamment avec un renforcement des capacités des Sdis et le lancement d'un « plan de mobilisation civile ».
Cohésion sociale et territoriale
Le plan « France ruralité » devrait être présenté au printemps et se composera notamment d’un nouveau programme d’ingénierie pour les communes rurales et d’une refonte des zones de revitalisation rurale (ZRR). S’agissant des Maisons France Services, leur nombre devrait être porté à 2 750 d’ici la fin de l’année, la liste des services publics partenaires élargie et les conseillers France Services mieux valorisés. Matignon confirme également le plan « Quartiers 2030 », ainsi que la tenue d’un comité interministériel de la ville en juin et l’organisation d’un comité interministériel des Outre-mer avant l’été. S’agissant de la jeunesse, le gouvernement prévoit un plan d’action, ainsi que l’extension du Service national universel (SNU) dans davantage de territoires, sans généralisation. Enfin, le plan mixité à l’école sera présenté le 11 mai.
Finances publiques
En matière de finances publiques, Elisabeth Borne a rappelé qu’il ne pouvait y « avoir d’ordre républicain sans maîtrise des finances publiques ». Les collectivités territoriales devraient donc être de nouveau être associées à l’effort de redressement des finances publiques. Devant les associations d’élus, la Première Ministre s’est cependant engagée sur le fait qu’aucun mécanisme de sanction ne devrait rétabli.
Enfin, parmi les annonces de la cheffe du Gouvernement, l’APVF salue la réunion trimestrielle d’une conférence des exécutifs locaux qui réunira l’ensemble des Présidents d’association d’élus. Cette conférence sera le cadre commun pour suivre le déploiement de l’ensemble de l’Agenda territorial formalisé avec les associations d’élus. Il s’agit d’une demande ancienne de l’APVF, très attachée depuis toujours à la pérennisation des modes de concertation entre l’Etat et les collectivités territoriales.
Ainsi, même si certaines demandes de l’APVF ont été entendues par Matignon, les Maires des Petites Villes suivront avec attention les suites données à cette feuille de route, particulièrement en matière de financement de la transition écologique.
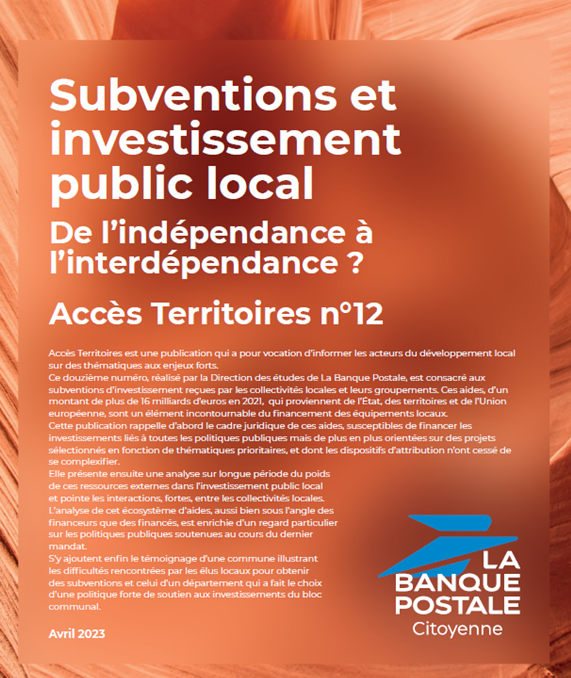
Subventions et investissement public local De l’indépendance à l’interdépendance ?
La dernière étude de la Direction des études de La Banque Postale est consacrée aux subventions d’investissement reçues par les collectivités locales et leurs groupements. Après un rappel de l’évolution du cadre juridique de ces aides, notamment leur complexification et leur fléchage accru, l’étude analyse cet écosystème sous tous ses angles et tente d’illustrer les …
La dernière étude de la Direction des études de La Banque Postale est consacrée aux subventions d’investissement reçues par les collectivités locales et leurs groupements. Après un rappel de l’évolution du cadre juridique de ces aides, notamment leur complexification et leur fléchage accru, l’étude analyse cet écosystème sous tous ses angles et tente d’illustrer les difficultés rencontrées par certains élus locaux pour obtenir ces financements.
16 milliards d’euros de subventions, dont 6 % au titre des dotations d’équipement de l’Etat (DSIL/DETR…) :
Les subventions d’investissement reçues par les collectivités locales et leurs groupements s'élevaient en 2021 à 16,6 milliards d’euros. Dans le détail, 21 % de ces financements proviennent du FCTVA, 19 % des subventions des collectivités elles-mêmes, 15 % de celles de l’Etat et 9 % de celles de l’UE. A cela s'ajoutent notamment les dotations d’équipements de l'Etat (DETR, DSIL…) qui représentent 6 % des financements externes.
L’étude relève que, depuis 2010, les subventions en provenance de l’État ont progressé et sont restées les plus importantes (4,3 milliards d’euros en 2010 et 6,1 milliards d’euros en 2021).
Une certaine recentralisation de ces aides :
Si la structure du panier de ressources des communes a, dans l’ensemble, été peu modifiée, l’étude montre que le changement le plus prégnant est la hausse de la part étatique, qui il y a 30 ans était inférieure à celle des départements. Ces derniers se sont donc « progressivement dégagés de leur rôle de premiers financeurs des communes au profit de l’État, marquant une tendance à une certaine recentralisation des aides ».
Dans le détail, l’État et les régions subventionnent davantage les projets des groupements à fiscalité propre, alors que les départements privilégient les communes. Mais l’État reste bien le plus gros financeur des communes en amenant 6,9 % du montant des subventions, sur la période 2015 à 2021, suivi par les départements à hauteur de 5,8 %, puis par les régions (3,2 %).
La Banque Postale s’inquiète de la décroissance de la part du soutien régional et départemental, illustrant le phénomène d’interdépendance financière existant entre les différents niveaux de collectivités locales. En période d’accroissement de la contrainte budgétaire, on constate une diminution du soutien financiers des départements aux communes par exemple (ce fût le cas entre 2010 et 2017 sans discontinuité).
Un fléchage de plus en plus marqué :
Comme explique La Banque Postale, si ces aides permettent d’inciter et de favoriser l’investissement local, en particulier dans les plus petites communes, elles sont aussi et de plus en plus un outil d’orientation des investissements en faveur de projets ciblés, qui varient en fonction des priorités annuelles définies au niveau national, telle que la transition énergétique.
Comme l’ensemble des dotations d’investissement, la DSIL suit une logique de subventions sur projets sélectionnés par le préfet de région ou de département, ce qui permet de mieux concentrer l’emploi des crédits de l’État. Il en va de même pour la DETR, bien que pour cette dernière l’intervention d’une commission consultative d’élus est également prévue en amont.
Même s’il permet de faire converger les stratégies d’investissement de l’État et des collectivités, ce fléchage de plus en plus marqué des dotations « peut nuire à la capacité d’action des collectivités dont les priorités peuvent en différer, notamment en raison des caractéristiques économiques et sociales de leur territoire ».
Leur gestion étant déconcentrée, il revient ainsi au préfet d’adapter au mieux l’attribution de leurs crédits aux spécificités locales.
Téléchargez l'étude complète en cliquant ici.

Sécheresses de l'été 2022 : publication d'un rapport interministériel
Un rapport interministériel qui se penche sur la gestion des épisodes de sécheresse lors de l’été 2022 a été publié le 12 avril, deux semaines après la présentation du Plan Eau par le Président de la République. Retour sur les principaux enseignements. Pour rappel, le Président de la République a présenté le plan Eau lors …
Un rapport interministériel qui se penche sur la gestion des épisodes de sécheresse lors de l'été 2022 a été publié le 12 avril, deux semaines après la présentation du Plan Eau par le Président de la République. Retour sur les principaux enseignements.
Pour rappel, le Président de la République a présenté le plan Eau lors d'un déplacement le 30 mars à Savines-le-Lac (Hautes-Alpes).
Ce rapport était l'objet d'une commande en provenance de 4 ministères différents : Intérieur, Transition Ecologique, Santé, et Agriculture.
Il a été rédigé par l'Inspection générale de l'administration (IGA), l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD - qui a pris la suite au 1er septembre 2022 du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) qui était chargé de conseiller le gouvernement sur les politiques environnementales), et Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture, et des espaces ruraux (CGAAER).
La situation est ainsi résumée : "Le pire a été évité lors de la gestion de la sécheresse 2022 grâce d’une part à la mobilisation exceptionnelle de l'ensemble des acteurs, et d’autre part à un niveau de remplissage élevé des nappes et des retenues à la sortie de l’hiver 2021-2022. De telles conditions pourraient ne plus être réunies si un phénomène similaire se reproduisait dans les prochaines années, voire dès 2023". En outre, il est mis en exergue que la sécheresse de 2022 a été "la plus sévère depuis au moins un demi-siècle, conjuguant déficit de précipitations et températures records".
En effet, plus d’un millier de communes avaient ainsi dû mettre en place des mesures exceptionnelles pour assurer l'approvisionnement de leurs habitants. 343 avaient dû transporter de l’eau par camion, et 196 distribuer des bouteilles d’eau, ne pouvant plus fournir d’eau du robinet.
Pour les auteurs du rapport "la gestion de crise ne pourra pas garantir dans la durée le maintien des usages actuels". Il est également avancé que "l’eau est encore trop fréquemment considérée comme une ressource inépuisable et gratuite".
Ainsi le constat suivant est réalisé : "seules des politiques de transformation (…) permettront d’éviter les ruptures brutales".
Le rapport formule 18 recommandations, dont certaines sont reprises dans le Plan Eau comme l'Ecowatt de l'eau ou des mesures relatives à la réutilisation des eaux usées, structurées autour de trois axes :
- Améliorer l'anticipation et la gestion pluriannuelle des épisodes de sécheresse
- Connaître en temps réel les impacts et les réduire
- Objectiver les enjeux de partage et prévenir les conflits d'usage de l'eau
A noter que concernant les objectifs de sobriété il est proposé "d'élaborer en concertation avec les représentants nationaux de chaque usage de l’eau, des déclinaisons sectorielles et territoriales — lorsque c’est plus pertinent — de l’objectif de réduction des prélèvements d’eau fixé en juillet 2019 dans le cadre des Assises de l’eau : – 10 % d'ici 2024 et – 25 % d'ici2034 ainsi que les plans d’action correspondants". Dans le cadre du Plan Eau l'objectif de réduction des prélèvements de 10% a été reporté à 2030 et l'objectif de réduction de 25% d'ici 2034 n'a pas été repris.
Pour télécharger le rapport cliquez ici

Les élus locaux disent non à la "fausse consigne" et font des propositions alternatives
Les associations de collectivités ont organisé une conférence de presse le mardi 18 avril après-midi afin d’expliquer leur opposition au projet de “fausse consigne” pour le recyclage des bouteilles en plastiques et pour dévoiler leur propositions pour lutter contre la pollution des emballages plastiques. Daniel Cornalba, Maire de L’Etang-la-Ville (78) et membre du Bureau, y …
Les associations de collectivités ont organisé une conférence de presse le mardi 18 avril après-midi afin d'expliquer leur opposition au projet de "fausse consigne" pour le recyclage des bouteilles en plastiques et pour dévoiler leur propositions pour lutter contre la pollution des emballages plastiques. Daniel Cornalba, Maire de L'Etang-la-Ville (78) et membre du Bureau, y représentait l'APVF.
Alors que la concertation nationale autour de la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique, lancée par le Gouvernement le 30 janvier dernier, se poursuit, les associations de collectivités réaffirment collectivement leur opposition ferme à un projet dont les conséquences seraient contreproductives, tant du point de vue environnemental, économique, que social.
À trois mois de la décision finale prévue en juin, et de manière inédite, l’AMF, Intercommunalités de France, AMORCE, l’ADF, l’AMRF, l’ANPP, l’APVF, le Cercle National du Recyclage, France urbaine et Villes de France unissent leurs forces afin de travailler sur des propositions communes et faire front uni contre ce projet de fausse consigne, qui serait non pas pour réemploi mais pour recyclage.
Contreproductive, cette fausse consigne n’aurait d’autre conséquence que de complexifier le geste de tri pour les citoyens, et d’encourager indirectement la consommation de bouteilles en plastique, ce qui irait à rebours du sens de l’histoire à l’heure où le G7 se fixe enfin des premières ambitions de lutte contre la pollution.
Les seuls bénéficiaires seraient les producteurs pour un gain estimé de plusieurs centaines de millions d’euros par an.
Les échanges issus des différentes réunions de ce groupe de travail ont abouti sur 14 propositions alternatives permettant de remplir les objectifs de collecte et recyclage des bouteilles en plastique, tout en préservant le service public de gestion des déchets et le geste de tri, mais également en dépassant le seul sujet de ces bouteilles.
Ces propositions alternatives visent à atteindre, certes, l’objectif spécifique de 90 % de collecte pour recyclage des bouteilles pour boisson en plastique (315 000 tonnes par an), mais surtout de réduire massivement la pollution induite par l’ensemble des déchets plastiques (5 millions de tonnes) et enfin d’atteindre les principaux objectifs de la France en matière d’économie circulaire sur les déchets ménagers (38 millions de tonnes).
Les élus locaux, représentés par leurs dix associations représentatives, resteront mobilisés tout au long de la concertation afin de porter haut et fort leur opposition à la fausse consigne, et leurs propositions pour un service public de gestion des déchets ambitieux et efficace, notamment à l’occasion des concertations régionales sur le sujet dans les semaines à venir où ils feront entendre la voix des territoires.
Télécharger le communiqué de presse
Télécharger le dossier de presse
Télécharger les 14 propositions

3 questions au général Marc Boget
L’APVF pose cette semaine 3 questions au Général de division Marc Boget, commandant de la Gendarmerie dans le cyberespace pour fait le point sur les menaces et les réponses à apporter au risque cyber dans les petites villes. 1. Vous êtes à la tête du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, le ComCyberGend, créé …
L'APVF pose cette semaine 3 questions au Général de division Marc Boget, commandant de la Gendarmerie dans le cyberespace pour fait le point sur les menaces et les réponses à apporter au risque cyber dans les petites villes.
1. Vous êtes à la tête du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, le ComCyberGend, créé en 2021. Pourquoi avoir mis en place ce commandement et quelles sont ses missions ?
Sous l’autorité du DGGN et des magistrats, en liaison étroite avec les autres administrations, le COMCYBERGEND anime et coordonne la politique nationale cyber de la gendarmerie depuis août 2021. Il incarne la composante numérique que toute mission de la gendarmerie comporte désormais, pour répondre « en tout lieu, en tout temps » aux menaces numériques grandissantes. Quatre lignes force le guident : simplification ; performance ; lisibilité et cohérence. Grâce à sa chaine cyber (actifs + réservistes),il assure la coordination et la stratégie, tant dans le domaine de la prévention que dans celui de la répression sur tout le spectre de la délinquance. Il veille en outre les espaces numériques et renseigne, notamment à travers son centre d'analyse et de regroupement des cybermenaces. Il est un des acteurs de la gestion de crise au niveau national (planification d'opérations, task force numérique, conseils de haut niveau), mais aussi local (projection d'experts en appui des échelons opérationnels) grâce aux 9.000 cyber-gendarmes présents partout sur le territoire.
2. Les Petites Villes sont particulièrement ciblées par les cyberattaques. Quelles sont les actions que vous menez auprès des collectivités ? Comment travaillez-vous avec les élus locaux ?
J’ai coutume de dire qu’il ne faut pas se demander si on va se faire attaquer, mais quand… ! Toutes les semaines, mes équipes sont appelées pour aider des collectivités victimes de cyberattaques. Le maître mot aujourd’hui est la sensibilisation qui permet de se préparer à une gestion de crise. Cela passe par des contacts avec les gendarmes, dont le rôle est précisément d’« offrir » cette sécurité « sur-mesure » permettant aux élus locaux d’anticiper. En 2021, mes équipes ont développé IMMUNITÉ cyber, un auto-diagnostic qui photographiait succinctement l’état des lieux de l’entité en matière de cyberdéfense. En 2022, ma division proximité numérique est allée plus loin pour offrir un pré-diagnostic plus poussé accessible à tous : DI@GONAL. Mi-avril 2023, en à peine 4 mois, 845 collectivités dont 14 ultramarines ont été pré-diagnostiquées avec comme résultats, entre autres de constater que 74 % d’entre elles ne possèdent pas de plan de gestion de crise cyber tandis que 53 % déclarent ne pas avoir de référent cybersécurité !
3. Si une collectivité est victime d’une cyberattaque, quels sont les premiers gestes à adopter pour les élus et les techniciens selon vous ?
Comme précisé précédemment, tout est dans la préparation de cette éventualité fortement probable d’une cyberattaque qui intervient souvent par l’erreur d’un des agents qui fait involontairement entrer l’attaquant dans le système… Trois conseils : concevoir un espace de gestion de crise et s’y entrainer au moins une fois par an en y incluant tous les volets notamment la communication interne et externe propre à rassurer ; posséder un réseau secondaire déconnecté du réseau principal sur lequel des sauvegardes du système sont faites régulièrement tout en éprouvant une capacité de fonctionnement dégradé ; appelez nous tout de suite en cas d’attaque avérée, la gendarmerie viendra vous aider à la fois pour vous conseiller sur la gestion de crise, mais aussi et surtout pour mener l’enquête et ainsi mettre fin aux agissements du ou des auteurs, en étroite relation avec les autres acteurs étatiques, les équipes SI et d’éventuelles entreprises de remédiation.

Filet de sécurité : un projet de décret rejeté à l’unanimité par les élus
Le comité des finances locales (CFL) s’est réuni, mardi 18 avril, pour voter l’adoption du projet de décret relatif au filet de sécurité pour faire face à la hausse des prix de l’énergie. Cette version du texte n’a pas convaincu les élus locaux qui ont émis un avis défavorable. Ce décret précise les modalités de …
Le comité des finances locales (CFL) s'est réuni, mardi 18 avril, pour voter l’adoption du projet de décret relatif au filet de sécurité pour faire face à la hausse des prix de l'énergie. Cette version du texte n’a pas convaincu les élus locaux qui ont émis un avis défavorable.
Ce décret précise les modalités de mise en œuvre du filet de sécurité n°2 voté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023. Pour rappel, il vise à limiter l’impact de la hausse des prix de l’énergie. Mais, pour certains élus, notamment Antoine Homé, maire de Wittenheim, Premier vice-président de l’APVF, le décret d’application est bien plus restrictif que ce que prévoit la loi.
Une seule évolution depuis le retrait en février 2023 de la première version du projet de décret
Alors que le Gouvernement avait judicieusement décidé de reporter la présentation d’une première version du projet de décret devant le CFL afin de prolonger la concertation et rediscuter son contenu, la nouvelle version proposée le 18 avril est peu ou prou la même que la précédente.
La seule modification apportée concerne les régions et leur compétence ferroviaire : la part de la hausse de la contribution versée par les régions à SNCF Voyageurs imputable à l’augmentation des coûts de l’énergie sera bien compensée.
Pourtant très critiquée, la nouvelle version maintient l’exclusion du filet de sécurité n°2, les lycées et les collèges dont sont responsables les départements et régions.
Un versement tardif, « au plus tard le 31 juillet 2024 »
Le projet de décret dresse les modalités d’attribution et de versement du filet de sécurité.
La « dotation exceptionnelle » sera versée sous deux conditions rappelées ci-dessous :
- il faudra enregistrer en 2023 une baisse de plus de 15 % de son épargne brute par rapport à l’exercice 2022 du fait du renchérissement des coûts liés à l’énergie ;
- être une collectivité dont le potentiel financier est inférieur au double de la moyenne de leur strate démographique en 2023. Le projet de décret prévoit que le potentiel financier et fiscal par habitant « est celui qui est calculé, au titre de 2023, pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement », dont le détail a été publié le 31 mars dernier.
Le montant de la dotation correspondra à « 50 % de la différence entre l’augmentation des dépenses énergétiques entre 2022 et 2023 et 50 % de l’augmentation des recettes réelles de fonctionnement entre 2022 et 2023 ».
Le projet de décret prévoit que la dotation définitive devra être versée aux collectivités « au plus tard le 31 juillet 2024 ».
Mais, comme pour le filet de sécurité n°1, les collectivités pourront solliciter un acompte égal à 30% de la dotation prévisionnelle avant le 15 octobre 2023, qui pourra « être porté jusqu’à 50 % sur demande de la collectivité » et qui ne pourra par « être inférieur à 1 000 euros ».
Celui-ci sera notifié par les services de l’Etat aux collectivités « au plus tard le 15 novembre 2023 ».
Téléchargez le projet de décret en cliquant ici.
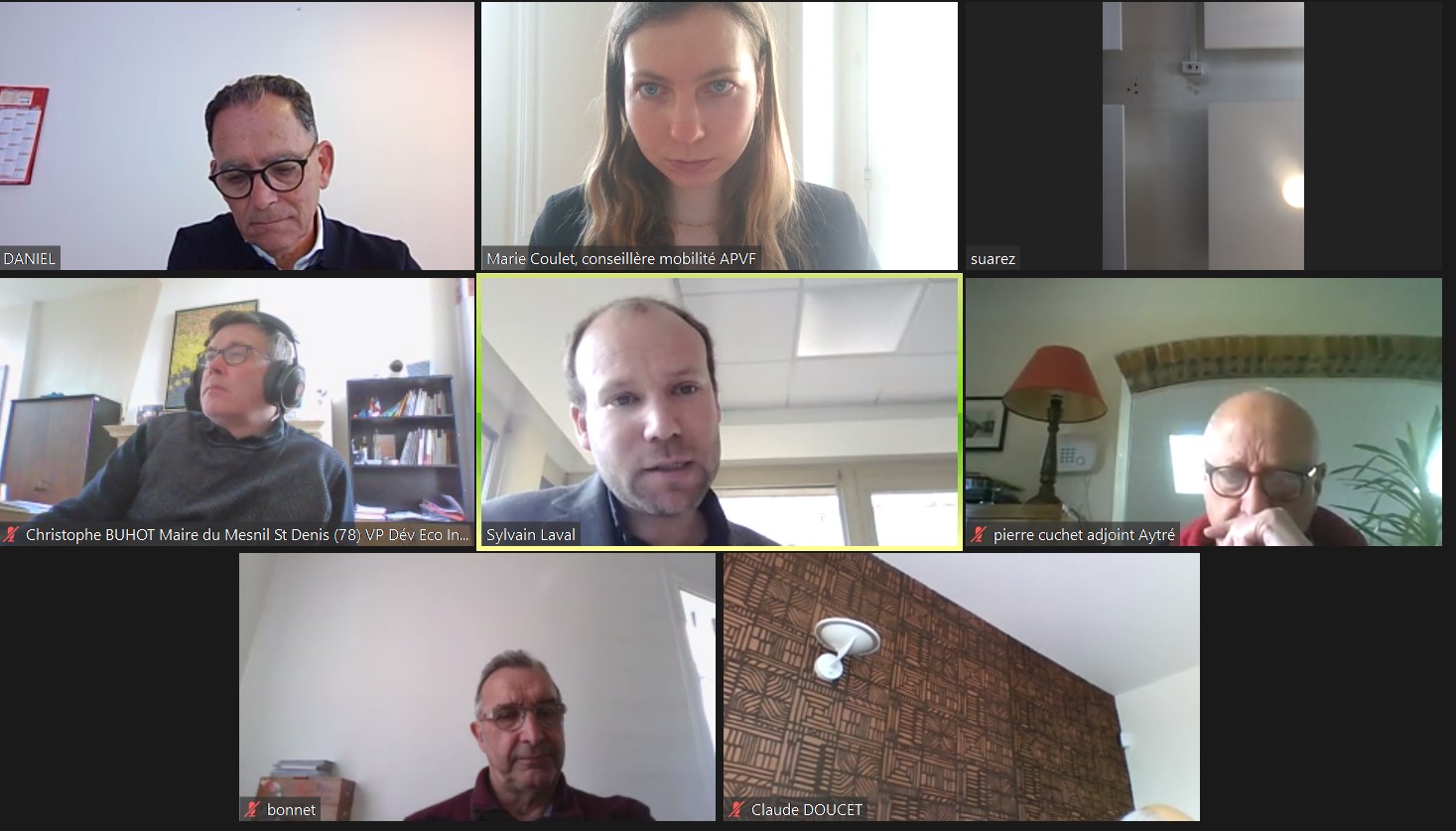
Commission mobilité de l’APVF : les Petites Villes sont particulièrement concernées par le déploiement des ZFE
Le jeudi 13 avril, près d’une trentaine de communes ont participé à la commission mobilité de l’APVF qui était présidée par Sylvain Laval, Maire de Saint-Martin-le-Vinoux, Vice-Président de Grenoble Alpes Métropole, Président du Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire grenobloise et référent mobilité de l’APVF. A l’ordre du jour de cette commission : les enjeux …
Le jeudi 13 avril, près d’une trentaine de communes ont participé à la commission mobilité de l’APVF qui était présidée par Sylvain Laval, Maire de Saint-Martin-le-Vinoux, Vice-Président de Grenoble Alpes Métropole, Président du Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire grenobloise et référent mobilité de l’APVF. A l’ordre du jour de cette commission : les enjeux et les conséquences des déploiements des ZFE pour les Petites Villes et leurs habitants.
Dans ses propos d’introduction, Sylvain Laval a tenu à rappeler que « même si les ZFE sont des outils contribuant à améliorer la qualité de l’air », il est nécessaire de veiller à ce que ces dernières ne renforcent pas les fractures territoriales et sociales : « les enjeux pour les Petites Villes sont certainement plus forts que pour les villes centres, et elles peuvent vivre ce phénomène de façon discriminante. »
Les Maires des Petites Villes ont ensuite pu partager les problématiques et les interrogations rencontrées sur le terrain. Le besoin de développer plus rapidement les transports en commun, la mise en place d’infrastructures intermodales ainsi que la nécessité d’accompagner davantage les ménages les plus précaires ont ainsi été les trois enjeux les plus évoqués.
De nombreux élus locaux ont ainsi alerté sur le manque d’alternatives à l’autosolisme (autocar, train, etc) et d’infrastructures permettant l’intermodalité (parkings relais, parking de covoiturage, etc). En cause notamment : les coûts élevés de déploiement mais aussi les lourdeurs administratives.
Concernant l’accompagnement des ménages les plus en difficulté, mêmes si plusieurs aides existent pour accélérer le renouvellement du parc automobile (bonus-malus écologique, prime à la conversion, nouvelle prime de 1 000 euros pour les personnes vivant en ZFE, aides locales des agglomérations), force est de constater que ces aides restent peu lisibles, difficilement accessibles et insuffisantes.
Le caractère incomplet et discriminatoire du système Crit’Air a également été déploré. En ne prenant pas en compte certains critères comme la qualité d’entretien, la consommation, la puissance ou encore la masse des véhicules, le système Crit’Air aboutit à l’exclusion des véhicules dont le poids et la puissance sont limités : véhicules souvent possédés par des ménages modestes vivant hors des centres urbains.
Enfin, plusieurs participants ont souhaité un renforcement des campagnes de communication et de sensibilisation sur ces sujets, à l’heure où l’acceptabilité sociale des ZFE est particulièrement faible et où l’Etat souhaite la mise en place de contrôles sanctions automatisés dès 2024.
Sylvain Laval a conclu cette commission en rappelant que l’engagement de l’APVF ne faiblirait pas afin que « la voix des élus des Petites Villes continue d’être entendue sur ce sujet ».
