ESPACE MEMBRE

Eolien : candidatez aux Trophées des élus d'Eole !
France Energie Eolienne, partenaire de l’APVF, organise cette année la deuxième édition des Trophées des élus d’Eole. Cette deuxième édition intervient dans un contexte particulier, après le vote par le Oarlement en début d’année de la loi d’accélération des énergies renouvelables qui a fait des élus locaux les co-responsables de la planification et de la …
France Energie Eolienne, partenaire de l’APVF, organise cette année la deuxième édition des Trophées des élus d’Eole.
Cette deuxième édition intervient dans un contexte particulier, après le vote par le Oarlement en début d’année de la loi d’accélération des énergies renouvelables qui a fait des élus locaux les co-responsables de la planification et de la transition énergétique dans les territoires, et à la veille de l’examen de la future loi de programmation énergie climat.
Certains élus précurseurs ont œuvré il y a cinq, dix ou quinze ans pour développer les énergies renouvelables sur leur territoire, associer les citoyens, maximiser les retombées locales et redistribuer les fruits de la transition. Les trophées des élus d’Éole ont été imaginés pour rendre hommage à ces élus et encourager les élus locaux qui se questionnent encore à franchir le pas et à devenir acteurs de la transition.
Les maires et les présidents de Communautés de communes ayant un parc éolien en exploitation sur leur territoire peuvent candidater. Il s'agit d'une occasion pour les élus de valoriser leur territoire lors d'une cérémonie prestigieuse à Paris, en présence de personnalités du monde politique et des médias.
La candidature se fait très simplement, en ligne, jusqu'au 30 septembre 2023, par le biais d'un questionnaire à compléter. Un jury composé d'élus locaux, de personnalités et de partenaires sera chargé d'examiner les candidatures et de sélectionner les maires lauréats.
Pour candidater cliquez ici
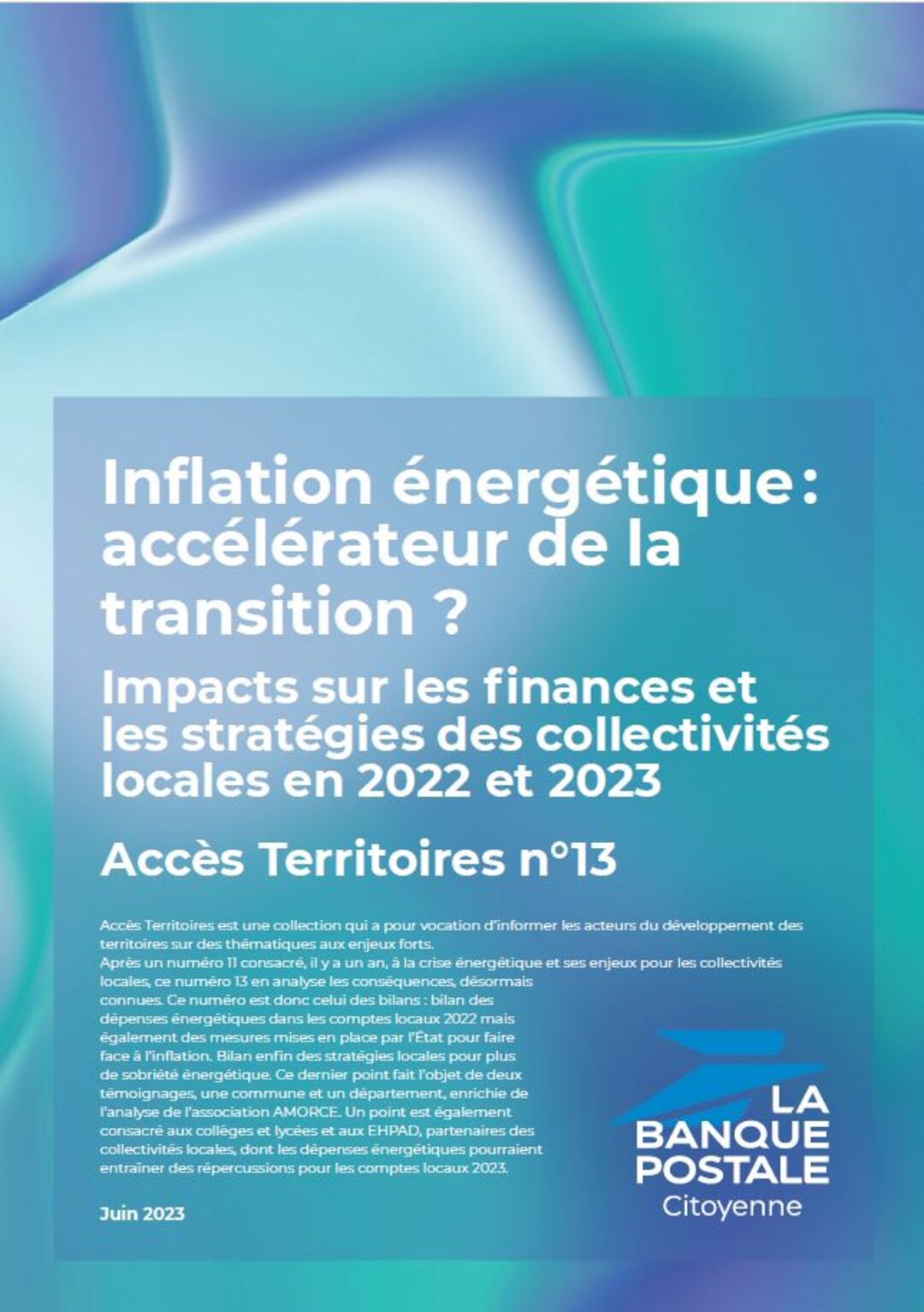
Inflation énergétique : accélérateur de la transition ?
La nouvelle édition d’Accès Territoires (n°13) de La Banque Postale analyse les premières conséquences, désormais connues, de la crise énergétique sur les budgets locaux. Il revient également sur les mesures mises en place par l’État pour faire face à l’inflation et sur les stratégies locales pour plus de sobriété énergétique. Ce dernier point fait l’objet …
La nouvelle édition d’Accès Territoires (n°13) de La Banque Postale analyse les premières conséquences, désormais connues, de la crise énergétique sur les budgets locaux. Il revient également sur les mesures mises en place par l’État pour faire face à l’inflation et sur les stratégies locales pour plus de sobriété énergétique. Ce dernier point fait l’objet de deux témoignages, une commune et un département, enrichis de l’analyse de l’association AMORCE.
En un coup d’œil :
- Les dépenses d’énergie des collectivités locales ont progressé de 27 % entre 2021 et 2022,
- Soit + 1,2 milliard d’euros supplémentaires,
- C’est 50 % de plus que l’augmentation constatée entre 2010 et 2021 (+ 0,8 milliard d’euros).
Lire l’étude complète de La Banque Postale en cliquant ici.

PPL ZAN : les députés modifient le texte du Sénat
Le 27 juin 2023, les députés ont adopté, à une large majorité, la proposition de loi sénatoriale visant à améliorer la mise en œuvre des objectifs de Zéro Artificialisation Nette (ZAN). A l’issue de vifs débats à l’Assemblée – où 621 amendements ont été examinés et 39 adoptés – c’est un bilan en demi-teinte pour …
Le 27 juin 2023, les députés ont adopté, à une large majorité, la proposition de loi sénatoriale visant à améliorer la mise en œuvre des objectifs de Zéro Artificialisation Nette (ZAN). A l’issue de vifs débats à l’Assemblée - où 621 amendements ont été examinés et 39 adoptés - c’est un bilan en demi-teinte pour les élus locaux : même si les députés ont raboté plusieurs dispositions prévues par le Sénat, ils ont également validé certaines mesures importantes.
Une réduction du délai supplémentaire pour adapter les Sraddet : six mois au lieu d’un an
S’agissant du calendrier tout d’abord, les députés ont voté un report de six mois, pour l’intégration de la territorialisation des objectifs du ZAN dans les Sraddet. L’échéance est ainsi portée à août 2024, au lieu de février 2024. Une souplesse de calendrier bienvenue par les maires des Petites Villes même si elle paraît décevante par rapport au texte adopté par le Sénat. Ce dernier proposait en effet un délai supplémentaire d’un an, soit jusqu’à février 2025.
Une suppression du « droit de préemption » sur les espaces propices à la renaturation et au recyclage
Autre source de déception pour les élus locaux : la suppression par les députés du « droit de préemption » portant sur les espaces propices à la renaturation et au recyclage foncier. Cette mesure avait été votée par les sénateurs et encouragée par l’APVF.
Restriction de la « garantie rurale » aux communes peu denses et très peu denses
S’agissant de la garantie rurale, l’article 7 prévoit finalement que les communes classées « peu denses » ou « très peu denses » selon l’INSEE (et dotées d’un PLU, d’une carte communale ou d’un document en tenant lieu avant le 22 août 2026) se verront garantir une surface minimale de 1 hectare de consommation d’espaces naturels agricoles ou forestiers. Le périmètre des communes éligibles à cette garantie rurale a donc été réduit puisque les sénateurs souhaitaient, quant à eux, que toutes les communes puissent en bénéficier.
Au menu des réjouissances cependant : la prise en compte du recul du trait de côté et l’instauration d’un sursis à statuer
Malgré ces déceptions, le texte adopté par le Palais Bourbon a permis de confirmer certaines dispositions souhaitées par les élus locaux. Ainsi, les députés ont validé la prise en compte du recul du trait de côte que l’APVF appelait de ses vœux. L’Assemblée nationale a validé la possibilité de considérer comme désartificialisés des biens situés dans une zone exposée au recul du trait de côte, dès lors que ces derniers ont vocation à être renaturés dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement.
S’agissant de l’instauration d’un « sursis à statuer », les occupants du Palais Bourbon ont voté la possibilité, pour l’autorité compétente en matière de PLU, d’instituer par dérogation dans certaines zones ouvertes à l’urbanisation un périmètre au sein duquel, il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers susceptible de compromettre l’atteinte des objectifs de sobriété foncière durant la première tranche de dix années. Cette mesure est accueillie positivement par les maires des Petites villes qui appelaient à la création d’un « sursis à statuer ZAN ».
Les projets d’intérêt général majeur : un forfait national plutôt qu’une comptabilisation dans les enveloppes régionales d’artificialisation
Sujet à de vifs débats, l’article 4 permet de préciser les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur en dressant une liste de « projets structurants de demain ». Comme le souhaitaient de nombreux maires de Petites Villes, ces projets ne seront pas comptabilisés dans les objectifs fixés par les documents de planification régionale et d’urbanisme. Toutefois, ces derniers seront comptabilisés dans un forfait national fixé à hauteur de 15 000 hectares pour l’ensemble du pays d’ici à 2031 (sur 125 000 hectares artificialisables ).
L’Assemblée nationale a également allongé la liste des projets, en ajoutant par exemple les travaux ou les opérations de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse ou encore les travaux intéressants la défense ou la sécurité nationale.
Ayant fait l’objet d’un bras de fer entre Bercy et le Ministère de la Transition Ecologique, les « projets industriels d’intérêt majeur » pour la souveraineté nationale ou la transition écologique seront finalement bien comptabilisés dans l’enveloppe nationale du ZAN.
Validation de la création d’une « conférence régionale du ZAN »
Enfin, le Palais Bourbon a également validé la proposition du Sénat de créer une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols. Cette dernière pourra se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de sobriété foncière et transmettre à l’État des propositions sur ce sujet. Elle sera également consultée dans le cadre de la qualification des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur, ainsi que sur la qualification de projets d’ampleur régionale.
Une légifération par décrets confirmée
Il convient enfin de noter que plusieurs articles de la proposition de loi sénatoriale ont été retirés du texte et seront adoptés par décrets, comme l’avait annoncé le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Une décision justifiée par le calendrier contraint : l’exécutif souhaite en effet une adoption définitive du texte au plus tard mi-juillet, soit avant la pause estivale et les élections sénatoriales prévues à la rentrée.
Alors que le pouvoir prescriptif du Sraddet sur les objectifs territorialisés du ZAN constituait un point de non-retour pour les associations d’élus du bloc local, l’un des deux projets de décrets vise notamment à privilégier « une approche plus proportionnée et qualitative du rôle de la région ». Ainsi, la fixation d’une cible chiffrée d’artificialisation à l’échelle infrarégionale, dans les règles générales du Sraddet, ne devrait plus être obligatoire afin de « ne pas conduire à contraindre de façon excessive les documents infrarégionaux ».
Renommée proposition de loi « visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sol », le texte sera étudié en commission mixte paritaire (CMP) au plus tard le 13 juillet. Objectif : permettre aux sénateurs et aux députés de trouver un terrain d’entente.
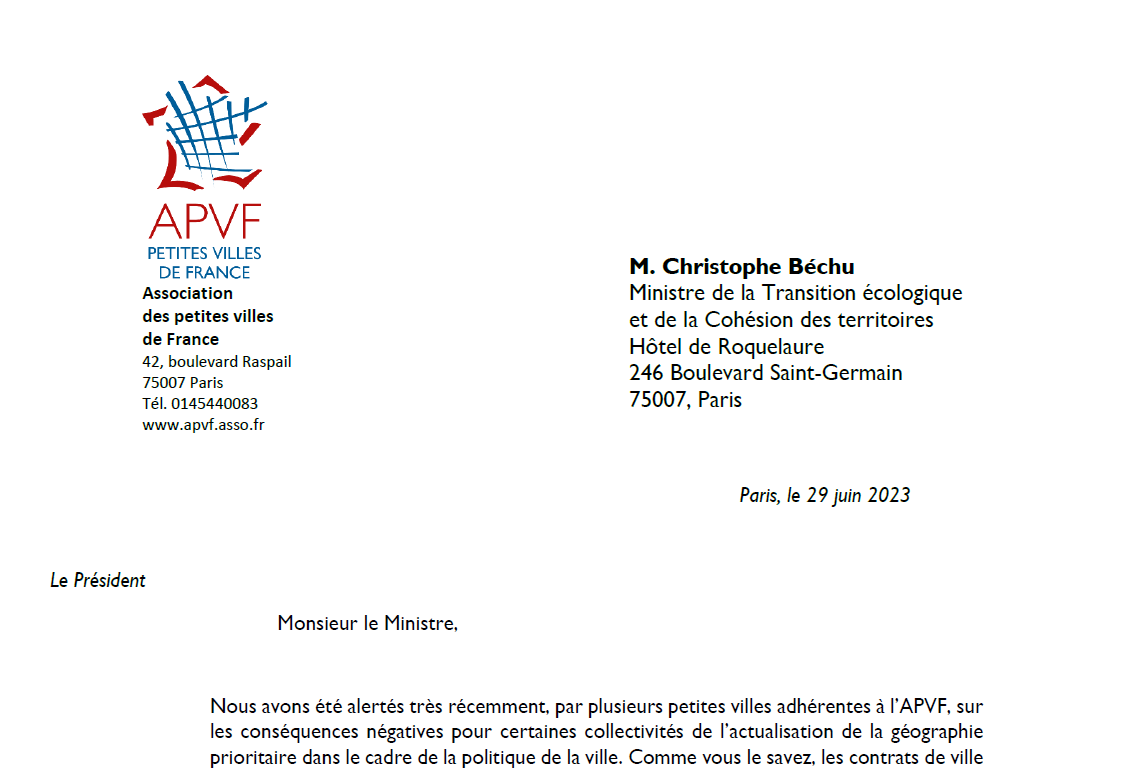
Révision des zonages de la politique de la ville : l'APVF interpelle Christophe Béchu
Un certain nombre d’élus de petites villes ont fait savoir qu’ils pourraient sortir des dispositifs de soutien de la politique de la ville. Les contrats de ville doivent en effet laisser leur place aux “contrats engagements 2030” à la fin de l’année. L’APVF a adressé un courrier à Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, …
Un certain nombre d'élus de petites villes ont fait savoir qu'ils pourraient sortir des dispositifs de soutien de la politique de la ville. Les contrats de ville doivent en effet laisser leur place aux "contrats engagements 2030" à la fin de l'année. L'APVF a adressé un courrier à Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, pour introduire plus de souplesse dans la nouvelle géographie prioritaire.
Les politiques de soutien aux quartiers prioritaires, jusque-là organisées autour "des contrats de ville", s'articuleront à partir du 1er janvier 2024 autour des "contrats engagements 2030". Un des aspects de ces nouveaux contrats est la redéfinition de la géographie prioritaire, selon des critères démographique, de revenu ou encore d'appartenance à une aire urbaine.
Dans son courrier adressé à Christophe Béchu, l'APVF souligne que ces critères sont "appliqués bien trop strictement, sans réelle prise en compte des réalités locales. Ainsi, certaines communes, ayant connu une baisse démographique, même très légère, ces dernières années, constatent avec inquiétude qu’elles pourraient sortir du dispositif."
L'APVF appelle ainsi le ministre à "demander aux préfets de mettre en œuvre une réelle concertation au niveau local, en prenant en compte les réalités de terrain, pour la redéfinition de la géographie prioritaire". Elle rappelle d'ailleurs que c'est le "sens de la circulaire adressée aux préfets le 3 avril dernier par M. Olivier Klein, ministre délégué chargé de la ville et du logement, demandant expressément que « la réponse publique soit adaptée à la réalité locale ".

France Services : un rapport et des annonces
Le 27 juin s’est tenu le comité de pilotage de France Services, présidé par le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guérini. Cela a été l’occasion de présenter le rapport conduit par les parlementaires Bernard Delcros (UC) et Marie-Agnès Poussier-Winsback (Horizons). Le comité de Pilotage France Services rassemble les différents partenaires …
Le 27 juin s'est tenu le comité de pilotage de France Services, présidé par le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guérini. Cela a été l'occasion de présenter le rapport conduit par les parlementaires Bernard Delcros (UC) et Marie-Agnès Poussier-Winsback (Horizons).
Le comité de Pilotage France Services rassemble les différents partenaires du programme, les services de l'Etat ainsi que les représentants des collectivités territoriales. Deux-tiers des porteurs de projets sont en effet des collectivités territoriales. Ce comité de pilotage préfigurait la probable refonte des conventions-cadres des Maisons France Services qui aura lieu à l'automne.
"Pérenniser 100% des Maisons France Services"
Bernard Delcros (UC) et Marie-Agnès Poussier-Winsback (Horizons) ont présenté, dans leur rapport, les principaux objectifs que devaient poursuivre France Services. En effet, selon les parlementaires, les Maisons France Services permettent de répondre à un double besoin : l'accès aux services publics et l'aménagement du territoire. Pour jouer ce rôle, les parlementaires ont défini 3 objectifs :
- Que 100% des usagers connaissent France Services ;
- Que 100% des usagers repartent d'un site France Services avec un solution ;
- Que 100% des Maisons France Services soient pérennisées dans le cadre d'un nouvel accord-cadre national.
Concernant les collectivités territoriales, les parlementaires appellent à mieux les accompagner dans la durée. Ils invitent ainsi à donner davantage de visibilité aux élus locaux via un financement pluriannuel de cinq ans, un accroissement du soutien financier à hauteur de 50 000 euros ou encore la garantie de la présence d'un conseiller numérique dans chaque territoire.
Un accroissement des subventions à hauteur de 50 000 euros
Le ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, après réception du rapport, a communiqué plusieurs annonces, reprenant en partie les recommandations des parlementaires.
Ainsi, sera inscrit dans les politiques prioritaires du gouvernement de l'objectif d’1 million d’accompagnements par les France Services d’ici 2026 (pas de justification du chiffre à part le fait qu’il semble accessible à horizon 2026). En outre, pour assurer la qualité du service, un audit externe sera mis en place, avec l'expertise d'un cabinet de conseil.
Le gouvernement a par ailleurs pris plusieurs engagements financiers. Ainsi, la subvention par structure atteindra 50 000 euros en 2026, contre 35 000 euros en 2023. Le soutien à l'animation départementale passera de 25 000 euros à 50 000 euros, afin de financer un équivalent temps plein. Enfin, 8 millions d'euros devraient être débloqués pour financer les Maisons France Services dans les ZRR.
Sur le chapitre de la formation, les conseillers des Maisons France Services, verront leur volume de formation doublé ; un nouveau référentiel de formation sera mis en place avec le CNFPT.
Un AME « lieux innovants, lieux accueillants »
Les partenaires du programme ont également réalisé des annonces. La Banque des Territoires mettra en place un appel à manifestation d'intérêt (AME) « lieux innovants, lieux accueillants » pour faciliter l’accueil dans 1000 France Services, avec une enveloppe de 10 millions d'euros.
Enfin, La Poste, pour faciliter l'aller-vers, mettra à disposition 10 camions jaunes de la Poste » pour aller à la rencontre du public.
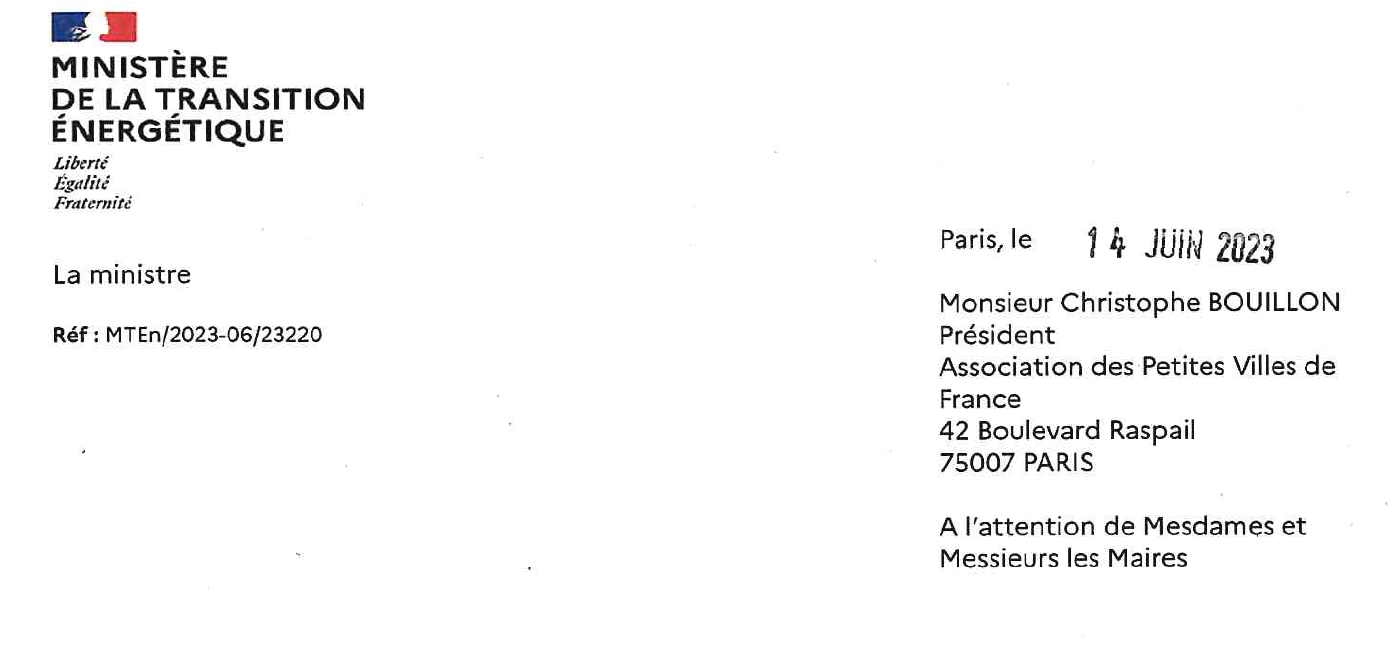
Décret "portes fermées" : le courrier de la ministre de la Transition énergétique aux maires
Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, adresse aux maires une lettre relative à la sobriété énergétique et plus spécifiquement sur un décret d’octobre 2022 visant à mettre fin à la pratique de commerces qui climatisent ou chauffent leurs locaux tout en gardant leurs portes ouvertes. Le courrier de la ministre stipule notamment que : …
Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, adresse aux maires une lettre relative à la sobriété énergétique et plus spécifiquement sur un décret d'octobre 2022 visant à mettre fin à la pratique de commerces qui climatisent ou chauffent leurs locaux tout en gardant leurs portes ouvertes.
Le courrier de la ministre stipule notamment que :
"L'usage limité et raisonné des climatiseurs, gros consommateurs d'énergie et générateurs d'îlots de chaleur dans nos communes est un enjeu prioritaire. C'est à ce titre que j'ai pris en octobre dernier le décret n 2022-1295 visant à mettre fin à la pratique de certains commerces qui climatisent ou chauffent leurs locaux tout en gardant les portes ouvertes"
La ministre ajoute à cet égard :
"En votre qualité de maire, vous avez la pleine compétence pour contrôler le respect de ces dispositions. C'est pourquoi je vous invite à organiser, en vue de l'été et dans la mesure de vos moyens, une campagne d'information et si nécessaire de contrôle."
Agnès Pannier-Runacher précise également aux maires qu'elle "souhaite en outre attirer (leur) attention sur une autre mesure de sobriété énergétique qui concerne les publicités lumineuses. Elles sont interdites entre 1h et 6h du matin depuis octobre 2022 et juin 2023 pour celles sur des mobiliers urbains. A compter du 1er janvier 2024, les pouvoirs de police des maires, seront renforcés et décentralisés afin de s'appuyer sur leur proximité et leur connaissance du territoire pour mieux faire respecter cette réglementation".
Sur cette question des publicités lumineuses la ministre indique "la possibilité d'encadrer dans les règlements locaux de proximité les publicités et enseignes lumineuses situées à l'intérieur des vitrines des commerces"
Pour télécharger le courrier entier d'Agnès Pannier-Runacher cliquez ici

Accès aux soins : la proposition de loi "Valletoux" adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale
L’Assemblée nationale a adopté le vendredi 16 juin en première lecture la proposition de loi, dont le rapporteur est Frédéric Valletoux (Horizons), visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels. Le texte doit désormais être examiné au Sénat. A noter l’adoption de plusieurs amendements après quatre jours de débats : La proposition …
L'Assemblée nationale a adopté le vendredi 16 juin en première lecture la proposition de loi, dont le rapporteur est Frédéric Valletoux (Horizons), visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels. Le texte doit désormais être examiné au Sénat.
A noter l'adoption de plusieurs amendements après quatre jours de débats :
- La proposition de loi prévoit que les cliniques privées devront davantage participer à la "permanence des soins" le soir et le week-end, les députés ont ajouté que l'ensemble des soignants "participent" à cette permanence des soins. Le ministre de la Santé a interprété ce vote comme une "incitation", pour rappel l'obligation de participation à la permanence des soins a été supprimé du code de la santé publique en 2003.
- A également été adopté un amendement ouvrant dès la deuxième année d'études la possibilité de signer des "Contrats d'engagement de service public" (CESP) qui permette le versement d'une allocation mensuelle aux étudiants en contrepartie d'un exercice une fois médecin dans un désert médical
- Un amendement a également consacré la création de la fonction d'infirmier référent choisi par le patient avec une mission de suivi et de renouvellement des prescriptions des soins infirmiers pour les patients chroniques, en lien avec le médecin traitant
- Un amendement, adopté à l'unanimité, supprime la majoration tarifaire susceptible d'être appliquée par l'Assurance maladie durant l'année qui suit le départ à la retraite de son médecin traitant ou quand celui-ci change de département
- Dans les déserts médicaux une option santé dans les lycées pourra être expérimentée afin d'encourager l'accès aux études médicales et paramédicales
L'APVF regrette que l’amendement transpartisan de parlementaires pour une régulation de l’installation des médecins sur le territoire, via un conventionnement sélectif, n’ait pu être adopté.
Les seules mesures incitatives, au coût important et menant souvent à une concurrence délétère entre collectivités, n’ont pas su montrer leur efficacité et ne peuvent suffire alors que l’accès aux soins de nos concitoyens se dégrade depuis plusieurs décennies.
L’APVF soutient donc la mise en place d’une règle simple, qui existe déjà pour d’autres professionnels de santé (chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes…), avec une installation dans les zones déjà bien pourvues conditionnée au départ d’un autre médecin de ces territoires. Ce conventionnement sélectif permettrait une régulation raisonnée de la liberté d’installation des médecins : seul 13% du territoire serait soumis à ce régime d’autorisation, alors que le ministre de la Santé indique que 87% du pays est désormais un désert médical.
L’APVF continuera de suivre avec attention les débats parlementaires et réitère sa demande à ce que la proposition de loi transpartisane sur les déserts médicaux, cosignée par plus de 200 députés de 9 groupes parlementaires, soit inscrite à l’ordre du jour du Parlement.

Assises des Finances Publiques : les collectivités appelées à participer au redressement des comptes publics
Lundi 19 juin se sont tenues les Assises des Finances Publiques. L’objet de cette grand’messe ? Siffler la fin du “quoiqu’il en coûte” et désendetter la France. Le rôle des collectivités locales doit encore être précisé. La Première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, ont fait passer un message clair …
Lundi 19 juin se sont tenues les Assises des Finances Publiques. L'objet de cette grand'messe ? Siffler la fin du "quoiqu'il en coûte" et désendetter la France. Le rôle des collectivités locales doit encore être précisé.
La Première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, ont fait passer un message clair lors des Assises des Finances Publiques : la fin du "quoi qu'il en coûte". L'annonce avait déjà été faite il y a plus d'un an, mais l'explosion de l'inflation a rebattu les cartes.
Cette fois-ci, les principales mesures, comme le bouclier énergétique, devraient être suspendues progressivement, d'ici 2024.
Une trajectoire optimiste de redressement des comptes publics
La hausse des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne (BCE) ainsi que le risque grandissant de voir la note de la dette française dégradée par les agences de notation ont poussé le gouvernement à aller plus loin. Bercy a ainsi présenté une trajectoire de désendettement, dans le cadre du Programme de Stabilité Européen (PSTAB), avec un niveau de déficit à 2,7% du PIB à horizon 2027. Ces prévisions ont été jugées "optimistes" par le Haut Conseil des Finances Publiques.
Le gouvernement a fait savoir là où il souhaitait faire peser l'effort de diminution des dépenses :
1/ La responsabilisation des acteurs en matière d'accès aux soins ;
2/ La réduction de la dépense sur certaines politiques publiques : le logement, l'emploi et les dépenses des opérateurs de l'Etat ;
3/ La diminution des dépenses fiscales, notamment celles en lien avec les énergies carbonées.
Les collectivités payent leur écot
Néanmoins, les collectivités devraient également être mises à contribution. Si aucun mécanisme coercitif, à l'image des contrats de Cahors, n'est à l'ordre du jour, les trajectoires indiquent que les collectivités devront réussir à présenter un excédent de 0,5% du PIB en 2027. Une des hypothèses clefs pour le respect de cette trajectoire est une stagnation de l'investissement sur le reste du mandat.
Pour réussir à tenir cette trajectoire, Elisabeth Borne a indiqué qu'un nouveau partenariat entre les collectivités territoriales et l'Etat était nécessaire, "sur un pied d'égalité".
L'APVF, qui était représentée par son Vice-Président Romain Colas, maire de Boussy-Saint-Antoine, s'est réjouie de la reprise d'une proposition formulée de longue date par les maires des petites villes. L'APVF plaide en effet pour l'instauration d'un pacte de confiance entre l'Etat et les collectivités territoriales. "Toutes les questions devront être abordées dans ce pacte : depuis les dépenses, jusqu’à la prévisibilité des dotations, en passant par les recettes garantissant l’autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales", selon le communiqué de presse de l'association des petites villes de France.
L'APVF s'est cependant montrée plus réservée quant aux projections présentées par Bercy, jugées "parfois peu étayées". Par ailleurs, elle accueille avec réserve l'annonce de mesures comme la mise en place d'un mécanisme d'auto-assurance des recettes, considérant qu'il "doit avoir pour pendant la garantie de l’autonomie des recettes locales".
Télécharger le communiqué de presse de l'APVF à l'issue des Assises des Finances Publiques

3 questions à Philippe Laurent, Président du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale
Alors que le Gouvernement vient d’annoncer la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires à 1,5 % au 1er juillet 2023, Philippe Laurent, Président du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT), revient sur la méthode, le poids budgétaire de cette mesure et les leviers d’amélioration de l’attractivité de la fonction publique territoriale. 1) Que …
Alors que le Gouvernement vient d'annoncer la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires à 1,5 % au 1er juillet 2023, Philippe Laurent, Président du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT), revient sur la méthode, le poids budgétaire de cette mesure et les leviers d'amélioration de l'attractivité de la fonction publique territoriale.
1) Que pensez-vous sur la forme de la méthode du gouvernement pour annoncer la nouvelle revalorisation du point d’indice dans la fonction publique ?
En matière de dialogue partenarial et de dialogue social, il me semble que le gouvernement pourrait nettement mieux faire. En l’espèce, plusieurs annonces ont eu lieu lundi 12 juin dernier dans l’après-midi, alors même que la Coordination des employeurs territoriaux, réunie avec le ministre le matin même, n’en avait pas eu communication intégrale. C’est une mauvaise façon de faire qui ne peut qu’engendrer des tensions. Surtout lorsqu’en même temps, d’autres ministres appelaient à la baisse des dépenses des collectivités locales !
De tout cela ressort un manque évident de cohérence, qui appelle une approche beaucoup plus partenariale et globale, fondée sur une permanence des relations et surtout sur la confiance, de la répartition opérationnelle des rôles en matière d’action publique entre l’exécutif national et les exécutifs locaux, et des conséquences qui en résultent en matière d’autonomie fiscale et de gestion. On en est très loin !
S’agissant du dialogue social, même constat d’une forme d’immaturité. Les négociations salariales entre les employeurs et les représentants des agents doivent être systématiques, régulières et transparentes. Elles doivent aboutir à des accords, ou à tout le moins des décisions, applicables à chaque premier janvier et non pas en cours d’année pour ne pas bouleverser les budgets en cours.
C’est ainsi toute une culture gouvernementale qu’il faut faire évoluer dans le management public pour que le pays retrouve une certaine sérénité. Le secteur privé y est globalement parvenu. En la matière, le secteur public est très en retard. Je le regrette.
2) Sur le fond, quelles conséquences sur les budgets locaux des petites villes ? Pensez-vous que les petites villes seront en mesure de verser la prime annoncée par le ministre de la Fonction publique ?
Pour la fonction publique territoriale, le coût global annuel des mesures de point d’indice et d’attribution de points sera de l’ordre de 2 milliards d’euros. Nous ne connaissons pas encore précisément les contours de cette prime, puisqu’un décret est nécessaire pour permettre aux collectivités locales de la mettre en place si elles le souhaitent … et naturellement si elles le peuvent, puisqu’aucune obligation ne peut leur en être faite en dehors de la loi.
Quoiqu’il en soit, compte tenu du montant plafond fixé à 3 250 euros mensuels, plus de 80% des agents publics territoriaux sont concernés, ce qui, potentiellement, peut représenter près d’un milliard d’euros de dépenses supplémentaires.
Le cumul des mesures annoncées, avec la mise en place de la prime, peut représenter environ 10% à 20% de la capacité d’autofinancement d’ une petite ville. C’est donc un impact considérable, dont l’effet ne peut naturellement pas être ignoré alors que vont être lancées les discussions sur le projet de loi de Finances pour 2024. Le gouvernement doit faire preuve de cohérence pour que nos communes soient toujours en mesure de délivrer le service public local qu’attendent leurs habitants, de continuer à développer leurs territoires et de répondre aux immenses enjeux des transitions écologiques et énergétiques.
3) Que préconiseriez-vous pour rendre plus attractive la fonction publique territoriale au-delà de la revalorisation du point d’indice ?
Le rapport que Corinne DESFORGES, Mathilde ICARD et moi-même avons remis à la ministre Amélie de MONTCHALIN en janvier 2022 et qui portait sur l’attractivité de la fonction publique territoriale contenait des propositions de diverses natures.
Il mettait d’abord en avant l’absolue nécessité d’une revalorisation salariale significative, pour tous les agents publics, avec un supplément pour les revenus les plus faibles.
Le rapport proposait également un certain nombre d’adaptations statutaires assez simples, relevant en grande partie du domaine réglementaire et concernant les seuils, les quotas, les déroulements de carrières, le maintien dans l’emploi, etc. Nous souhaitons que l’administration centrale s’empare de ces suggestions de bon sens et lance le travail de concertation et d’élaboration de ces textes réglementaires au plus vite.
Il insistait en outre sur le manque de visibilité des métiers et des opportunités qu’offre la fonction publique territoriale, et la nécessité pour les employeurs territoriaux d’une mobilisation collective sur le sujet : communication, marque employeur, présence dans les lycées, écoles et universités, développement des forums de l’emploi public, etc. J’insiste sur cette dimension collective de l’action : aujourd’hui, chaque employeur peut faire sa promotion et celle de son territoire. Il m’apparaît essentiel d’y adjoindre une dimension « nationale » et collective pour mieux faire valoir les atouts et les spécificités de la fonction publique territoriale, dont chacun reconnaît qu’elle a su parfaitement accompagner la décentralisation des années 1980 à 2005.
Enfin, le rapport abordait plusieurs sujets relatifs à la qualité de vie au travail et qui font globalement consensus sur le principe : protection sociale complémentaire, action sociale, conditions de travail, accès au logement, etc. Ces sujets sont de nature à être discutés entre les employeurs territoriaux (regroupés au sein de la Coordination) et les organisations syndicales, afin d’aboutir à des accords devant ensuite être intégrés à des textes réglementaires : c’est ce qui est en cours par exemple pour la protection sociale complémentaire, et qui représente un vrai progrès en matière de dialogue social dans la fonction publique.
Il y a urgence. Il ne peut y avoir de service public local de qualité sans une fonction publique formée, engagée, compétente et attractive. La responsabilité de la situation actuelle est collective. La réponse l’est également : quel prix sommes-nous prêts à payer pour des services publics locaux performants ?

Inflation : le nouveau filet de sécurité détaillé par décret
Les modalités de fonctionnement du deuxième filet de sécurité destiné aux collectivités pour l’année 2023 ont été précisées par un décret du 15 juin, et notamment les modalités de calcul et de versement de la dotation octroyée pour compenser les hausses de dépenses liées à l’augmentation des prix de l’énergie, de l’électricité et du chauffage …
Les modalités de fonctionnement du deuxième filet de sécurité destiné aux collectivités pour l’année 2023 ont été précisées par un décret du 15 juin, et notamment les modalités de calcul et de versement de la dotation octroyée pour compenser les hausses de dépenses liées à l'augmentation des prix de l'énergie, de l'électricité et du chauffage urbain que subiront cette année les collectivités.
Perte d’épargne brute de « plus de 15 % »
Reconduit cette année pour les communes et leurs groupements, et étendu aux départements et aux régions, deux critères doivent être remplis pour en bénéficier :
- d’abord, les collectivités devront avoir subi, en 2023, une perte d’épargne brute (la différence entre leurs recettes réelles et leurs dépenses réelles de fonctionnement) de « plus de 15 % » par rapport à l’année 2022.
- ensuite, certains seuils de richesse ne devront pas être dépassés. Dans le détail, les communes devront, pour être éligibles à ce dispositif, avoir un potentiel financier par habitant « inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ». S’agissant des EPCI, leur potentiel fiscal par habitant devra être « inférieur, l’année de répartition, à deux fois le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ».
Le montant de la dotation correspondra à « 50 % de la différence entre l’augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2023 et 2022 et 50 % de celle des recettes réelles de fonctionnement » sur la même période.
Le décret précise qu’elle devra être versée « au plus tard le 31 juillet 2024 ».
À noter que les dépenses énergétiques à comptabiliser sont celles « du budget principal et des budgets annexes », ainsi que celles consenties « au titre des subventions consenties aux fermiers et aux concessionnaires ».
Acompte : jusqu’à 50 % du montant de la dotation
Les collectivités pourront demander le versement d’un acompte, « avant le 15 octobre » 2023 auprès du « représentant de l'État dans le département » et du « directeur départemental des finances publiques ».
Comme pour le premier filet de sécurité, son montant correspondra à « 30 % de la dotation prévisionnelle », mais pourra être porté « jusqu'à 50 % sur demande de la collectivité ». Quoi qu’il en soit, il ne pourra être inférieur à 1 000 euros et sera notifié « au plus tard » le 15 novembre.
Dans le cas où le montant définitif de la dotation serait inférieur à celui estimé pour le calcul du versement de l'acompte, la différence fera « l'objet d'un reversement au plus tard le 30 juillet 2024 ». Si l'acompte est supérieur au montant de la dotation définitive, le reversement de l’excédent s'effectuera via « un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité ».
Télécharger le décret du 15 juin en cliquant ici.
