ESPACE MEMBRE
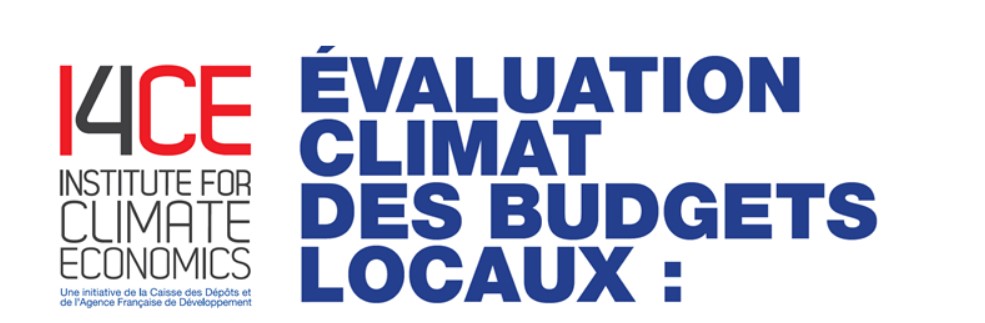
Transition écologique : I4CE organise un webinaire sur l’évaluation climat des budgets locaux
L’Institut for climate economics organise le 13 avril prochain, 9h-10h30, un webinaire sur l’évaluation des impacts du budget local sur l’adaptation au changement climatique du territoire. Ce webinaire présentera les principes et les étapes de mise en œuvre du volet « adaptation » de la méthodologie d’évaluation climat des budgets locaux. L’évaluation « adaptation » permet de : Gagner en lisibilité sur les actions d’adaptation déjà menées par la …
L’Institut for climate economics organise le 13 avril prochain, 9h-10h30, un webinaire sur l’évaluation des impacts du budget local sur l’adaptation au changement climatique du territoire.
Ce webinaire présentera les principes et les étapes de mise en œuvre du volet « adaptation » de la méthodologie d’évaluation climat des budgets locaux. L’évaluation « adaptation » permet de :
- Gagner en lisibilité sur les actions d’adaptation déjà menées par la collectivité et sur les efforts qu’il faut encore fournir,
- Connaitre le niveau d’avancement de la collectivité dans sa prise en compte de l’adaptation,
- Mieux piloter les actions en faveur de l’adaptation.
Le webinaire est destiné aux personnes souhaitant mettre en place une telle démarche dans leur collectivité (notamment des services en charge du budget et de la politique climat).
Au programme :
- Quelles sont les spécificités de l’adaptation ?
- Pourquoi intégrer l’adaptation à l’évaluation climat du budget ?
- Comment sont classées les dépenses ? en vert ? marron ? pourquoi ?
- Comment et quand présenter les résultats d’une telle évaluation, et avec quels effets ?
Pour vous inscrire, cliquez ici

Revitalisation des centres-villes : Le CESE fait des propositions
Dans une contribution, le Cese a présenté les facteurs de la dévitalisation puis a fait des propositions pour redynamiser nos territoires alors même que le plan petites villes de demain commence à se mettre en œuvre. Un phénomène ancien aux causes multiples L’étalement urbain et la péri-urbanisation ont contribué à réduire la population dans ces …
Dans une contribution, le Cese a présenté les facteurs de la dévitalisation puis a fait des propositions pour redynamiser nos territoires alors même que le plan petites villes de demain commence à se mettre en œuvre.
Un phénomène ancien aux causes multiples
L’étalement urbain et la péri-urbanisation ont contribué à réduire la population dans ces petites villes centres. Le développement de e-commerce et des grandes surfaces en périphérie ont également participé à la disparition de nos nombreux commerces dans ces territoires. Des territoires qui ont connu pour beaucoup d’entre eux une déinsdutrialasation depuis plusieurs décennies. Enfin, le départ des services publics comme la fermeture des écoles et des garnisons militaires ont alimenté ce phénonème de dévitalisation.
Les conditions d’une revitalisation réussie
Le Cese donne ensuite les clés pour relever ces défis. Le Cese appelle tout d’abord à partir des projets locaux et à adopter une approche transversale. Pour développer une relance durable, il préconise de favoriser les circuits courts et l’économie locale. Aussi, il plaide pour la mutualisation de l’ingénierie entre les métropoles et les petites villes. Enfin, l’avis propose, comme le réclame l’APVF, un plus grand ancrage local de l’ANCT.
Retrouver l’avis en cliquant ici

DSIL exceptionnelle et petites villes
Un premier bilan a été établi sur les attributions, en autorisation d’engagement 2020, de DSIL exceptionnelle sur l’ensemble du territoire. Après analyse du fichier Excel transmis par le cabinet de Jacqueline Gourault, il ressort que les petites villes n’ont pas été oubliées du dispositif puisque 1176 de leurs projets, sur un total de 3 357 projets …
Un premier bilan a été établi sur les attributions, en autorisation d’engagement 2020, de DSIL exceptionnelle sur l’ensemble du territoire. Après analyse du fichier Excel transmis par le cabinet de Jacqueline Gourault, il ressort que les petites villes n’ont pas été oubliées du dispositif puisque 1176 de leurs projets, sur un total de 3 357 projets subventionnés, bénéficieraient de ce financement en 2020.
Ainsi, sur 574 millions d’euros d’autorisations d’engagement en 2020, 179 millions d’euros ont été fléchés sur les petites villes, soit 1/5ème. Le taux de subvention moyen de l’Etat est d’environ 38,5 % pour les petites villes, contre 24,5 % au niveau global.
Il ressort de cette première analyse que les petites villes ultramarines sous représentées. Seules une vingtaine de petites villes ultramarines bénéficient des crédits de la DSIL exceptionnelle en 2020, pour un montant de 1,9 millions d’euros, soit 1 % seulement des subventions fléchées sur l’ensemble des petites villes. A noter qu’en Guadeloupe, Guyane ou encore à la Réunion, le taux de subvention de l’Etat est très supérieur à la moyenne des petites villes, avec une couverture de près de 70,5 % des projets d’investissement.
La Guadeloupe est la mieux dotée, avec 900 000 euros pour financer une quinzaine de projets, dont la quasi-totalité concernait la mise en œuvre du covid-protocole rentrée 2020. La Guyane a bénéficié de 690 000 euros pour des travaux de réhabilitation d’un bâtiment scolaire, d’une piste desservant des parcelles agricoles ou de consolidation d’un marché. Vient, enfin, la Réunion qui a pu bénéficier de 320 000 euros pour la construction d’une salle culturelle.
Hormis ce dernier projet, l’APVF constate que les subventions de la DSIL exceptionnelle en Outre-mer ne sont pas tant mobilisées pour la relance que pour garantir à ces territoires un niveau acceptable de service public, et notamment pour permettre aux élèves de se rendre à l’école en sécurité. Ce constat établi pour l’outre-mer est d’ailleurs le même qu’en métropole.

Crise sanitaire : l’APVF prend acte des nouvelles mesures gouvernementales de lutte contre l’épidémie
En raison de l’aggravation généralisée de l’épidémie, le président de la République a annoncé hier l’extension des restrictions à tout le territoire et a opté pour la fermeture des établissements scolaires dès vendredi. Alors que, depuis le début de 2021, les mesures mises en place pour ralentir la progression du Covid-19 avaient été appliquées localement, …
En raison de l'aggravation généralisée de l'épidémie, le président de la République a annoncé hier l’extension des restrictions à tout le territoire et a opté pour la fermeture des établissements scolaires dès vendredi. Alors que, depuis le début de 2021, les mesures mises en place pour ralentir la progression du Covid-19 avaient été appliquées localement, Emmanuel Macron a acté des décisions concernant l’ensemble du territoire hexagonal et a demandé aux Français d’accepter de nouveaux efforts.
Dans le détail, voici les nouvelles mesures qui s’appliqueront à partir du lundi 5 avril et jusqu’au 2 mai 2021 :
- Restrictions de mobilité : les sorties sont autorisées entre 6 et 19h, à 10km maximum du domicile. Une attestation sera nécessaire pour dépasser cette limite.
- Les déplacements entre régions sont interdits, sauf raison impérieuse.
- Le télétravail doit être « systématisé » dès que cela est possible.
- Le calendrier des vacances scolaires est modifié, ce qui entraînera une fermeture de tous les établissements scolaires (écoles maternelles, primaires, collèges, lycées et universités) pendant 3 semaines, à compter du vendredi 2 avril.
- Le nombre de place en réanimation sera augmenté afin d’éviter d’avoir à « trier » les patients atteints de la covid-19.
- La vaccination va, durant cette période, s’accélérer au maximum, avec la mobilisation de 250.000 professionnels de santé et la livraison de doses de vaccins supplémentaires chaque semaine.
- L’ouverture de la vaccination aux plus de 60 ans dès mi-avril et aux plus de 60 ans dès la mi-mai
- Les mesures seront progressivement levées mi-mai, avec une réouverture progressive des commerces, bars, terrasses et lieux culturels.
La gestion territorialisée de la crise sanitaire, avec des mesures adaptées à chaque situation locale, n’a finalement pas été retenue. L’APVF prend acte des décisions gouvernementales, tout en regrettant la verticalité et l’abandon de la territorialisation de ces dernières. La fermeture des écoles et des crèches sur tout le territoire national va en effet potentiellement fragiliser les enfants creuser les inégalités et mettre les familles qui travaillent dans des situations très difficiles. La territorialisation de la fermeture des commerces aurait également pu être privilégiée en tenant compte du niveau de saturation des lieux de réanimation et de la circulation du virus.
Lire le communiqué de presse de l’APVF :

Prix santé et mieux-être au travail de la fonction publique territoriale
La MNT prolonge leur prix santé et mieux être de la fonction publique territoriale jusqu’au 4 avril ! La santé des territoriaux, c’est celle des collectivités Chaque jour, sur tout le territoire, petites et grandes collectivités œuvrent pour le mieux-être au travail de leurs agents afin de les aider à assurer le service public de proximité. Les Prix …
La MNT prolonge leur prix santé et mieux être de la fonction publique territoriale jusqu'au 4 avril !
La santé des territoriaux, c’est celle des collectivités
Chaque jour, sur tout le territoire, petites et grandes collectivités œuvrent pour le mieux-être au travail de leurs agents afin de les aider à assurer le service public de proximité. Les Prix santé et mieux-être au travail (PSMT) sont conçus pour récompenser les initiatives les plus innovantes, exemplaires ou efficaces.
Parce que la santé des territoriaux, c’est celle des collectivités, la santé au travail est un enjeu déterminant pour les employeurs publics. En effet, elle constitue à la fois :
- Un levier essentiel pour améliorer le mieux-être de vos agents
- Une question majeure de santé publique
- Un outil de performance, d’efficacité et de continuité du service public local
- Un atout de management et un élément de dynamisation des ressources humaines
- Un élément de dialogue social
PSMT : partenaires
C’est pourquoi la MNT, avec les principaux acteurs de la FPT, a créé en 2011 le Prix santé au travail (PST) de la fonction publique territoriale (FPT), devenu en 2017 le Prix santé et mieux-être au travail (PSMT) et en 2019 les Prix santé et mieux-être au travail. Ces prix proposent à toutes les collectivités territoriales, ainsi qu’aux établissements publics locaux et aux centres de gestion, quels que soient leur statut et leur taille, de faire connaître et reconnaître leurs démarches de prévention et de mieux-être au travail ; ils récompensent ceux qui ont contribué à promouvoir des programmes de santé et d’amélioration du mieux-être au travail auprès de leurs agents et de manière efficace, innovante ou exemplaire.
Découvrez la liste des partenaires du PSLMT
PSMT : objectifs
Les Prix santé et mieux-être au travail visent donc plusieurs objectifs :
- identifier et valoriser les démarches de santé et mieux-être au travail ;
- promouvoir des retours d’expériences et des bonnes pratiques ;
- encourager les collectivités, les établissements publics locaux et les centres de gestion, à initier des démarches pour le mieux-être de leurs agents et contribuer à la qualité du service public ;
- contribuer au bien-être quotidien des agents territoriaux sur leur lieu de travail et au bon fonctionnement du service public.
Ainsi, les PSMT valorisent et récompensent les actions de prévention, santé et mieux-être au travail des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des centres de gestion. Ils permettent aussi l’échange d’expériences entre les différentes collectivités : participation à des ateliers, témoignages et vidéos.
PSMT : 8 éditions
Depuis leur création en 2011, les PSMT ont récompensé une quarantaine de collectivités, nominées ou lauréates, qui partagent volontiers leur expérience. Au fil des éditions, ces prix ont su évoluer : nouveau nom, nouveaux prix, nouvelles récompenses, nouveaux partenaires… La huitième édition (2021) montre que les PSMT ont su, encore une fois, se renouveler tout en gardant leurs objectifs d’origine : faire connaître et reconnaître les actions de prévention et de mieux-être au travail des collectivités territoriales.
Découvrez les lauréats des années précédentes
PSMT : thèmes d’intervention et domaines
Par les PSMT sont concernés les projets, les démarches de prévention visant à prévenir les risques professionnels, à améliorer la santé et le mieux-être au travail et à maintenir dans l’emploi les agents territoriaux avec un recul d’un an minimum de mise en place. Pour les centres de gestion sont aussi récompensées les initiatives en matière de santé au travail dans l’accompagnement des collectivités affiliées.
PSMT : 7 catégories
« Acteurs du territoire », « démarche participative », « qualité de service »… En 2021, les Prix santé et mieux-être au travail comptent 7 catégories valorisant l’engagement mais aussi les bonnes pratiques des collectivités, des établissements publics locaux et des centres de gestion qui contribuent au mieux-être de leurs agents et donc au bon fonctionnement du service public de proximité.
Découvrez les différentes catégories

L’APVF auditionnée par l’IGA sur le redéploiement des forces de police et de gendarmerie dans les territoires
L’Association des petites villes de France, représentant les villes bourg-centres et périurbaines de 2.500 à 25.000 habitants, a été auditionnée le lundi 22 mars par l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), l’Inspection générale de la Police nationale (IGPN) et l’Inspection générale de l’Administration (IGA) dans le cadre de la rédaction d’un rapport d’évaluation des …
L’Association des petites villes de France, représentant les villes bourg-centres et périurbaines de 2.500 à 25.000 habitants, a été auditionnée le lundi 22 mars par l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), l’Inspection générale de la Police nationale (IGPN) et l’Inspection générale de l’Administration (IGA) dans le cadre de la rédaction d’un rapport d’évaluation des redéploiements de forces de police et de gendarmerie, entre 2003 et 2012, notamment dans les communes nouvelles.
L’IGA est, à ce stade, à la moitié de son rapport d’évaluation et les conclusions seront évidemment transmises à l’APVF. Ce rapport ne devrait pas, a priori, justifier une nouvelle modification des zones de compétences de police ou de gendarmerie une nouvelle fois.
Romain Colas, Maire de Boussy-St-Antoine dans l’Essone, Camille Pouponneau, Maire de Pibrac en Haute-Garonne, Anne Gallo, Maire de St-Avé dans le Morbihan et Jean-Pierre Bouquet, Maire de Vitry-le-François dans la Marne ont représenté l’APVF et apporté leur témoignage concernant les réajustements des forces de police ou de gendarmerie sur leurs territoires.
M.Bouquet a tout d’abord expliqué que la zone de Vitry-le-François était passée de zone « police » à zone « gendarmerie » en 2001, ce qui a provoqué une forte contestation chez la population au départ car, chez les citoyens et les élus locaux, la gendarmerie peut être vue comme synonyme de « ruralité ». La gendarmerie de sa commune est ouverte 7 jours sur 7 et dispose de 30 gendarmes et d’une brigade d’investigation.
Si aujourd’hui, personne ne souhaite revenir en arrière et constate l’efficacité et la disponibilité des gendarmes en matière de sécurité, en particulier les week-ends, M.Bouquet déplore le manque de communication et d’explications sur le changement de zones de sécurité dans sa ville. Il explique que les effets d’annonce sont en général assez néfastes et qu’il est nécessaire de prendre le temps de préparer l’opinion publique à un changement de zone.
Mme Pouponneau abonde ces propos en expliquant que dans sa ville, dans la périphérie de Toulouse, certaines villes limitrophes sont dans des zones soit de police, soit de gendarmerie et que cela crée une différence de perception entre des villes voisines. Le Premier Ministre avait cependant récemment annoncé un possible redéploiement des forces de police dans toute la métropole toulousaine. Aujourd’hui, certaines forces de police (pour des missions liées à la tranquillité publique notamment) sont par ailleurs réaffectées vers des zones « gendarmerie », selon les indicateurs de délinquance. La question de la localisation des bassins de délinquance dans les grandes métropoles est également centrale.
Mme Pouponneau estime qu’un accompagnement au changement est nécessaire, pour la population et pour les élus, en expliquant avec pédagogie les raisons et les critères de ces redéploiements. L’ancrage territorial est primordial pour ces forces de police et la question des moyens interroge également. Ces redéploiements sont, selon les élus locaux, effectués pour mutualiser et centraliser les moyens et faire des économies sur les effectifs de sécurité.
Les constats sont globalement similaires chez M.Colas, en zone police à Boussy et chez Mme Gallo à St-Avé, en zone gendarmerie. La délinquance n’est pas forcément originaire de la ville où les effectifs de police ou de gendarmerie sont mobilisés et les Maires notent qu’une réponse statique face à la délinquance est inefficace. Dans le cas de Boussy, la police nationale a accompagné les élus pour la mise en place d’un commissariat d’agglomération, avec des effectifs mutualisés mais certains problèmes ne peuvent pas être traités avec ces redéploiements car les polices locales manquent de moyens.
Il est nécessaire, selon M.Colas, de savoir si ces redéploiements sont préventifs ou curatifs pour les territoires concernés et s’ils permettront de mettre des moyens accrus sur une problématique particulière (délais d’intervention, tranquillité publique, police de proximité etc).
Ces retours de terrain serviront à alimenter le rapport d’évaluation de l’IGA et, à moyen terme, la réflexion du Beauveau de la Sécurité, auquel de nombreux élus locaux et l’APVF participent également.

La Convention des Maires pour le Climat propose un programme d'échange entre pairs
En 2008, la Commission Européenne a lancé la Convention des Maires d’Europe, qui est une déclaration signée par les villes des Etats-membres de l’UE qui s’engagent à respecter les objectifs européens en matière transition écologique et énergétique. Les villes et intercommunalités membres de cette convention s’engagent de façon volontaire dans des actions en matière d’énergie …
En 2008, la Commission Européenne a lancé la Convention des Maires d’Europe, qui est une déclaration signée par les villes des Etats-membres de l’UE qui s’engagent à respecter les objectifs européens en matière transition écologique et énergétique. Les villes et intercommunalités membres de cette convention s’engagent de façon volontaire dans des actions en matière d’énergie durable et de climat, au niveau local. Ces collectivités signent cette démarche dans l’objectif d’assurer un avenir durable à leurs habitants et font partie d’un mouvement global de collectivités qui s’engagent concrètement pour lutter contre le changement climatique.
Aujourd’hui, la Convention des Maires rassemble 9715 signataires dans 27 pays de l’UE, qui représentent plus de 222 millions d’habitants. En France, 180 villes l’ont signée, pour plus de 20 millions de citoyens représentés. Les raisons pour lesquelles les villes s’engagent dans cette démarche sont multiples.
Premièrement, cette convention permet le renforcement de la coopération et du soutien des autorités locales et nationales en matière de développement durable. Ensuite, la Convention des Maires permet aussi une reconnaissance et une visibilité internationale élevée pour l’action de la commune en faveur du climat et de l’énergie. En outre, cette convention est l’occasion pour les Maires signataires de contribuer à façonner la politique climatique et énergétique de l’UE et, enfin, leur permet de tenir des engagements crédibles via une analyse et un suivi des progrès accomplis.
Dans ce contexte, l’APVF relaie et partage le formulaire d’inscription pour le programme d’échanges entre pairs, qui vise à répondre aux besoins des villes et des régions concernant leur niveau d’avancement en matière de transition vers une neutralité climatique. Ce programme permettre aux communes participantes d’échanger des idées et des bonnes pratiques, d’apprendre des autres communes partenaires, de bénéficier d’expertise en finances et de recevoir des conseils spécifiques sur la mise en œuvre du PCEAT (Plan Climat Air énergie territorial).
La date limite d’inscription est le 31 mars 2021, vous trouverez le lien ici (traduit en français) :
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoM_SIG_peer-programme_application_form_2021
Plus d’informations sur la Convention des Maires :
https://www.conventiondesmaires.eu/
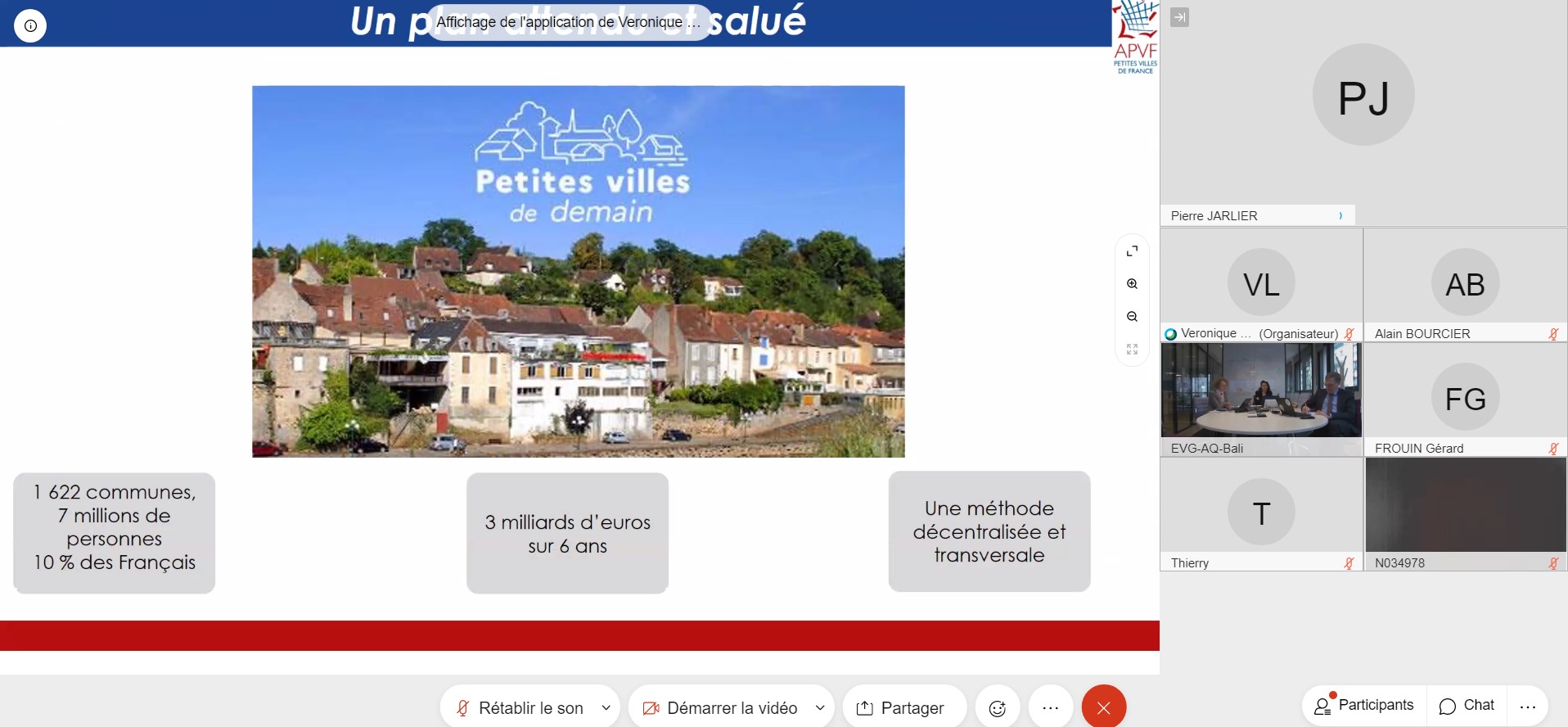
Petites Villes de demain : L’APVF présente les attentes des territoires au Crédit Agricole
Pierre Jarlier, Président d’Honneur de l’APVF, a échangé ce matin avec le Crédit Agricole sur le plan petites villes de demain annoncé par le Premier ministre au Congrès des Petites Villes de France à Uzès en septembre 2019. Il a notamment rappelé les enjeux économiques, d’habitat, sociaux des petites villes et les difficultés qu’elle peuvent …
Pierre Jarlier, Président d’Honneur de l’APVF, a échangé ce matin avec le Crédit Agricole sur le plan petites villes de demain annoncé par le Premier ministre au Congrès des Petites Villes de France à Uzès en septembre 2019.
Il a notamment rappelé les enjeux économiques, d'habitat, sociaux des petites villes et les difficultés qu’elle peuvent rencontrer. La crise du Covid a renforcé ces difficultés.
Ce programme prévoit la mobilisation des acteurs locaux, un soutien en ingénierie mais également un soutien financier thématique et un club annuel des petites villes de demain. Ce club doit permettre de favoriser les actions innovantes en matière de commerce, d’habitat ou encore de numérique.
Il a notamment rappelé la nécessité de renforcer le volet soutien à l’investissement en complément du soutien à l’ingénierie et des 3 milliards d’euros prévus. Petites villes de demain doit être un volet de la relance des territoires et donc se mettre en oeuvre rapidement.
Enfin, il a rappelé la nécessité d’impliquer l’ensemble des acteurs locaux dans les projets de revitalisation. Les partenaires privés ancrés dans les territoires comme le Crédit Agricole doivent être au cœur des projets de revitalisation. Tous les acteurs doivent être mobilisés pour réussir ce programme rappelle Pierre Jarlier en fin d’intervention.
Retrouver le powerpoint de l'APVF en cliquant ici.

Collectivités territoriales et changement climatique : un webinaire pour tout comprendre
Le mardi 30 mars prochain, 9h-10h30, est organisé un webinaire pour tout comprendre des enjeux d’adaptation au changement climatique. Le webinaire comprendra une présentation du cadre juridique, des étapes et outils pour bien mener une politique d’adaptation mais aussi des retours d’expériences des territoires. Intervenants : Corentin Chevallier, Avocat associé, cabinet Foley Hoag Pauline Véron, …
Le mardi 30 mars prochain, 9h-10h30, est organisé un webinaire pour tout comprendre des enjeux d’adaptation au changement climatique.
Le webinaire comprendra une présentation du cadre juridique, des étapes et outils pour bien mener une politique d’adaptation mais aussi des retours d’expériences des territoires.
Intervenants :
- Corentin Chevallier, Avocat associé, cabinet Foley Hoag
- Pauline Véron, Avocate counsel, cabinet Foley Hoag, Ex-Maire Adjointe de Paris (2012-2020)
- Adeline Cauchy, société Ramboll
- Ghislain Dubois, société Ramboll
Pour vous inscrire, cliquez ici.

DSIL/DETR : Antoine Homé auditionné par l’Assemblée nationale
L’APVF, représentée par son Premier vice-président, Antoine Homé, maire de maire de Wittenheim, a été auditionnée, le 25 mars, par mission d’information DETR DSIL de l’Assemblée nationale. En introduction, Antoine Homé a rappelé que la crise sanitaire et économique que nous traversons actuellement, les enjeux de la relance, imposent plus que jamais de repenser les …
L’APVF, représentée par son Premier vice-président, Antoine Homé, maire de maire de Wittenheim, a été auditionnée, le 25 mars, par mission d'information DETR DSIL de l’Assemblée nationale.
En introduction, Antoine Homé a rappelé que la crise sanitaire et économique que nous traversons actuellement, les enjeux de la relance, imposent plus que jamais de repenser les modalités d’attribution des subventions d’investissement aux collectivités territoriales. Les dispositifs doivent être plus transparents et associer plus étroitement les élus locaux, et particulièrement les élus des petites villes.
A l’heure où se dessine la relance et, face au recentrage de la dotation d’équipement aux territoires ruraux (DETR) sur les communes rurales, l’APVF est soucieuse de la faculté pour les petites villes de capter rapidement les crédits d’investissement nécessaires au soutien des dynamiques économiques sur leur territoire. Forces structurantes, elles ne doivent pas être oubliées des dispositifs nationaux.
- Un effet levier de la DSIL et DETR sur l’investissement local, mais pour une partie seulement des petites villes
Pour l’APVF, il est certain que les dotations de soutien à l’investissements – DSIL et DETR – exercent un effet levier sur l’investissement local et sur la décision d’investir sur un projet. Mais, d’une part, un grand nombre de petites villes ne bénéficient pas du soutien financier de l’Etat (30 % des petites villes n’ont perçu en 2020 ni DSIL, ni DETR) et, d’autre part, il n’y a pas de juste milieu entre les petites villes qui cumulent l’ensemble des dotations de soutien à l’investissement et celles qui n’en perçoivent pas du tout. Ce déséquilibre dans l’attribution des crédits de soutien à l’investissement ne peut qu’accroître les inégalités sur le territoire.
- Des pistes d’amélioration nombreuses
Pour en corriger les lacunes, l’APVF propose de simplifier les dispositifs afin d’accroître la transparence dans l’attribution des crédits :
- associer les élus locaux à la définition des priorités ;
- accélérer la communication des critères et des modalités de dépôt des dossiers ;
- décaler la date de dépôt des dossiers après le vote du budget pour laisser le temps aux services de recueillir les informations techniques et financières indispensables à la finalisation des dossiers ;
- accélérer la communication attributions : les élus doivent en avoir connaissance de la réponse un plus tôt dans l'année afin de pouvoir inscrire les subventions dans leur budget et connaître précisément le reste à charge pour la commune.
L’APVF suggère également de favoriser l’échelon départemental dans la répartition des enveloppes de DSIL. Sans créer nécessairement une nouvelle commission, on pourrait s’appuyer sur la commission DETR telle qu’elle existe aujourd’hui, avec ses prérogatives. On lui permettrait de rendre des avis pour 80 % du montant de la DSIL, les 20 % restants étant laissés à la main du préfet de région pour des projets dits « structurants ». Ainsi, dans une logique de subsidiarité, l’attribution des subventions serait menée à l’échelle départementale, et contribuerait à renforcer le couple maire-préfet.
Au-delà de l’architecture des dotations de soutien à l’investissement et des modalités d’attribution des crédits, se pose la question de leur montant. Si la DSIL exceptionnelle de 1 milliard d’euros a été très bien accueillie par les élus locaux, ils sont nombreux à demander l’abondement des enveloppes traditionnelles.
