ESPACE MEMBRE
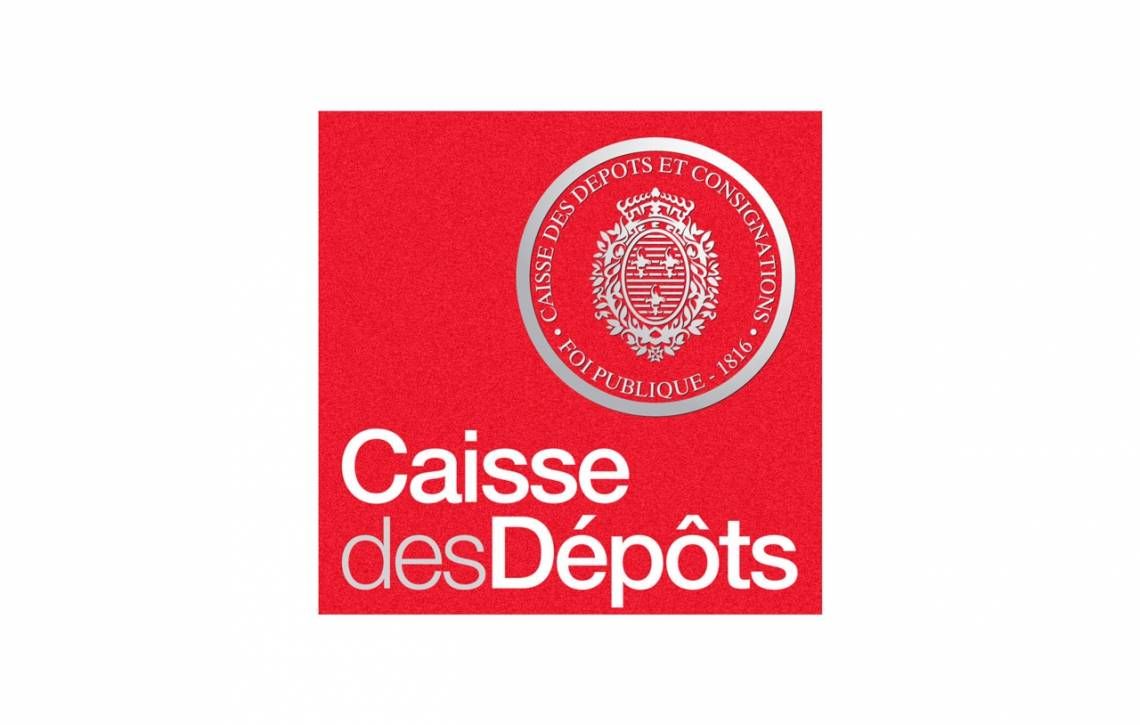
Biodiversité : La Caisse des Dépôts lance l’appel à projets « Architecture et paysage »
La Caisse des Dépôts, partenaire historique de l’APVF, lance l’appel à projets pour l’ensemble de son programme « Architecture et paysage » ouvert jusqu’au 9 mai prochain. Tous les porteurs de projets privés ou publics pourront soumettre leurs projets culturels et artistiques sur la plateforme afin de bénéficier d’une aide financière de la Caisse. Les …
La Caisse des Dépôts, partenaire historique de l’APVF, lance l’appel à projets pour l’ensemble de son programme « Architecture et paysage » ouvert jusqu’au 9 mai prochain.
Tous les porteurs de projets privés ou publics pourront soumettre leurs projets culturels et artistiques sur la plateforme afin de bénéficier d’une aide financière de la Caisse.
Les projets devront prendre en compte deux de ces trois thématiques : l’environnement, la valorisation du patrimoine culturel, et la sensibilisation des jeunes publics.
Un jury composé de membres de la Caisse des Dépôts et d’experts sélectionnera en juin 2021 des projets dans chacune des thématiques.
Pour répondre à l’appel à projet, cliquez ici.

COUP D’OEIL SUR LE PARLEMENT : LES SUJETS À SUIVRE POUR LES TERRITOIRES
Chaque semaine, l’APVF revient sur les grands sujets d’actualité pour les territoires au Parlement. Assemblée nationale PPL/PJL Examen, Séance Publique, pjl climat et résilience Travaux Parlementaires Audition, commissions des finances et des affaires économiques, de M. Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations Audition, Commission des Affaires européennes, de Margarida Marques, …
Chaque semaine, l’APVF revient sur les grands sujets d’actualité pour les territoires au Parlement.
Assemblée nationale
PPL/PJL
- Examen, Séance Publique, pjl climat et résilience
Travaux Parlementaires
- Audition, commissions des finances et des affaires économiques, de M. Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations
- Audition, Commission des Affaires européennes, de Margarida Marques, députée européenne, vice-présidente de la commission des budgets, rapporteure sur la révision du cadre législatif macroéconomique européen
Sénat
PPL/PJL
- Examen, commission de lois, réforme de la formation des élus locaux
- Examen, Séance Publique, PJL respect des principes de la république
Travaux Parlementaires
- Table ronde, commission du développement durable, sur le thème de la géographie prioritaire de la ruralité
- Table ronde, commission du développement durable, de juriste sur le projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, complétant l'article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement

Compensations financières des dépenses liées aux centres de vaccination : l’APVF décrypte la circulaire MinSanté 50
L’APVF a pris part à une réunion entre le cabinet du Ministre de la Santé et les associations d’élus qui visait à expliquer en détail les modalités de remboursement des dépenses avancées par les communes dans le cadre de la campagne de vaccination. Dans cette optique, une circulaire « MinSanté- Corrus 50 » rectificative détaille les coûts …
L’APVF a pris part à une réunion entre le cabinet du Ministre de la Santé et les associations d’élus qui visait à expliquer en détail les modalités de remboursement des dépenses avancées par les communes dans le cadre de la campagne de vaccination. Dans cette optique, une circulaire « MinSanté- Corrus 50 » rectificative détaille les coûts qui seront pris en charge par les ARS, et remboursées aux collectivités.
L’APVF a pu faire remonter les différentes interrogations de ses membres, concernant la mise à disposition des personnels des mairies et les embauches supplémentaires pour faire fonctionner les centres de vaccination (problématiques RH), la question de la vaccination à domicile, des équipes mobiles et des transports de patients et le calendrier précis de la contractualisation entre les ARS et les collectivités concernées.
De manière générale, le ministère de la Santé insiste sur la démarche partenariale de ces modalités de remboursements et de la campagne vaccinale. La première partie de cette circulaire détaille les modalités de rémunération des professionnels de santé (et notamment des médecins retraités) qui œuvrent pour la campagne vaccinale. La seconde partie explique en détail comment le FIR (fonds d’intervention régionale) sera réévalué, quelles dépenses il prendra en charge et comment il sera mis à disposition des collectivités par les ARS.
En premier lieu, le ministère de la Santé a expliqué aux associations d’élus que le forfait du FIR de 50.000€ prévu en janvier lors du lancement de la campagne de vaccination était en effet insuffisant car il était calculé pour un petit centre de vaccination et ne prenait pas en compte l’accélération de la campagne vaccinale. Ce dispositif, qui a pu provoquer des incompréhensions, a été corrigé et permettra de compenser financièrement les communes pour les surcoûts engagés pour la mise en place d’un centre de vaccination. Il ne faut cependant pas oublier que le cadre budgétaire est contraint, ce qui réduit les marges de manœuvre de l’Etat et des collectivités.
En substance, la nouvelle circulaire MinSanté élabore un cadre plus souple et plus agile pour les subventions des ARS aux collectivités. Elle définit un cadre national qui aura vocation à être adapté au niveau local, selon les spécificités de chaque collectivité et, en définitive, aucune convention de partenariat financier ne sera identique. Le cadre juridique de ces compensations financières est celui des subventions classiques des ARS, via le FIR et cette circulaire définit également les modalités de la mise en place d’un guide de bonnes pratiques à destination des centres de vaccination.
Le dialogue et la transparence sur les modalités de compensations financières sont au cœur de ce nouveau dispositif et les ARS devront rendre compte de leurs interventions financières et de leurs échanges avec les collectivités régulièrement.
Concrètement, les surcoûts pris en charge par le FIR seront les frais de gestion du centre, les investissements (informatiques, matériel médical) et le transport de patients âgés ou vivant dans des zones rurales (par la CNAM). Les Conseils régionaux, qui ont la compétence « mobilité », peuvent également aider les petites collectivités pour la vaccination à domicile et le transport de patients. L’Association des Régions de France invite à ce propos les Maires à contacter leur Conseil Régional pour les modalités pratique de ces aides.
Enfin, les dépenses liées aux ressources humaines concernant l’embauche de vacataires ou les heures supplémentaires des agents travaillant dans le centre de vaccination seront également compensées par le FIR actualisé.
En revanche, la mise à disposition d’agents d’autres services pour le centre de vaccination ne sera pas remboursé par l’ARS, qui estime que ces dépenses auraient dans tous les cas été supportées par la collectivité. Il en va de même pour les dépenses liées à l'utilisation de locaux fermés (gymnases, salles polyvalentes etc) et utilisés comme centre de vaccination qui ne seront pas considérées comme des surcoûts par les ARS.
L’APVF et les associations d’élus seront à nouveau régulièrement associées aux réunions de travail sur ce sujet, ce qui permettra de répondre aux interrogations des Maires qui sont en première ligne sur le terrain.
Pour plus d’informations, vous trouverez le détail de la circulaire du 4 avril 2021 :

Erasmus + : le nouveau programme 2021-2027 est lancé, des appels à projets ouverts
Un nouveau septennat s’ouvre pour le programme Erasmus + et de nombreux appels à projets sont ouverts depuis le 25 mars dernier. Ces deniers, qui concerneront les collectivités locales, s’articulent autour de l’inclusion, de la transition écologique, de la transformation numérique et de la citoyenneté active, qui sont les quatre priorités de la Commission européenne …
Un nouveau septennat s’ouvre pour le programme Erasmus + et de nombreux appels à projets sont ouverts depuis le 25 mars dernier. Ces deniers, qui concerneront les collectivités locales, s’articulent autour de l'inclusion, de la transition écologique, de la transformation numérique et de la citoyenneté active, qui sont les quatre priorités de la Commission européenne pour la période 2021-2027
Fort d’un budget de 26 milliards d’euros (+ 80 % par rapport à 2014-2020), le programme européen pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport a l’ambition, dixit la commissaire européenne à l’Innovation, la Recherche, la Culture, l’Education et la Jeunesse, Mariya Gabriel, de « stimuler le développement personnel, social et professionnel » de 10 millions de personnes entre 2021 et 2027, soit autant que ces trois dernières décennies.
L’agence Erasmus + France Education Formation compte pour ce faire, notamment, sur « la participation des collectivités territoriales ». Si les régions sont pour le moment les plus impliquées dans des projets d’échanges européens, les communes peuvent aussi candidater aux appels à projets Erasmus + pour permettre à leurs agents de se former au contact d’homologues européens pour échanger des pratiques et faire avancer les politiques tant sur l’accompagnement des personnes âgées, que l’accueil des migrants ou encore la transition écologique ». Les actions dites de « coopération » (candidatures ouvertes jusqu’au 20 mai 2021) ou de « partenariat » sont aussi renouvelées.
Depuis 2021, les actions de « mobilité », qui « ne se résument pas à la mobilité des étudiants mais concernent aussi les jeunes de la voie professionnelle, collégiens, lycéens, enseignants, formateurs et personnels administratifs », s’ouvrent au champ de la petite enfance. « On peut imaginer, par exemple, des visites de professionnels de la petite enfance, notamment issus des collectivités, dans d’autres pays européens pour comparer les systèmes de prise en charge des enfants dès le plus jeune âge. Je pense notamment aux ''Kindergarten'' (jardins d’enfants) en Allemagne ». Les candidatures sur les actions « mobilité » sont ouvertes jusqu’au 11 mai 2021.
En parallèle, la Commission européenne a dessiné quatre priorités dans lesquelles pourraient s’inscrire les projets des collectivités. L’inclusion sociale est la première d’entre elles. Deuxièmes priorités, la transition écologique et plus particulièrement l’éducation au développement durable. D'autres projets, en lien avec la transformation numérique (équipement en ordinateurs portables des écoles afin de permettre les connexions entre des écoles de pays différents…) et la citoyenneté active (participation à la vie démocratique) peuvent aussi émerger : il s'agit des deux autres grandes priorités de ces sept prochaines années.

Trois questions à ... Alain Gianazza, Président de la MNT
La Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) protège depuis plus de 50 ans les agents territoriaux en santé et en prévoyance. Au moment où les discussions s’accélèrent sur la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC), l’APVF a souhaité poser trois questions à Alain Gianazza, président de la MNT depuis 2013, pour connaître les priorités de la …
La Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) protège depuis plus de 50 ans les agents territoriaux en santé et en prévoyance. Au moment où les discussions s'accélèrent sur la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC), l'APVF a souhaité poser trois questions à Alain Gianazza, président de la MNT depuis 2013, pour connaître les priorités de la MNT pour améliorer la protection sociale des territoriaux.
- Comment pouvez-vous définir le rôle de la MNT dans la protection des agents publics territoriaux ?
Première mutuelle des agents des services publics locaux en santé et en prévoyance, la MNT est une mutuelle gérée par les territoriaux selon les principes démocratiques de la mutualité. Elle s’engage, depuis plus de 55 ans, pour un égal accès à la santé de tous les agents territoriaux, par le biais d’une protection sociale solidaire et responsable. Pour accompagner les évolutions du monde territorial et rester proche des agents et des collectivités, elle participe à développer une meilleure connaissance de l’environnement des services publics locaux. Elle contribue ainsi aux réflexions sur leurs perspectives en partageant son expertise.
- Quelles sont aujourd’hui les limites de la complémentaire en prévoyance et en santé dans la fonction publique ?
La couverture complémentaire est indispensable à la prise en charge des aléas touchant les territoriaux, tant pour les risques courts comme c’est le cas pour la santé que pour les risques longs, comme c’est le cas en prévoyance. Il s’agit d’un enjeu de santé publique, de bonne gestion pour les collectivités, et de maintien dans des conditions de vie décentes pour les agents.
À titre d’exemple, en l’absence de couverture prévoyance (cas d’un agent sur deux), l’agent perd la moitié de son traitement après 90 jours d’arrêt de travail, consécutifs ou non. De plus, la mutualisation du risque, qui passe par la croissance du nombre d’agents couverts, est indispensable pour assurer la viabilité économique de la couverture du risque « prévoyance » : en moyenne 80 agents cotisants sans arrêt de travail doivent être fédérés pour financer un arrêt maladie longue durée.
- Quelles pistes d’amélioration proposez-vous ?
Avec l’ordonnance sur la protection sociale dans la fonction publique publiée le 18 février dernier, force est de constater qu’une très grande partie des revendications de la MNT qui sont aussi celles de la Coordination des employeurs territoriaux mais également de l’ensemble des organisations syndicales a été honorée : la participation des employeurs dans la FPT est désormais obligatoire (à hauteur de 20 % en prévoyance au plus tard le 1er janvier 2025 et à hauteur de 50 % en santé au plus tard le 1er janvier 2026), maintien de la double procédure pour cette participation (labellisation et convention de participation), possibilité d’accords majoritaires permettant la conclusion de contrats ou de règlements collectifs à adhésion obligatoire.
Toutefois ces grands principes contenus dans l’ordonnance doivent être désormais confortés et précisés par les décrets d’application : quid du panier de soins en santé ou des garanties en prévoyance ? quel « montant de référence » pour les 20 % en prévoyance et 50 % en santé ? quel est le contenu de cette fameuse solidarité intergénérationnelle décrite dans l’ordonnance ? et une série d’autres questions auxquelles devront répondre avant la fin de l’année le gouvernement, les employeurs territoriaux et les organisations syndicales : la MNT en tant qu’experte sera à leurs côtés pour les accompagner.

Logement social : première réunion du groupe de travail sur le dispositif SRU
Suite à plusieurs remontées de difficultés de terrain, l’APVF a mis en place un groupe de travail – piloté par Pierre Jarlier, Président d’honneur, et composé d’une quinzaine d’élus de petites villes – pour réfléchir aux moyens d’améliorer le dispositif de l’article 55 de la loi SRU à l’aune des dispositions du projet de loi …
Suite à plusieurs remontées de difficultés de terrain, l'APVF a mis en place un groupe de travail - piloté par Pierre Jarlier, Président d'honneur, et composé d'une quinzaine d'élus de petites villes - pour réfléchir aux moyens d'améliorer le dispositif de l'article 55 de la loi SRU à l'aune des dispositions du projet de loi 4D. Ce groupe de travail s'est réuni le 7 avril. Partant des besoins en logements sociaux sur le territoire, les élus des petites villes demandent de la souplesse et des objectifs de construction différenciés tenant mieux compte des spécificités locales particulières.
André Robert a introduit cette première réunion du groupe de travail en rappelant les enjeux d’une construction équilibrée de logements sociaux sur le territoire et les difficultés parfois rencontrées sur le terrain pour mettre en œuvre les objectifs de l’article 55 de la loi SRU, malgré la bonne volonté des élus locaux.
Un tour de table a ensuite permis de recenser un certain nombre de ces difficultés et de freins au respect des objectifs, et notamment :
- Un dispositif de la loi SRU conçu principalement pour les zones très tendues et dont l’application uniforme est un frein au peuplement équilibré des logements sociaux sur le territoire.
- Certaines communes, qui font des efforts importants malgré une situation géographique, socio-économique ou financière particulière ou difficile, sont autant pénalisées que celles qui manquent simplement de volonté. Parfois, elles héritent du déficit constaté sur la période triennale passée.
Illustrations : la commune littorale de Trégunc où la mise en place de zones à urbaniser dans le PLU est limitée ou, encore, la commune très résidentielle et principalement pavillonnaire de Pibrac où la densification serait mal acceptée par la population après une période de consommation non négligeable des terres agricoles. Il y a également la ville de Saint-Martin-le-Vinoux qui dispose de peu de zones constructibles et qui fait également face au délaissement des bailleurs privés préférant les communes non soumises aux objectifs SRU ou les grandes opérations de construction rentables. Il y a également les communes enclavées peu attractives qui demandent, en amont, des investissements d’ampleur dans les infrastructures et la mobilité pour améliorer le cadre de vie de leurs habitants.
- Un régime juridique rigide qui peut engendrer des situations assez catastrophiques, notamment en Ile de France où les Maires de communes carencées se sont vu retirer leurs permis de construire, rendant toujours plus délicate leur faculté à tenir les objectifs.
Partant de ces retours de terrain, Pierre Jarlier a esquissé les contours des propositions que l’APVF pourrait formuler dans le cadre du projet de loi 4D, support d’une réforme de l’article 55 de la loi SRU, dont les grandes lignes ont été rappelées par Emma Chenillat après un exposé des durcissements et assouplissements successifs et réguliers du dispositif.

L’APVF renouvelle son partenariat avec le groupe SFR
Mardi 6 avril, Christophe Bouillon, Président de l’APVF accompagné par Loïc Hervé, Président délégué, a rencontré les dirigeants du groupe SFR dont Grégory Rabuel, Directeur général de SFR, Arthur Dreyfus, Secrétaire général d’Altice Médias et Claire Perset, Directrice générale adjointe. L’APVF et SFR ont à cette occasion renouvelé leur partenariat pour l’année 2021. Au cours …
Mardi 6 avril, Christophe Bouillon, Président de l’APVF accompagné par Loïc Hervé, Président délégué, a rencontré les dirigeants du groupe SFR dont Grégory Rabuel, Directeur général de SFR, Arthur Dreyfus, Secrétaire général d’Altice Médias et Claire Perset, Directrice générale adjointe.
L’APVF et SFR ont à cette occasion renouvelé leur partenariat pour l’année 2021. Au cours des discussions, les dirigeants de l’APVF et de SFR ont notamment évoqué la résorption de la fracture numérique dans les territoires et l’arrivée progressive de la 5G

Trois questions à … Vincent Chauvet, Maire d’Autun et membre du Comité des Régions de l’UE
Vincent Chauvet, membre du Bureau de l’APVF et Maire d’Autun (Saône-et-Loire) depuis 2017, réélu en 2020, a été nommé dans la délégation française (Parti Renew Europe- libéral-centriste) du Comité des Régions de l’Union Européenne en janvier 2020. L’APVF lui a posé trois questions afin de comprendre le rôle de cette institution de l’Union européenne qui …
Vincent Chauvet, membre du Bureau de l’APVF et Maire d’Autun (Saône-et-Loire) depuis 2017, réélu en 2020, a été nommé dans la délégation française (Parti Renew Europe- libéral-centriste) du Comité des Régions de l’Union Européenne en janvier 2020.
L’APVF lui a posé trois questions afin de comprendre le rôle de cette institution de l’Union européenne qui représente les collectivités locales.
- Qu’est-ce que le comité des Régions et comment fonctionne-t-il ?
Le Comité européen des régions (CdR) est l'organe de consultation et de représentation des collectivités locales et régionales de l'Union européenne. Il est le porte-parole des intérêts de ces entités territoriales auprès de la Commission européenne et du Conseil, auxquels il adresse des avis.
Institué par le traité de Maastricht de 1992 et mis en place le 9 mars 1994, le Comité européens des régions (CdR) a une mission exclusivement consultative, comme le Conseil économique et social européen (CESE). Il rend des avis lorsque les traités le prévoient. Ceux-ci imposent ainsi la consultation du CdR pour toute nouvelle proposition touchant l'échelon régional ou local. Il est particulièrement consulté sur les questions de coopération transnationale (coopération entre plusieurs régions de différents Etats membres). En pratique, le CdR est saisi sur tout projet d'acte de l'UE impactant les collectivités territoriales, c'est à dire sur la quasi-totalité du programme de travail de la Commission européenne
Le Comité des régions peut également être consulté chaque fois que le Parlement, la Commission ou le Conseil le jugent nécessaire, même lorsque les traités ne le prévoient pas. Les avis du CdR sont non contraignants mais souvent suivis lors du processus législatif européen. Il permet également d’encourager l’échange de bonnes pratiques et d’expériences entre les membres des différents pays représentés en son sein.
Depuis sa création, le CdR a adopté plusieurs centaines d'avis sur un large éventail de questions comme, par exemple : le développement des réseaux de télécommunications, les transports et l'énergie, la lutte contre le cancer et le sida, ou encore, l'accès à l'éducation tout au long de la vie. Il se réunit à Bruxelles, dans l’hémicycle du Parlement européen pour ses sessions plénières, tous les trimestres.
Par ailleurs, le traité de Lisbonne, signé en 2007, a apporté une innovation majeure : le CdR peut désormais déposer un recours devant la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) pour violation du principe de subsidiarité contre les actes européens qu'il estime ne pas les respecter. Il peut également la saisir s'il n'est pas consulté sur les actes pour lesquels sa consultation est obligatoire.
- Quel est le processus de désignation au Comité des Régions et comment avez-vous été nommé dans cette instance ?
Le Comité des Régions est composé d'une assemblée et d'un bureau. L'assemblée du CdR compte actuellement 329 membres (et autant de membres suppléants) issus des 27 pays de l'UE, répartis en 6 groupes politiques principaux, selon les tendances du Parlement européen. Les membres et leurs suppléants sont nommés par le Conseil, sur proposition des États membres, pour un mandat de cinq ans. Son Président est le Grec Apostolos Tzitzikostas depuis février 2020.
Le Conseil adopte la liste des membres et des suppléants conformément aux propositions faites par chacun des Etats membres. Pour pouvoir appartenir au Comité, il est toujours nécessaire de détenir un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale ou d'être politiquement responsable devant une assemblée élue.
Si le mandat local du membre expire, le mandat au sein du Comité prend aussi fin. Il est alors remplacé par un nouvel élu local (ou régional) pour la période de mandat restante. La France, l’Allemagne et l’Italie ont 24 représentants, l’Espagne et la Pologne 21, la Roumanie 15 et les autres Etats-membres un nombre proportionnel à leur population.
Les membres de la délégation française sont des élus régionaux (12), départementaux (6) ou des Maires (6). Pour être nommé, les Associations d’élus (l’AMF dans le cas des Maires, après consultation de l’APVF ou de l’AMRF) proposent une liste de candidats qui sont ensuite nommés par le Gouvernement en Conseil des Ministres.
Ma candidature a été appuyée par l’APVF, que je remercie d’ailleurs pour son soutien. Christophe Rouillon, Maire de Coulaines et membre du Bureau de l’APVF est également membre du Comité des Régions.
- Quels sont les thèmes débattus en ce moment au Comité des Régions ?
Je suis pour ma part rapporteur de la Commission de l’environnement, du changement climatique et de l’énergie, au sein de laquelle nous avons débattu les prochains objectifs climatiques de l’Union européenne, à savoir la baisse de 55% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.
L’impact de cette décision au niveau local, dans les petites villes notamment, est immense car il implique de repenser fondamentalement la façon dont les Mairies prennent en compte la dimension environnementale dans leurs politiques publiques (chauffages urbains, voitures thermiques, efficacité énergétique, biomasse etc).

Transition écologique dans les cantines scolaires : quel accompagnement pour les petites villes ?
Dans le cadre du plan de relance, une subvention de l’Etat de 50M€ au total est proposée aux petites communes qui souhaitent effectuer une transition vers un approvisionnement plus durable, local pour leurs services de restauration collective. Les petites communes bénéficieront du soutien de l’État, en vue de proposer des produits, de qualité et respectueux …
Dans le cadre du plan de relance, une subvention de l’Etat de 50M€ au total est proposée aux petites communes qui souhaitent effectuer une transition vers un approvisionnement plus durable, local pour leurs services de restauration collective. Les petites communes bénéficieront du soutien de l’État, en vue de proposer des produits, de qualité et respectueux de l’environnement dans les cantines des écoles primaires et maternelles.
Cette aide, inscrite au volet «transition agricole» du plan de relance, permettra de faciliter l’investissement en matériels, par exemple pour travailler les produits frais (création de légumeries, matériel de cuisson lente…), réduire le gaspillage alimentaire (vaisselle, tables de tri) mais aussi pour s’adapter à la nouvelle règlementation sur le plastique (interdiction du plastique à usage unique…).
Une aide au financement des formations est également prévue.
Cela permettra, entre autres, d’atteindre rapidement les objectifs de la Loi Egalim votée en octobre 2018, qui sont, notamment :
- La mise en place d’un menu végétarien hebdomadaire (au 1/11/2019)
- L’interdiction des ustensiles en plastique à usage unique et des bouteilles d’eau plates en plastique (au 01/01/20)
- La mise en place d’un diagnostic et d’une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire (au 22/10/2020)
- 50% de produits de qualité, durable et locaux dont au moins 20% de produits biologiques (au 01/01/2022)
- Interdiction des contenants alimentaires en plastique pour la cuisson, réchauffe ou le service des repas (au 01/01/2028)
Le Réseau interprofessionnel des acteurs de la restauration collective Restau’co et la Fondation Nicolas Hulot proposent d’accompagner donc les collectivités locales qui souhaitent atteindre les objectifs de la Loi Egalim dans les cantines scolaires notamment, via la Démarche Mon Restau responsable, qui est éligible à la subvention (dans le volet « transition écologique et agricole ») du Plan France Relance.
Mon Restau Responsable est un outil destiné à aider les structures de restauration collective à s’engager dans une démarche de progrès. Il permet de valoriser les bonnes pratiques existantes et de définir de nouvelles pistes d’amélioration en associant toutes les parties prenantes. Reposant sur un Système Participatif de Garantie, Mon Restau Responsable favorise les échanges entre les différents acteurs de l’alimentation d’un territoire, participant ainsi à la mise en place d’une dynamique territoriale pour une alimentation saine et durable. A ce jour, 1 578 établissements sont engagés dans cette démarche de progrès.
Pour plus d’informations sur ces questions, vous trouverez ci-joint la plaquette de présentation de ce dispositif, le guide pratique de « Mon restau responsable » et un lien vers le site de ce programme d’accompagnement.
Explications sur le Plan de relance "Petites communes" et restauration collective:
Le guide pratique Mon restau responsable:
Le site pour s'inscrire à cette démarche d'accompagnement:
https://www.monrestauresponsable.org/

La Banque des territoires présente son nouveau guide : « Compter les flux, comprendre les déplacements dans les territoires »
Aujourd’hui, les données de flux s’imposent progressivement aux collectivités comme des outils à forte valeur ajoutée contribuant ainsi aux politiques locales et répondant à différents cas d’usage. Mais concrètement, qu’est-ce que le comptage de flux ? A quels besoins répond-il ? Comment se repérer dans l’écosystème de solutions existantes ? C’est à toutes ces questions que la Banque …
Aujourd’hui, les données de flux s’imposent progressivement aux collectivités comme des outils à forte valeur ajoutée contribuant ainsi aux politiques locales et répondant à différents cas d’usage. Mais concrètement, qu’est-ce que le comptage de flux ? A quels besoins répond-il ? Comment se repérer dans l’écosystème de solutions existantes ? C’est à toutes ces questions que la Banque des Territoires a souhaité répondre en publiant le guide intitulé « Compter les flux, comprendre les déplacements dans les territoires – Panorama des solutions numériques ». De plus, dans le contexte sanitaire actuel, ce guide donne également des clés aux collectivités pour notamment mesurer l’impact de la crise sur leur territoire ou enrichir leurs projets de revitalisation engagés dans le cadre des programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de Demain.
Qu’est-ce que le comptage de flux ?
Le comptage de flux désigne les techniques visant à compter les déplacements des divers flux de mobilité (piétons, cyclistes, automobilistes, voyageurs) circulant dans un périmètre ou à une adresse donnée.
A quels besoins répond le comptage de flux ?
Le comptage de flux recense des données à forte valeur ajoutée susceptibles d’alimenter un grand nombre de cas d’usage de collectivités. Cinq catégories de cas d’usage ont été identifiées :
- l’aide aux choix d’investissement en matière d’infrastructure et d’aménagement pour créer, par exemple, une nouvelle ligne de transport
- le développement de l’attractivité territoriale en identifiant notamment les meilleurs emplacements pour l’implantation de commerces
- la mesure de l’affluence pour gérer les espaces et bâtiments publics pour ensuite optimiser les temps d’attente, par exemple
- l’adaptation du fonctionnement des réseaux de transport en commun et de la voirie
- l’hypervision en temps réel de l’espace public
Quelles sont les solutions existantes ?
De nombreux acteurs fournissent des solutions contribuant aux comptages de flux. Il peut s’agir :
- d’acteurs dont c’est le cœur de métier : fournisseurs de capteurs, acteurs de niche spécialisés
- d’acteurs étendant leur marché : les opérateurs télécoms, du Wifi public, les GAFAM.
Ces offres peuvent également être analysées :
- d’après leur choix technique : offre mono ou multi-capteurs, achat de données type GPS, et avec ou non une solution d’analyse de données
- d’après leur modèle de coût et de facturation : pose ou fourniture de capteurs, accès à des solutions applicatives, réalisation d’une étude, partenariat d’échange de données.
Plus d’informations sur cette étude, et pour la télécharger :
https://www.banquedesterritoires.fr/compter-les-flux-comprendre-les-deplacements
