ESPACE MEMBRE

L'APVF a rencontré la nouvelle ministre en charge de la Ville, Juliette Méadel
Mercredi 15 janvier, l’APVF a rencontré Juliette Méadel, ministre déléguée chargée de la ville. La délégation de l’APVF était composée de Christophe Bouillon, Maire de Barentin et Président de l’APVF, Christophe Rouillon, Maires de Coulaines, membre du Bureau de l’APVF et d’André Robert, Délégué général. “N’oubliez pas les petites villes !” Christophe Bouillon a …
Mercredi 15 janvier, l'APVF a rencontré Juliette Méadel, ministre déléguée chargée de la ville. La délégation de l'APVF était composée de Christophe Bouillon, Maire de Barentin et Président de l'APVF, Christophe Rouillon, Maires de Coulaines, membre du Bureau de l'APVF et d'André Robert, Délégué général.
"N'oubliez pas les petites villes !"
Christophe Bouillon a particulièrement insisté auprès de la ministre sur le fait que de nombreuses petites villes étaient concernées par la politique de la ville et qu'il ne fallait pas les oublier. Il a rappelé les enjeux en termes de pauvreté, mais aussi de sécurité existant dans les petites villes et qu'il fallait se garder d'opposer de façon simpliste le rural et l'urbain.
L'APVF a également insisté sur la nécessité de mieux soutenir les "Maires bâtisseurs" et notamment ceux qui construisent des logements sociaux.
Christophe Rouillon a pour sa part abordé la question de l'éducation et notamment la nécessité de mieux soutenir les cités éducatives.
Enfin, la délégation de l'APVF s'est inquiété de la question des moyens alloués à la politique de la ville, sans avoir eu pour l'instant de réponses précises concernant les crédits alloués à l'ANRU.
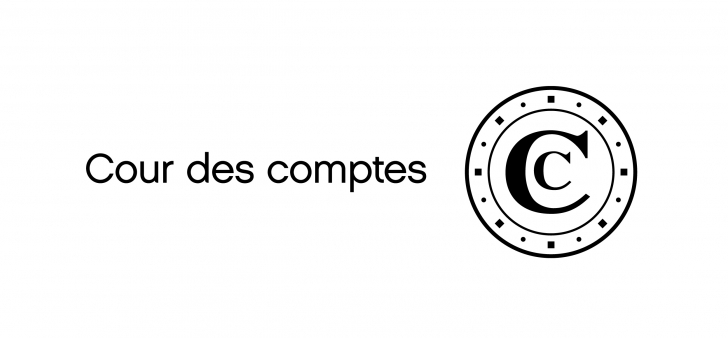
La répartition des zones police et gendarmerie : la Cour des Comptes plaide pour des ajustements
La Cour des Comptes publie un rapport sur le zonage police/gendarmerie. Dans un contexte où le manque de forces de sécurité intérieure est dénoncé par de nombreux maires, la clarification proposée par les magistrats financiers pourrait apporter des réponses. A condition que ces efforts ne soient pas reportés sur les polices municipales. Des ajustements nécessaires …
La Cour des Comptes publie un rapport sur le zonage police/gendarmerie. Dans un contexte où le manque de forces de sécurité intérieure est dénoncé par de nombreux maires, la clarification proposée par les magistrats financiers pourrait apporter des réponses. A condition que ces efforts ne soient pas reportés sur les polices municipales.
Des ajustements nécessaires "en continu"
Selon les magistrats de la rue Cambon, la répartition actuelle entre les zones "police" et les zones "gendarmerie" est déséquilibrée. En effet, la police nationale ne se déploie que sur 5% du territoire national, tandis que la gendarmerie couvre le reste du territoire. Il est à noter que, de fait, et sans cadre règlementaire précis, la police et la gendarmerie partagent, de fait, leur compétence. La Cour des comptes propose de donner une base juridique à cette situation.
Quand bien même des ajustements ont été réalisées, leurs effets ne sont mesurés que depuis 2016. Toutefois, depuis 10 ans, "face à l'impossibilité de faire converger l'ensemble des parties prenantes, les ministres de l'intérieur successifs n'ont pris aucune décision de modification des zones de compétence". Si des ajustements ont lieu au niveau local, les zonages sont transférés par "vagues", ce qui ne manque pas d'occasionner des effets de bord. Les magistrats financiers invitent donc le gouvernement à privilégier une approche "d'ajustement continu (...) en phase avec les besoins locaux" ce qui constitue une demande de longue date des associations d'élus locaux.
Concrètement, la Cour propose de solliciter l'avis de l'autorité judiciaire avant tout transfert d'une commune à une autre. Une exception notable à cette recommandation : la rue Cambon propose de "transférer en zone gendarmerie l'ensemble des communes des départements ruraux et faiblement peuplés", ce qui constitue une rupture significative avec la répartition actuelle. L'objectif est un gain d'efficacité et de moyens pour les deux forces.
Quid de l'articulation avec les polices municipales ?
La Cour n'a pas manqué de souligner l'importance prise par les polices municipales, véritable troisième pilier des forces de sécurité intérieure avec la police nationale et la gendarmerie. Au 31 décembre 2022, 4 558 communes sont données de plus de 27 000 agents. Néanmoins, la Cour des comptes ne lie pas la question du zonage à la présence de la police municipale. Les contrats de sécurité intégrés qui lient forces de sécurité intérieure et polices municipales, qui arrivent à échéance en 2026, doivent faire l'objet d'une évaluation.
En toute hypothèse, ce sont les modalités d'articulation entre police municipale et forces de sécurité intérieure qui restent à définir, ce que l'APVF demande depuis de nombreuses années.
L'APVF alerte cependant sur une phrase rédigée au détour d'un paragraphe du rapport de la Cour des Comptes : "Les polices municipales occupent donc une place désormais incontestable dans le continuum de sécurité, qu'il convient d'intégrer à la réflexion plus générale sur la répartition des forces de sécurité à l'échelle d'un territoire". Cette phrase pourrait laisser entendre que les polices municipales viendraient suppléer au retrait de forces de police ou de gendarmerie, ce qui seraient un dévoiement de leur rôle. L'APVF demeurera attentive sur ce point.
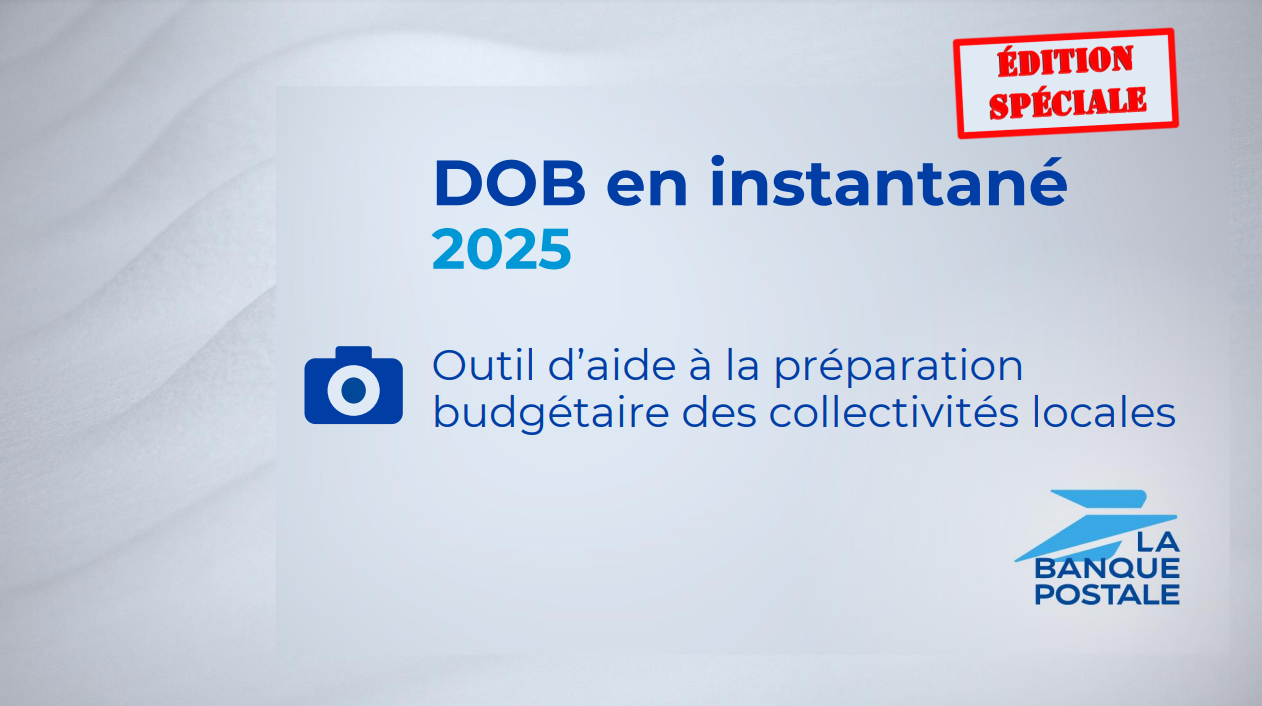
Préparation des budgets locaux : retrouvez l'édition spéciale du D.O.B en instantané de La Banque postale
Véritable outil d’aide à la préparation budgétaire, le D.O.B. en instantané de La Banque postale publié mi janvier est particulièrement bienvenu dans le contexte d’incertitude actuel. Habituellement, il s’agit d’une analyse de la loi de finances de l’année. En raison du décalage du calendrier législatif et budgétaire, ils publient une édition spéciale contenant des graphiques …
Véritable outil d’aide à la préparation budgétaire, le D.O.B. en instantané de La Banque postale publié mi janvier est particulièrement bienvenu dans le contexte d’incertitude actuel.
Habituellement, il s’agit d’une analyse de la loi de finances de l’année. En raison du décalage du calendrier législatif et budgétaire, ils publient une édition spéciale contenant des graphiques et tableaux sur la conjoncture économique et les finances publiques, un rappel du contexte budgétaire, les éléments de la loi spéciale et du décret intéressant les collectivités locales, ainsi que des informations pour construire les budgets locaux indépendamment du vote d’une loi de finances. Principaux enseignements :
Répartition de la DGF
Le versement de la DGF pour les prochaines semaines est garanti sur la base de son montant global et des règles d’attribution de l’année 2024 (avant une régularisation après l’adoption du prochain budget), avec des variations individuelles possibles liées à la démographie. En outre, l’augmentation du nombre de communes d’au moins 5 000 habitants devrait rendre éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) une dizaine de communes supplémentaires et que les communes classées en Zone France ruralité revitalisation bénéficieront d’une surpondération pour le calcul des fractions “bourgs centres” et “péréquation” de la dotation de solidarité rurale (DSR).
Prudence sur la prévision des recettes d’investissement
Les élus pourront bénéficier de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) ou encore du Fonds vert pour leurs dépenses déjà engagées, mais ils devront attendre l'adoption du budget 2025 pour percevoir à nouveau ces dotations sur leurs nouvelles dépenses. La Banque postale conseille aux collectivités, pour le vote du budget, de rester prudents sur les recettes d’investissement à prévoir en 2025 au titre des opérations ayant fait l’objet d’un arrêté d’attribution de la part de l’État, et à plus forte raison, au titre des projets non encore validés.
Impôts locaux : une revalorisation de 1,7 %
Le D.O.B. en instantané met en évidence des points d’incertitude : la revalorisation de 1,7 % des valeurs locatives cadastrales qui servent à établir les bases de la fiscalité locale (après des hausses de 7,1 % et 3,9 % les deux dernières années). Sur la hausse progressive du taux de cotisation à la CNRACL, le décret entérinant la hausse pourrait être pris courant janvier.
La Banque postale détaille enfin une série d'autres informations fiscales utiles pour préparer le budget :
- les montants de l’imposition forfaitaire sur les pylônes seront, en 2025, de « 3 235 euros pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et de 6 461 euros pour les plus de 350 kilovolts ».
- les tarifs de l'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (Ifer) seront, eux, revalorisés de 1,8 %, tandis que la valeur forfaitaire de la taxe d’aménagement devrait être, « dans l’attente de la parution du décret officiel», réévaluée à hauteur de « 1 054 euros en Île-de-France et 930 euros ailleurs ».
Télécharger le D.O.B. en instantané en cliquant ici.
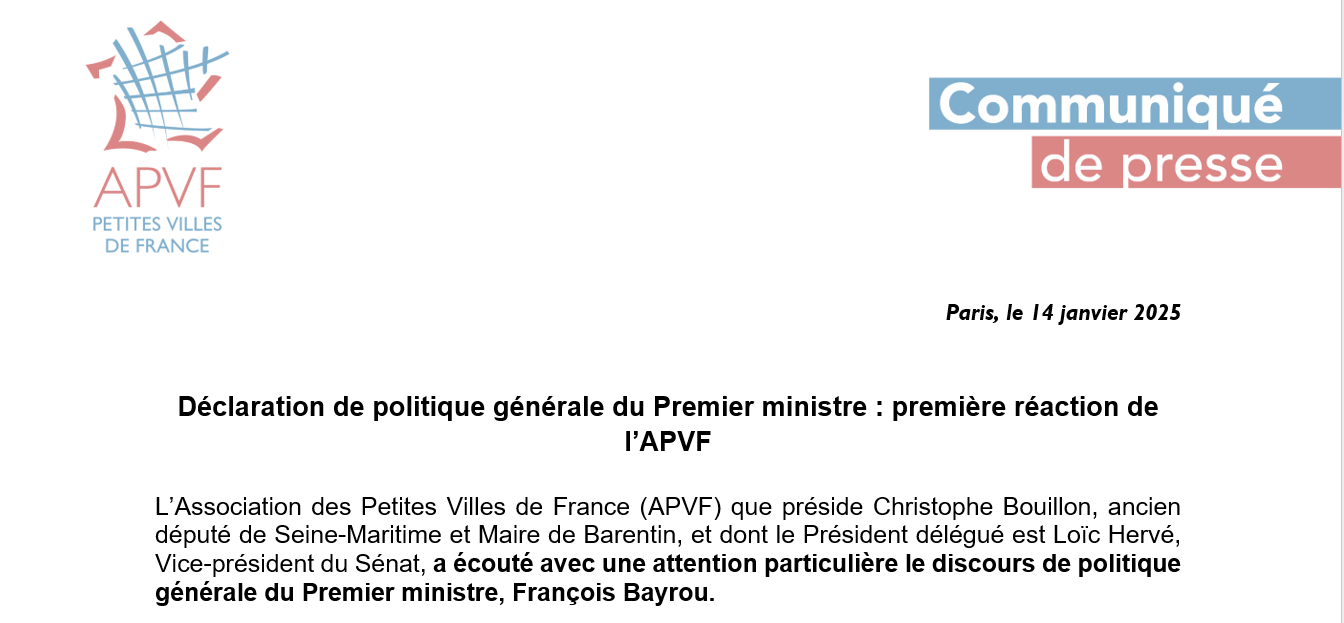
Déclaration de politique générale du Premier ministre : première réaction de l’APVF
Dans un communiqué de presse diffusé le 15 janvier, l’APVF a fait part de ses premières réactions au discours de politique générale du Premier ministre, François Bayrou, devant l’Assemblée nationale. Elle apprécie le ton employé par le Premier ministre concernant les relations entre l’Etat et les collectivités territoriales, et notamment l’absence de toute mise en …
Dans un communiqué de presse diffusé le 15 janvier, l'APVF a fait part de ses premières réactions au discours de politique générale du Premier ministre, François Bayrou, devant l'Assemblée nationale.
Elle apprécie le ton employé par le Premier ministre concernant les relations entre l’Etat et les collectivités territoriales, et notamment l’absence de toute mise en cause de la responsabilité des collectivités dans la dérive des déficits publics, ce qui change agréablement des discours tenus ces derniers mois.
L’APVF prend acte de l’annonce de l’allègement de l’effort demandé aux collectivités territoriales pour réduire les déficits publics. Elle sera toutefois vigilante quant à la portée exacte, la répartition et le chiffrage des efforts demandés, qui ne prennent en compte ni la fonte des crédits du Fonds vert, ni la hausse annoncée de la cotisation des employeurs territoriaux à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), ni la non-indexation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à l’inflation.
Le Premier ministre a certes bien rappelé le poids incontournable des collectivités territoriales dans l’investissement public et dans le soutien à l’économie des territoires, mais n’a pas annoncé de mesures fortes d’appui à l’investissement local permettant de faire face au mur d’investissement que représente le financement de la transition écologique.
Ainsi que l’a annoncé le Premier ministre, l’APVF attend avec impatience l’adoption par le Parlement du texte de loi relatif à la mise en œuvre d’un véritable statut de l’élu local, en amont des prochaines élections municipales.
Enfin, si l’APVF prend acte du diagnostic porté par le Premier ministre concernant la fracture territoriale, entre les métropoles et le reste du territoire, ainsi que sur la dégradation de la situation des services publics, elle déplore la timidité des annonces relatives à la réduction des inégalités d’accès à l’offre de soins et face à la désertification médicale.
L’APVF a indiqué qu'elle se tenait à la disposition du Gouvernement et du Parlement sur toutes les grandes questions évoquées par le Premier ministre à l’Assemblée nationale, avec l’absolue conviction qu’on ne résoudra aucun grand défi qui se pose à notre pays sans remettre les collectivités et les élus locaux dans l’équation.
Télécharger le communiqué de presse de l'APVF en cliquant ici.
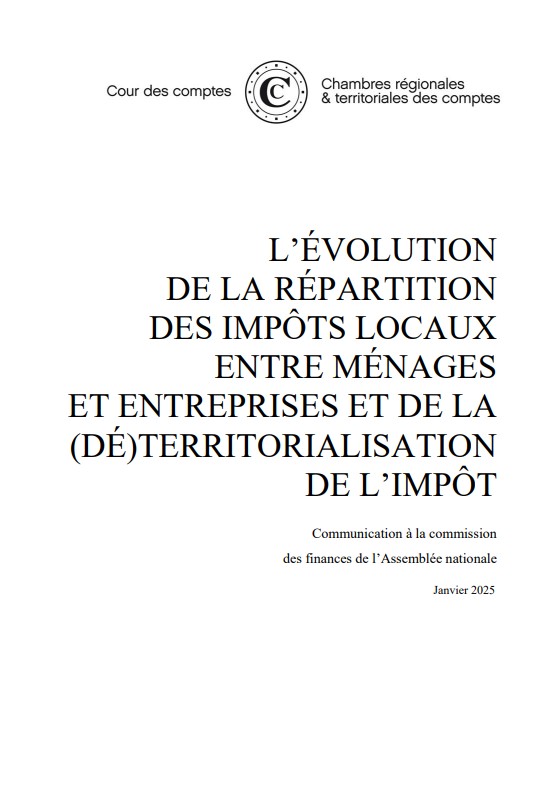
Réformes de la fiscalité locale : un coût considérable pour les finances publiques
C’est la conclusion établie par la Cour des comptes dans un rapport publié le 15 janvier relatif à l’impact des réformes récentes des impôts locaux sur les contribuables locaux, ménages et entreprises, les collectivités territoriales, ainsi que l’État et les finances publiques prises dans leur ensemble. Tout d’abord, ces réformes ont été mises en œuvre …
C’est la conclusion établie par la Cour des comptes dans un rapport publié le 15 janvier relatif à l’impact des réformes récentes des impôts locaux sur les contribuables locaux, ménages et entreprises, les collectivités territoriales, ainsi que l’État et les finances publiques prises dans leur ensemble.
Tout d’abord, ces réformes ont été mises en œuvre en fonction de finalités extérieures à la fiscalité locale. Le législateur a avancé plusieurs raisons pour les justifier : « donner du pouvoir d’achat aux ménages » et « améliorer la compétitivité des entreprises ». En réalité, pour l’APVF, il s’agissait surtout de recentraliser les finances locales afin de mieux les contrôler. Or, la Cour des comptes révèle que l’objectif d’économie n’a pas été atteint : le coût a été considérable pour les finances publiques.
Une réduction de grande ampleur des impôts locaux entre 2018 et 2023
La taxe d’habitation sur les résidences principales, qui était un impôt jugé « injuste » fondé sur des « bases obsolètes », selon la Cour des comptes et les détracteurs de l’impôt, a été supprimée par étapes entre 2018 et 2023.
En outre, les impôts locaux « pesant sur les coûts de production des entreprises », selon les termes de la Cour des comptes, ont été également réduits. D’une part, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises a été diminuée en 2021 et 2023 à hauteur des trois-quarts au total ; en 2023, son produit résiduel a été réaffecté à l’État, dans l’attente d’une suppression complète dont l’horizon s’éloigne. D’autre part, les bases d’imposition des locaux industriels assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises ont été réduites de moitié en 2021.
En 2023, les contribuables ont acquitté 100 milliards d’euros d’impôts locaux, soit 38 milliards de moins que ce qu’ils auraient versé si les réformes n’avaient pas eu lieu. Les ménages ont acquitté 54 % des impôts, contre 46 % pour les entreprises. Ces proportions sont stables par rapport à 2017 révélant pour l’APVF des effets extrêmement limités de la réforme.
Des gains limités réservés aux ménages les plus riches
En moyenne, la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a accru de 1,1 % le revenu disponible des ménages. Elle a plus bénéficié aux ménages aisés qu’aux autres, ce qui a engendré une redistribution à l’envers. Ses effets sur la consommation des ménages sont incertains (à-coups de la conjoncture économique depuis 2020, moindre propension à consommer des ménages aisés).
La baisse des impôts locaux de production a accru de 2,4 % l’excédent brut d’exploitation des entreprises. Elle a eu un effet conjoncturel favorable en 2021 (100 % de la hausse de l’EBE). Le recul manque pour apprécier son impact sur les investissements des entreprises dans la durée.
Un coût considérable pour les finances publiques : 38,5 milliards d’euros de pertes de recettes qui représentent 25 % du déficit public en 2023
Les pertes de recettes des collectivités ont été compensées par l’État selon des modalités qui leur sont « plutôt favorables » selon la Cour des comptes.
Pour les magistrats de la rue Cambon, les grandes gagnantes de la réforme, du moins les premières années de sa mise en œuvre encore partielle, sont les collectivités, qui ont bénéficié d’un gain financier net en raison du dynamisme en 2021 et 2022 des recettes de TVA qui leur sont attribuées.
Depuis lors, ce bénéfice se réduit, même si les collectivités pourraient bénéficier d’un gain durable : « l’évolution des prix et de la consommation en volume ont des effets immédiats sur les recettes de TVA, alors que les assiettes de la THRP et de la CVAE augmentaient avec une année de décalage ». Cela vaut pour les départements et les intercommunalités.
En 2023, les réformes ont entraîné 38,5 milliards de pertes de recettes pour l’État par rapport à 2017 (suppression de la redevance audiovisuelle comprise), soit 25 % du déficit des administrations publiques en 2023 et 50 % de leur augmentation entre 2017 et 2023.
Une déterritorialisation des impôts locaux qui a des conséquences négatives, y compris pour les communes
Les communes et intercommunalités ont conservé des pouvoirs fiscaux étendus. La plupart les exercent en augmentant de manière continue les taux des impôts locaux, ce qui accru de 2,9 Md€ la charge des contribuables locaux entre 2017 et 2023. En revanche, la réaffectation aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties a fait perdre aux départements l’essentiel de leurs pouvoirs fiscaux : tous ou presque appliquaient déjà le taux maximal (de 4,5 %) des droits de mutation à titre onéreux. La réforme n’a pas eu d’impact significatifs sur les pouvoirs fiscaux des régions qui n’en avaient quasiment plus.
Les impôts territorialisés sont devenus minoritaires dans les recettes de fonctionnement des départements (20,1 % en 2023) et des régions (12,1 %). Pour la Cour, le constat est clair : « Les entreprises ne contribuent plus au financement des compétences de développement économique des régions, ni de celles des régions et départements en matière de transports (rail, routes), dont elles bénéficient pourtant. »
Les impôts territorialisés restent, malgré tout, majoritaires dans les recettes de fonctionnement des communes et des intercommunalités (54,1 %). En raison de moindres retombées fiscales, les communes sont toutefois moins incitées à accueillir de nouvelles activités et à construire de nouveaux logements. Les locataires de leur logement ne contribuent plus au financement des services publics dont ils bénéficient. La taxe foncière maintient néanmoins ce lien contributif dans la grande majorité des communes, qui comptent plus de propriétaires que de locataires.
Assurer une équité accrue entre contribuables et entre collectivités
La Cour estime nécessaire d’adapter la fiscalité foncière aux réalités économiques, en intégrant à court terme aux bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties les résultats de la révision sexennale des valeurs des locaux professionnels arrêtées en 2017 et en engageant la révision, sans cesse reportée, des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation datant de 1970.
Sauf exception, les recettes de TVA sont réparties entre collectivités de manière proportionnelle à leurs pertes de recettes fiscales. Cette répartition ignore les écarts de richesse entre collectivités et désavantage celles dont la population croît. Comme elle l’a fait récemment dans un rapport consacré à la DGF, la Cour recommande de répartir les recettes de TVA en fonction de la richesse relative par habitant des collectivités, appréciée selon un petit nombre de critères de ressources et de charges. Ces évolutions devront être simulées et étalées dans le temps.
Télécharger le rapport complet de la Cour des comptes en cliquant ici.

Roger Hatubi AMED maire-adjoint à Kani-keli témoigne de la situation à Mayotte
M. Roger Hatubi Amed, maire-adjiont de Kani-Keli à Mayotte revient sur la situation à Mayotte un mois après le passage du cyclone Chido. Suite au passage du cyclone Chido, de nombreuses personnes ont quitté le territoire en raison de la destruction de leurs logements. Les habitants ressentent un sentiment d’abandon, notamment face à l’incertitude …
M. Roger Hatubi Amed, maire-adjiont de Kani-Keli à Mayotte revient sur la situation à Mayotte un mois après le passage du cyclone Chido.
Suite au passage du cyclone Chido, de nombreuses personnes ont quitté le territoire en raison de la destruction de leurs logements. Les habitants ressentent un sentiment d’abandon, notamment face à l’incertitude liée au retour des fonctionnaires. Cette incertitude est particulièrement forte concernant l’éducation nationale.
En effet, plusieurs établissements scolaires sont détruits. Cela cristallise l'inquiétude des parents. A l'heure actuelle, nous ne disposons d'aucune certitude concernant la réouverture des écoles ce qui exacerbe les tensions.
Autre difficulté, la situation migratoire. Une partie des centres d'hébergement - dont un certain nombre d'écoles - est occupée par des migrants, principalement venus d'Afrique, ce qui complique la gestion de la crise.
La situation est particulièrement difficile pour les collectivités locales, qui ne disposent que de ressources limitées. Ainsi, les communes, déjà très pauvres, doivent assumer des dépenses imprévues pour nettoyer les villages. En dépit des aides envoyées, elles n'ont reçu aucun soutien financier concret pour appuyer leurs efforts pour la reconstruction et le rétablissement des services publics.
Il est enfin à noter que selon là où l'on se trouve à Mayotte, l'état des infrastructures n'est pas le même. C'est le Nord de l'île qui a été le plus durement touché par le cyclone. Seuls 20 % des habitants y ont retrouvé l’accès à l’électricité. Quant au Sud, 16% de la population y est encore privée d'électricité.
Les vols commerciaux ont cependant repris, ce qui est un signe encourageant pour faciliter les déplacements et la reprise de l'économie.
Roger Hatubi Amed, maire-adjoint de Kani-Keli

PLF 2025 : l’examen reprendra le 15 janvier au Sénat
Si les consultations menées par le ministre de l’Economie, Eric Lombard, et la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, sur le futur projet de loi de finances pour 2025 ont démarré le 6 janvier à Berçy, il faudra attendre le 14 janvier, date de la déclaration de politique générale du Premier ministre, François Bayrou, …
Si les consultations menées par le ministre de l’Economie, Eric Lombard, et la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, sur le futur projet de loi de finances pour 2025 ont démarré le 6 janvier à Berçy, il faudra attendre le 14 janvier, date de la déclaration de politique générale du Premier ministre, François Bayrou, pour en savoir plus sur l’économie générale du texte. Aux termes de la Conférence des Présidents du Sénat qui s’est tenue hier soir, son examen pourrait reprendre le 15 janvier.
A partir du 15 janvier, le Sénat reprendra l’examen du texte tel qu’il a été élaboré par l’exécutif précédent, sur la base de ce qui a été précédemment voté en séance publique, et qui pourra être amendé en cours de route avec les mesures que le gouvernement de François Bayrou est en train de négocier pour éviter une nouvelle censure. Le vote solennel est fixé au 23 janvier.
Pour rappel, le Parlement avait adopté en décembre une loi spéciale, soumis en urgence après la censure du gouvernement de Michel Barnier, pour pallier l’absence de budget au 1er janvier 2025. En attendant l’adoption d’une loi de finances pour l’année 2025, cette loi minimaliste permet une certaine continuité des institutions (perception de l’impôt, capacité à emprunter...).
Tout l’enjeu est de doter rapidement la France d’un véritable budget. C’est la raison pour laquelle la plupart des sénateurs et de nombreux spécialistes plaident depuis le début pour que les débats budgétaires reprennent là où ils se sont arrêtés au moment de la censure du gouvernement de Michel Barnier, sans dépôt d’un nouveau PLF. Comme l’a indiqué le sénateur du Cantal, Stéphane Sautarel, Vice-président LR de la Commission des finances du Sénat, « Repartir de la feuille blanche pour bâtir un nouveau budget, cela signifierait qu’il n’y aurait pas de budget avant avril au plus tôt », avec la crainte que ce calendrier ne creuse « encore davantage le déficit ».
Sur la base du calendrier de la discussion du projet de loi de finances pour 2025 en ligne sur le site du Sénat au 8 janvier, c'est bien le scénario qui se profile, avec la reprise de l'examen de la deuxième partie du texte , qui s'était achevée, pour rappel, le 4 décembre sur le vote en séance publique de la mission "Relation avec les collectivités territoriales". Avaient été notamment actées la suppression des mesures touchant le FCTVA et la suppression du fonds de précaution. A noter que le précédent gouvernement avait prévu de faire adopter un amendement visant à exonérer les départements les plus fragiles, à étendre le fonds de précaution à un nombre plus important de communes tout en réduisant le niveau des ponctions financières. Le flou reste entier sur ce plan, mais l'APVF continue à défendre la suppression complète du dispositif qui priverait les collectivités de 2 milliards d'euros de recettes.
Sur la suite de la procédure, le scénario qui semble là aussi se dégager, c'est le passage directement en commission mixte paritaire (CMP), sans deuxième lecture, du projet de loi de finances pour 2025. C'est d'ailleurs à ce moment là que seront vraisemblablement examinés les éventuels amendements du gouvernement.
Téléchargez le calendrier d'examen du PLF 2025 au Sénat en cliquant ici.

L'APVF vous souhaite tous ses meilleurs vœux pour 2025 !
Pour télécharger la carte de vœux de l’APVF, cliquer ici.
Pour télécharger la carte de vœux de l'APVF, cliquer ici.

L'activité économique "suspendue au regain de confiance" selon l'Insee
L’Insee prévoit une croissance atone pour le début de l’année 2025. L’enjeu de la confiance des entreprises et des ménages constitue l’un des principaux freins au regain de l’activité. La croissance devrait plafonner à 0,2% pour le premier et le deuxième trimestre de l’année 2025. Les enquêtes sur les ménages et les entreprises dessinent un …
L'Insee prévoit une croissance atone pour le début de l'année 2025. L'enjeu de la confiance des entreprises et des ménages constitue l'un des principaux freins au regain de l'activité.
La croissance devrait plafonner à 0,2% pour le premier et le deuxième trimestre de l'année 2025. Les enquêtes sur les ménages et les entreprises dessinent un paysage "morose". Les deux mamelles de la croissance française en 2024 - la dynamique du commerce extérieur et la dépense publique - devraient se tarir l'an prochain.
Cependant, ces estimations sont à considérer avec prudence tant la situation politique actuelle est marquée par l'incertitude. Conséquence : le niveau d'investissement des entreprises en 2025 devrait poursuivre son repli. La consommation, moteur sur lequel se repose généralement la croissance, n'a pas été aussi dynamique qu'attendue en 2024. Cependant, un certain nombre de facteurs pourraient permettre un redressement de la consommation des ménages, avec le ralentissement de l'inflation et la hausse des salaires. Le taux d'inflation devrait ainsi atteindre 1% en juin 2025. La consommation ne devrait cependant croître que de 0,1% au premier trimestre.
Dans ce contexte, le chômage devrait repartir à la hausse pour atteindre 7,6% de la population active mi-2025.

La loi spéciale adoptée à l’unanimité au Parlement
Après une adoption à l’unanimité du projet de loi spéciale sur le budget à l’Assemblée nationale, le Sénat adopte le texte transmis par les députés sans modification. Pour rappel, ce projet de loi contient trois articles. Le premier article vise à autoriser le gouvernement à continuer à percevoir les impôts existants et reconduit les prélèvements …
Après une adoption à l’unanimité du projet de loi spéciale sur le budget à l’Assemblée nationale, le Sénat adopte le texte transmis par les députés sans modification.
Pour rappel, ce projet de loi contient trois articles. Le premier article vise à autoriser le gouvernement à continuer à percevoir les impôts existants et reconduit les prélèvements sur les recettes au profit des collectivités territoriales jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances de l’année. Cette possibilité a été ajoutée dans le texte par un amendement de Stéphane Delautrette, député de Haute-Vienne, Président de la Délégation aux collectivités à l’Assemblée. Le versement de ces prélèvements ne pourra se faire que sur la base des crédits de paiements adoptés en 2024. Les collectivités pourront donc recevoir le versement des subventions déjà attribuée, mais ne pourront en avoir de nouvelles avant l’adoption d’un projet de loi de finances.
En outre, le versement de la dotation globale de fonctionnement devrait également être assuré, par douzièmes, puisqu’il permet la « continuité des services publics ». A ce stade, les dotations de solidarité urbaine ou rurale (DSU et DSR) suivront les règles de péréquation de 2024. Le paramètre qui pourra néanmoins faire varier les montants de DGF à ce stade, c'est l'évolution de la population.
Les articles 2 et 3 du projet de loi spéciale concernent les autorisations relatives aux emprunts.
Parallèlement, concernant la partie « dépenses », le gouvernement prendra un décret ouvrant les crédits applicables aux seuls services votés, notamment pour permettre de verser la rémunération des agents publics. Ils ne pourront excéder le montant des crédits ouverts par la dernière loi de finances de l'année en cours. Il est en cours de préparation et devraient passer devant le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) prochainement.
En attendant, une circulaire interministérielle du 12 décembre, signée par Michel Barnier, informe les ministres démissionnaires d’un certain nombre de dispositifs à appliquer dans cette attente, et notamment la mise en place d’une « régulation budgétaire renforcée » et une réserve dite « républicaine ». En effet, cette circulaire indique qu’en vertu d’un « principe de prudence et de parcimonie » des crédits seront mis en réserve dès le début de la gestion. Dans le détail :
- aucune nouvelle dépense sauf pour préserver les intérêts vitaux du pays,
- financement des seuls projets d’investissement en cours de réalisation,
- non-remplacement des départs d’agents, sauf si cela est strictement nécessaire pour assurer la continuité du service,
- mise en attente des revalorisations salariales,
- suspension de toutes les dépenses discrétionnaires (dotation et subventions modulables, appels à projets et soutiens divers).
Téléchargez la circulaire interministérielle du 12 décembre 2024 relative à la mise en œuvre du décret de services votés à compter du 1er janvier 2025: mise en place d'une régulation budgétaire renforcée et d'une réserve républicaine en cliquant ici.
